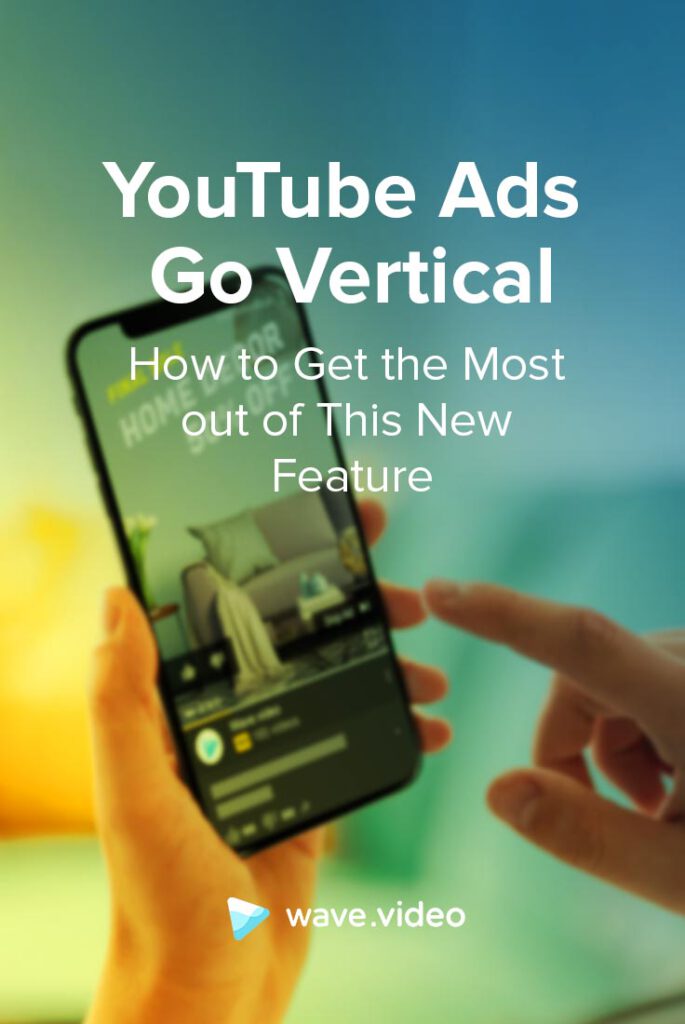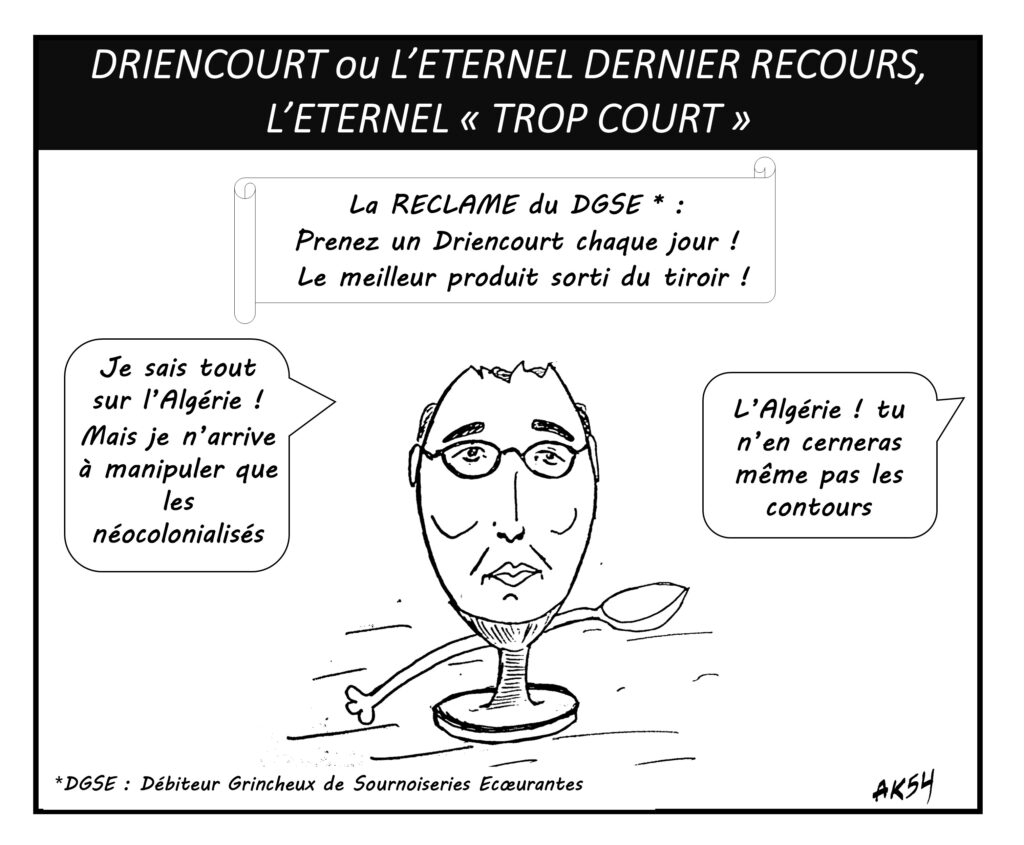Par Khider Mesloub
En France, l’échec scolaire, matérialisé par la baisse du niveau en français (notamment en mathématiques), et le décrochage scolaire, c’est-à-dire l’abandon des études, constituent un véritable fléau social. En témoigne : 44 % des jeunes en France avouent avoir rencontré des difficultés scolaires.
Par ailleurs, 12,9 % des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emplois, ni formation ou simplement déscolarisés. Certes, selon les statistiques ministérielles, le nombre de décrocheurs est en nette diminution, comparé aux années 1980 où près de 40% des jeunes sortaient de l’école sans diplôme ou avec le seul brevet.
En réalité, cette baisse est liée aux recommandations officieuses dictées aux professeurs, invités à faire preuve de « bienveillance pédagogique » en matière de notation et d’appréciation, notamment tout au long du parcours scolaire de l’élève en cycle secondaire où le redoublement ne figure plus dans les propositions ou les décisions d’orientation possibles, mais également lors de la correction des épreuves du baccalauréat. Recommandations inscrites elles-mêmes dans le cadre de la politique de la prolongation des études instituée par l’État afin d’escamoter les chiffres réels du chômage. Un jeune de 20 ans sur les bancs de la fac (sans en posséder les facultés indispensables) et non sur les bancs de touche permet d’aplatir la courbe du chômage, sans pour autant aplanir la perspective du chômage.
En France, alors que le niveau scolaire des élèves ne cesse de baisser comme toutes les études le prouvent, le nombre de bacheliers augmente curieusement d’année en année, pour atteindre 90% de réussite au baccalauréat (en 2021, le taux de réussite au bac avait atteint près de 94% et même 97,5% en filière générale. Le record absolu est de 95% de reçus en 2020, toutes filières confondues). Aujourd’hui, plus de 94 % d’une génération est susceptible d’atteindre miraculeusement le niveau du bac, contre un jeune sur dix dans les années 1960, sept sur dix dans les années 1990.
À la lumière de ces pourcentages de « réussite au baccalauréat », une conclusion s’impose. En France (au vrai, comme dans la majorité des pays), l’école capitaliste de masse est devenue une structure éducative occupationnelle, préparatoire au chômage. Mais également un espace de concentration de main-d’œuvre potentielle soustraite des statistiques du chômage. Pour leur donner l’illusion de la réussite et de la progression dans le cursus scolaire et universitaire, l’Éducation nationale distribue généreusement aux étudiants des diplômes (baccalauréat, licence, master), comme on leur fait accroire qu’ils sont montés dans le démocratique ascenseur de l’ascension sociale qui, en vertu de l’idéologique crédo méritocratique de « l’égalité des chances », les hissera au sommet du succès professionnel, de la réussite sociale.
À cet égard, il est utile de rappeler que l’école laïque française, encensée par l’ensemble du corps enseignant et la classe dirigeante et politique, érigée comme le modèle égalitaire éducatif, voie royale par excellence de la démocratie parfaite, antithèse de l’école privée qui favoriserait, elle, la reproduction sociale des élites, fut brocardée en son temps par Karl Marx « L’ »éducation populaire égale pour tous » ? Qu’est-ce qu’on s’imagine avec cette formule ? Croit-on que dans l’actuelle société (et l ‘on a affaire uniquement à elle en l’occurrence) l’éducation puisse être égale pour toutes les classes ? Ou bien prétend-on forcer les classes supérieures à se contenter de la mesquine éducation populaire des écoles primaires, éducation à laquelle seuls peuvent accéder les travailleurs salariés ainsi que les paysans, étant donné leurs conditions économiques. »
En France, le diplôme, quel que soit le cycle universitaire, est devenu la peau d’âne derrière laquelle tout un chacun dissimule son ignorance, camoufle sa vacuité intellectuelle. Tout bien considéré, si les ânes ont disparu du paysage, on comprend mieux dans quelle filière leur peau est recyclée : elle sert à fabriquer artificiellement des diplômés voués à emprunter les voies de garage. Autrement dit à stationner leur vie sociale dans la même impasse existentielle, sans perspective de démarrage d’une carrière professionnelle.
En France, comme dans l’ensemble des pays capitalistes développés, l’entrée dans la vie active s’effectue de plus en plus tardivement. Aussi, avec une perspective d’études supérieures démesurément rallongée (5 années après le Bac), et une extension du temps d’accès à un travail stable, les jeunes n’entament-ils leur carrière professionnelle qu’à un âge avancé, entre 25 et 30 ans. De sorte qu’un jeune aura passé plus de 20 ans sur les bancs de l’école pour, in fine, se retrouver sur les bancs de touche de la vie sociale. Vingt ans de débauche scolaire pour échouer à pôle emploi faute de débouché professionnel. Au vrai, la prolongation des études des jeunes est un stratagème politique destiné à escamoter le chômage endémique, artifice éducationnel désormais employé par tous les États. La massification de l’enseignement supérieur est une mystification intellectuelle. Elle ne reflète pas une augmentation significative du niveau scolaire des étudiants, aux connaissances encyclopédiques réellement de plus en plus réduites du fait de la segmentation des sciences, de la parcellisation des savoirs (et de la concurrence des réseaux sociaux, auprès desquels les jeunes viennent s’informer et, donc, se former). Cette massification est une donnée purement statistique, symbolisée par le gonflement du nombre des diplômés opéré par la politique permissive d’inscription dans le cycle supérieur. Plus que jamais la maxime (de mon cru) « l’intelligence et l’instruction ne sont pas proportionnelles au nombre d’années d’études » se vérifie avec acuité de nos jours, où le nombre d’étudiants augmente au rythme de la baisse vertigineuse du niveau scolaire. Tout se passe comme si plus ils prolongent leurs d’études, plus se rétrécit leur boîte crânienne. Plus l’Éducation nationale gonfle leurs notes, plus les étudiants deviennent des têtes de linotte.
Pourtant, pour d’évidentes raisons d’escamotage des chiffres réels du chômage, le nombre d’étudiants dans le cycle supérieur ne cesse de croître, en dépit du coût de leur scolarité. Globalement, le coût moyen d’un élève de primaire en France s’élève à 8500 euros par an, de 100 00 euros pour un élève du secondaire et de 16 000 euros pour un étudiant. Chaque année, plusieurs millions d’écoliers sont concentrés dans les établissements scolaires.
L’école s’adonne à une forme d’élevage d’étudiants en batterie opéré dans ses structures éducatives pondeuses de savoirs déficients. Chaque année elle déverse une juvénile population salariée potentielle sur le marché du travail lilliputien. Une population scolaire qui passe davantage de temps à se former que les générations précédentes. En France, comme dans la majorité des pays capitalistes développés, la durée moyenne des études a doublé. L’ironie de l’histoire, c’est que, une fois achevé leurs études, la situation sociale de la majorité des étudiants sera semblablement identique à celle des jeunes prolétaires depuis longtemps exclus du système éducatif. Ces étudiants, quoique munis de leur diplôme (peau d’âne exhibée comme un trophée), ne rentrent pas immédiatement (voire jamais) dans la vie active. Et quand certains réussissent à y rentrer, c’est par « la voie de garage », par des emplois sans issue contractuelle pérenne. Dans une société marquée par la McDonalisation et l’Ubérisation, ces étudiants intellectuellement édentés s’inscrivent dans une carrière professionnelle dentelée.
Qui plus est, à la décharge des jeunes, dans une société fondée sur la concurrence économique et la compétition professionnelle, exigeant l’adoption de la rouerie et le déploiement de « l’esprit de gagne » pour réussir, il n’est pas surprenant qu’une majorité de ces compétiteurs forcés, notamment les jeunes issus des classes défavorisées non familiarisées avec les règles du jeu du challenge social, ne parviennent pas à rivaliser avec leurs concurrents nantis. Et, par conséquent, soient broyés par un système plus favorable aux élites.
De manière générale, en France comme dans tous les pays développés, l’État prend en charge les coûts de la formation des élèves pour répondre aux besoins du capital par la fourniture d’une main d’œuvre tant soit peu éduquée et formée afin d’assurer la pérennisation de la production et l’accumulation. Ainsi, pour répondre aux besoins de la production capitaliste, l’Éducation nationale œuvre à sélectionner et à orienter les élèves en fonction de leurs compétences potentielles, mais également de leur aptitude à supporter les contraintes liées à l’école-carcérale fondée sur le respect de la discipline et de l’autorité. Ne pas oublier que l’école, avec ses règles disciplinaires, est l’antichambre de l’usine. « L’univers de la classe » ne constitue-t-il pas l’univers de toutes les privations ? de l’interdiction de bouger, de parler, de se retourner ? En fait, l’élève appartient corps et âme au personnel enseignant qui s’applique à façonner son esprit et à dompter son comportement, à lui enseigner l’obéissance, la docilité. L’école peut être assimilée à un établissement pénitentiaire. Une fois franchi le portail de l’école, l’élève perd sa liberté : il est soumis à un emploi du temps rigide, des règles disciplinaires draconiennes, assorties de sanctions ou de punitions en cas de manquement. L’école est une véritable structure pénitentiaire dédiée à la domestication des esprits, au remodelage du comportement des élèves.
En cette période de crise finale du capitalisme marquée curieusement par la massification intensive de l’enseignement supérieur sur fond de désinvestissement pédagogique et logistique, la principale vocation du système (carcéral) éducatif semble se réduire à la domestication des écoliers, à l’apprentissage des règles d’asservissement volontaire.
Fondamentalement, en France comme dans l’ensemble des pays capitalistes, au-delà d’être un conditionnement de la pensée au service du capital et de la classe dominante, l’Éducation nationale concourt plus que jamais à la reproduction sociale. L’instruction élitiste pour les enfants des classes privilégiées, destinés à occuper les emplois d’encadrement et de conception fortement convoités et socialement monopolisés. L’abrutissement pédagogique pour les enfants des classes populaires, voués à remplir les fonctions d’exécution ou les statistiques du chômage. Et en période de crise économique systémique, l’Éducation nationale de masse devient une charge financière que les gouvernants n’hésitent pas à sacrifier par la diminution des budgets alloués aux écoles comme par la réduction du personnel enseignant.
Au reste, il est utile de rappeler que, du point de vue du capital, en France comme dans la majorité des pays capitalistes, la fonction du système éducatif n’est pas d’œuvrer à la diffusion du savoir, au développement de l’esprit critique et à l’épanouissement personnel. Mais d’œuvrer, outre à la préparation au marché du travail régenté par les négriers des temps modernes (les patrons), au conditionnement de l’esprit des élèves par l’idéologie de la classe dominante, idéologie garante de la reproduction sociale et de la pérennisation du système. Comme le reconnaissait, du reste, Jules Ferry, maître d’œuvre de l’obligation scolaire (mais également promoteur des conquêtes coloniales et partisan de la répression active des colonies françaises), à l’époque où la bourgeoisie était moins hypocrite sur les réelles finalités de l’Éducation nationale : « Non, certes, l’État n’est point docteur en mathématiques, docteur en lettres ni en chimie. (…) S’il lui convient de rétribuer des professeurs, ce n’est pas pour créer ni répandre des vérités scientifiques ; ce n’est pas pour cela qu’il s’occupe de l’éducation : il s’en occupe pour y maintenir une certaine morale d’État, une certaine doctrine d’État, indispensable à sa conservation ». Hitler, Staline, et tant d’autres gouvernants contemporains reprendraient sans hésitation ces propos à leur compte, tant ils correspondent à la politique éducative de tout État moderne pour qui la morale et la doctrine étatiques constituent la pierre angulaire de la pédagogie dispensée dans les établissements scolaires.
Au vrai, dans une société divisée en classes antagoniques, tout comme le droit n’est que la volonté générale de la classe dominante érigée en Loi, la pédagogie dispensée dans les écoles n’est que l’idéologie de la classe dominante érigée en système éducatif. Du fait de leur monopolisation du capital culturel, seule l’idéologie des classes dominantes contrôlant directement l’État dispose du droit discrétionnaire de diffusion dans les écoles. Or, cette idéologie constitue le compendium des intérêts particuliers de la classe dominante, quoique cette idéologie prétende incarner l’intérêt général, représenter les idéaux de l’ensemble des citoyens.
« L ‘école est la force spirituelle de la répression », notait Karl Marx. Autrement dit, elle exerce une violence symbolique. C’est ce que confirment les travaux sociologiques de Pierre Bourdieu. « Toute action pédagogique est objectivement une violence symbolique en tant qu’imposition, par un pouvoir arbitraire, d’un arbitraire culturel », écrit Bourdieu dans son livre La reproduction. Cette violence symbolique exercée contre les élèves se manifeste par l’inculcation de valeurs et normes appartenant à la classe dominante, autrement dit l’idéologie directement liée aux rapports sociaux de domination pédagogiquement légitimés. Il est utile de rappeler que l’enfant est le dernier « colonisé » des temps modernes. « De tous les opprimés doués de parole, les enfants sont les plus muets », notait l’écrivaine Christiane Rochefort (signataire du Manifeste des 121, qui dénonçait la guerre d’Algérie. Le manifeste fut publié en septembre 1960, au moment du procès du réseau Jeanson de soutien au FLN). Autrement dit, les enfants subissent dans le silence la violence symbolique, la maltraitance pédagogique étatique (l’endoctrinement et l’arbitraire culturel), la domestication comportementale (dressage des attitudes et conditionnement psychologique), légitimées et justifiées au nom de l’éducation, de la formation de leur esprit, de la citoyenneté (bourgeoise).
Dans les périodes de crise et d’exacerbation des tensions impérialistes, caractérisées par la marche forcée vers la guerre, comme celle que nous vivons actuellement, outre la militarisation de la société, l’école endosse le rôle de sergent recruteur. Par la propagation du patriotisme belliqueux et de la xénophobie, par l’inculcation du sens du sacrifice et la caporalisation des esprits, l’école œuvre à la fabrication de « citoyens-soldats ». Elle œuvre à la défense du système, à la légitimation du durcissement autoritaire de l’État, à la glorification de la guerre, comme notre époque belliciste l’illustre.
À cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu’en France (comme dans tous les pays capitalistes développés) l’État moderne est conçu comme l’organisation centralisée des classes dominantes. Cette structure étatique, quoiqu’elle prétende représenter les intérêts généraux de l’ensemble des populations d’un pays, fonde son pouvoir sur la violence cinétique, (force armée, la police, la gendarmerie) mais également sur la violence symbolique, incarnée par l’école et les médias.
Dans la société capitaliste, notamment en France quoiqu’elle se pare de l’idéologique crédo de l’égalité des chances, l’école a pour mission éducative de légitimer les inégalités sociales et les disparités culturelles. Et corrélativement à œuvrer à la reproduction du système fondé sur la hiérarchisation des classes. Autrement dit, à œuvrer au conditionnement et au domptage des élèves en fonction des exigences de la production de marchandises, de la valorisation du capital, des besoins de main-d’œuvre, tout cela sur fond de la sacralisation du dogme de la soumission du travail au capital (symbolisé par la sanctification de la propriété privée, notamment celle des moyens de production).
L’école n’est pas une œuvre de philanthropie pédagogique mais d’atrophie des facultés réflexives. Comme le notait déjà Marx : « L’inégalité des connaissances est un moyen de conserver toutes les inégalités sociales que l’éducation générale ne fait que reproduire d ‘une génération à l’autre ». En effet, l’école, fondée sur la compétition et le culte de la performance dont seuls les nantis en maîtrisent (et détiennent) les règles, n’a pas pour mission éducative d’effacer les différences sociales mais, au pire de les accentuer, au moins de les maintenir. Ainsi, les classes privilégiées s’accaparent non seulement les richesses et le pouvoir étatique qui assure la sécurité de leur domination, mais également le capital culturel et scolaire, en d’autres termes tous les authentiques et lucratifs savoirs qui garantissent leur suprématie intellectuelle et hégémonie culturelle, tremplins pour leur domination politique et leur contrôle de la société formée d’une population délibérément crétinisée.
Toute classe dominante ne vise pas à éclairer la lanterne intellectuelle du peuple, mais à éteindre sa lumière réflexive. Pour en faire un baudet politique. Des bêtes de somme. Des ânes, en somme. Parlant du peuple, Victor Hugo notait : « Le peuple ? Un âne qui se cabre ! ». Nous ajouterons : qui joyeusement se sabre (s’auto-décapite intellectuellement).
En tout état de cause, ces dernières décennies nous assistons, en France comme dans la majorité des pays, à une véritable entreprise de crétinisation des écoliers dans le système éducatif de masse. Cette crétinisation correspond à la réalité objective de la société capitaliste contemporaine fondée sur l’automatisation et la numérisation, par ailleurs société en proie à une crise multidimensionnelle systémique. Ce qu’attendent désormais les patrons des nouvelles recrues, c’est moins la possession d’une culture générale que la maîtrise des savoirs opératoires de base. C’est moins un esprit encyclopédique qu’une cervelle rompue aux rudimentaires technologies numériques, néanmoins assorties de l’intériorisation des valeurs relatives au respect de l’ordre social et de la hiérarchie inhérente à l’univers de l’entreprise capitaliste.
Les peaux d’âne (diplômes) généreusement décernées par l’Éducation nationale servent uniquement à flatter l’ego d’individus narcissiques pétris d’ignorance, ces idiots utiles du système capitaliste décadent, ravis de monnayer leur servitude volontaire sur le marché de l’esclavage salarié. Marché qui, manque de peau pour ces esprits chagrins pourtant auréolés de leur peau d’âne, ne cesse de rétrécir comme peau de chagrin.
Le romancier américain William Faulkner a écrit : « Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin ». Les étudiants contemporains ont choisi et le néant et le chagrin. Il ne faut pas s’étonner de vivre dans une société capitaliste régressive et dépressive.