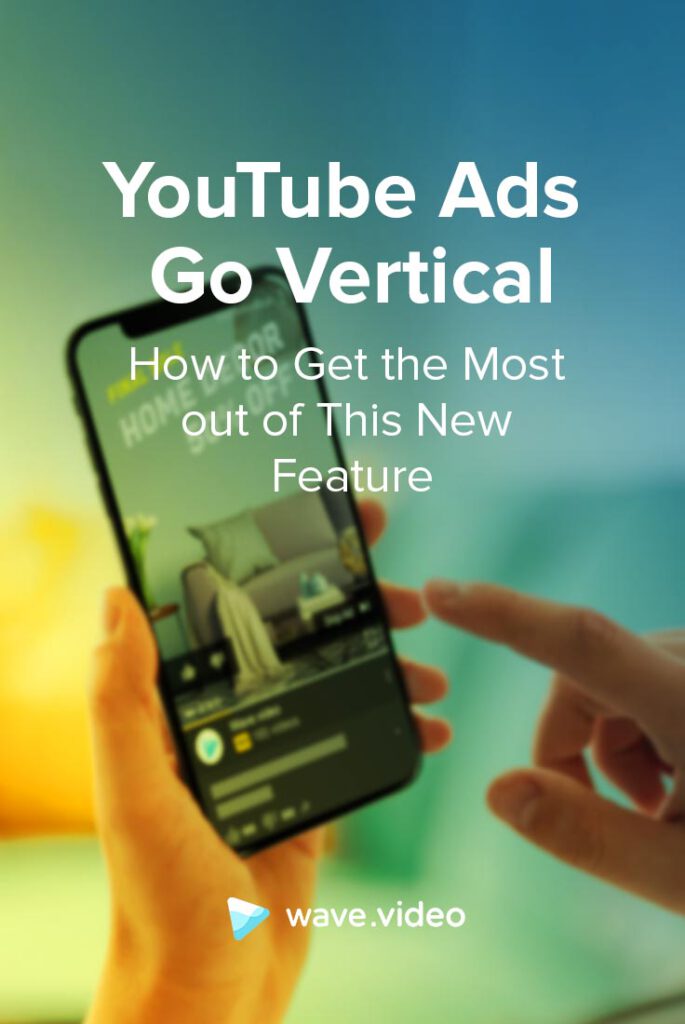Par Khider Mesloub
Le capitalisme a transformé la vie en champ de bataille où chaque individu est devenu un soldat en guerre permanente contre tous les autres humains également métamorphosés en soldats individuels du capital.
Si autrefois le champ symbolisait pour nos aïeux un havre de paix de l’existence et d’approvisionnement de nourriture, le capitalisme a transformé le champ d’existence en guerres permanentes détruisant la nourriture relationnelle humaine.
L’homme contemporain, rassasié matériellement, a faim d’humanité, dévorée par le capital qui se nourrit uniquement de la production anarchique de marchandises, de l’extraction effrénée de la plus-value, de l’accumulation insatiable de profits.
Loin des champs des réelles guerres permanentes répandues dans tous les continents, on croit vivre en temps de paix au sein d’une communauté humaine pacifiée. En vérité, sous le capitalisme, c’est le règne de la guerre protéiforme permanente, interétatique et interindividuelle : au sein des entreprises (lieu de bataille entre patrons et travailleurs autour de la plus-value), entre entreprises (guerre économique pour les marchés), au sein des pays (guerre de classes entre bourgeois et prolétaires), entre pays (guerre militaire), au sein de la famille (conflits conjugaux et intergénérationnels), entre familles (batailles patrimoniales), au sein de l’individu (rendu dépressif par le système capitaliste pathogène), entre individus (quotidiennement sous tensions et en conflits).
Un auteur chinois a dit : « Comme un long fleuve la vie n’est magnifique qu’en offrant de multiples méandres ». Le capitalisme a transformé ce sage aphorisme en belliqueuse sentence : « Comme un long fleuve la vie n’est jouissive qu’en offrant de torrentielles guerres chroniques ». Le capitalisme a adopté la doctrine de Sun Tzu, un général chinois du 6ᵉ siècle avant notre ère, auteur de « L’art de la guerre ». Doctrine selon laquelle il n’existerait pas de distinction entre les périodes de paix et de guerre. Aussi la guerre est permanente. Notamment la guerre de classe. Et l’acmé n’est pas la lutte armée, mais le fait de soumettre l’ennemi (d’assujettir et de dominer une classe sociale) sans combattre. En lui livrant une guerre psychologique d’attrition visant à lui ôter toute forme de résistance.
Pour sa part, un artiste italien fasciste, pour qui la guerre est une œuvre d’art totale, a écrit : « La guerre, seule hygiène du monde ». Dans la société capitaliste excrémentielle, les hommes, pour se soulager de leur merdique vie, se font dorénavant la guerre comme ils font naturellement leur besoin.
Quant au philosophe allemand, Hegel, produit du capitalisme naissant, il a écrit le plus sagement du monde, sans éprouver le moindre scrupule moral, en guise d’axiome à destination de la nouvelle classe dominante, la bourgeoisie : « La guerre préserve la santé morale des peuples ». Une chose est sûre, elle préserve surtout la santé corporelle et financière des bourgeois, puisqu’ils vivent la guerre en spectateurs, depuis leurs palais et maisons cossus. Dans le cas de Hegel, elle constitua assurément son adrénaline réflexive. Cet immoral et belliqueux postulat hégélien est devenu la conduite de gouvernance de tous les États capitalistes occidentaux qui ont contraint leurs respectifs peuples à s’entretuer sur les champs de guerre à de multiples reprises au cours des deux siècles écoulés, notamment lors de 1914-1918 et 1939-1945, où presque 100 millions de personnes ont été décimées. Ou à livrer des guerres de conquête coloniale à des dizaines de peuples africains, maghrébins et asiatiques.
Sous le capitalisme, comme en temps de guerre où les soldats partent combattre la fleur au fusil, heureux d’être équipés de la technologie de mort, au mépris de leur vie et, surtout, de celle des autres belligérants, pareillement chair à canon joyeuse, les individus de la société moderne sont dressés, à leur insu de plein gré, à vivre en guerre permanente. Avant tout, ils sont ravis d’être de la chair à exploiter. Pour preuve : ils consentent à sacrifier un demi-siècle de leur vie dans le travail aliénant. Certes ils ne partent pas au bagne industriel, administratif ou tertiaire pour besogner la fleur au fusil, mais allégrement et benoîtement avec l’antidépresseur et l’anxiolytique dans les veines, ces béquilles du bonheur chimique, pour lubrifier les rouages ankylosés de leur machine existentielle détraquée par l’aliénation professionnelle.
Comme en temps de guerre où tout le monde communie dans la fibre patriotique, sans avoir conscience d’être l’objet de manipulation politique par leurs gouvernants, ces individus vivent leur exploitation et leur oppression dans la ferveur et la liesse, au grand plaisir et bénéfice du capital.
« La guerre est la souffrance des humbles, mais le divertissement des puissants ». De même, le travail salarié est l’aliénation des prolétaires, mais l’enrichissement des capitalistes. Par le travail salarié le prolétaire livre la guerre à son corps et à sa psyché, graduellement détruits à force d’exploitation forcenée de ces deux fondements constitutifs de son être aliéné au capital.
Si, en temps de guerre, la norme c’est la guerre, où la promesse c’est la victoire, le moyen la chair humaine, en temps de répit d’économie « pacifiée », la règle c’est la guerre économique, la promesse c’est les gains (la plus-value pour le capital, la consommation, l’acquisition des biens pour le soldat-salarié) ; le moyen, c’est tout un chacun (chair à exploiter).
La corrélation entre les deux moments de vie similaires se niche dans le conditionnement culturel et pédagogique ayant balisé le chemin vers la guerre, la normalisation de la mentalité belliciste opérée par l’Éducation et les médias. Dans les deux contextes, la vie est un champ de bataille, un terrain de conflits permanents.
Tous les matins, chaque soldat-salarié se lève pour partir (faire) à la guerre économique. Comme en temps de guerre où les routes pullulent de soldats prêts à livrer bataille, en temps d’économie « pacifiée », les soldats-salariés envahissent quotidiennement les routes avec leurs voitures (ou dans les bus) pour aller prendre position dans l’entreprise afin de mener la bataille de la production effrénée et des parts de marché convoités, au grand contentement de la Majesté le Capital, qui tire profit, au double sens du terme, du travail salarié et aliéné.
Si, en temps de guerre, le soldat est l’outil et le moyen de la violence déchaînée, en temps d’économie « pacifiée », les travailleurs sont l’instrument et le moyen du capitalisme débridé. Sans ces soldats salariés interchangeables aliénés, ni la guerre ni le capitalisme n’existeraient. Comme l’écrit Étienne de la Boétie : « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genou » (à trimer pour eux et à faire leurs guerres).
On nous assène qu’il faut gagner sa vie à la sueur de son front. Cette maxime péremptoire consonne comme un obus avec cette recommandation militaire : il faut être fier de perdre sa vie sur le front. Dans les deux circonstances, on gagne ses galons une fois seulement avoir sacrifié sa vie sur les fronts respectivement de la sueur laborieuse exsudée par l’exploitation, et du suaire oblatif vomi par les guerres : la tombe de l’inconnu pour le soldat, la retraite tombale pour le salarié.
C’est avec les prolétaires que les riches se font poliment la guerre. Mais c’est avec les guerres quotidiennes que les riches défont politiquement les prolétaires. Les tensions et conflits permanents entre individus, attisés et entretenus par le système capitaliste par essence belligène, desservent les intérêts du prolétariat, désarment leur puissance de riposte, épuisent leurs ressources de combativité collective, dissolvent leur vigueur intellectuelle et ardeur réflexive.
Sous le capitalisme, l’ancien esprit de combativité a été détourné de ses fins. Comme l’écrit Guy Debord : « maintenant l’homme cesse de pouvoir ressembler aux combats de son père ou de son grand-père, il doit être étroitement accordé à l’image prosternée du présent éternel de la soumission à l’argent ».
Victimes de cet esprit oblatif (militaire) inhérent à toute société de classe, dominée par la mentalité grégaire, les soldats salariés perdent leur vie à la gagner sur le front du travail aliénant et destructeur.
Pourquoi acceptons-nous de nous lever chaque matin pour partir joyeusement à la guerre capitaliste ? Car elle est devenue la norme et la culture communes. Par la puissante force de l’endoctrinement idéologique, l’individu ne conçoit pas une autre réalité, un autre mode d’existence solidaire et pacifique, fondé sur la satisfaction des besoins humains et non le profit. Sous le capitalisme, la Barbarie, par le conditionnement des esprits, a pris le visage d’humanité : aussi tout le monde croit que la barbarie capitaliste est la normalité. Comme si la maladie, qui aurait remplacé la santé sous l’effet d’une contamination causée par un système pathogène contrôlé par une puissance méphistophélique, devenait la norme de la vie. La Barbarie capitaliste s’est affublée du visage d’humanité, car le capitalisme a réussi le tour de force à la transformer en normalité.
Tout un chacun appréhende la réalité uniquement par le prisme du capital logé et incrusté dans son cerveau, si on peut appeler cette chose cerveau, malléable à souhait et aliénable à vil prix, pour qui la promesse d’une maison, d’une voiture ou d’un smartphone justifie toutes les compromissions, trahisons, dépravations morales. Même si, la maison, la voiture et le smartphone ne lui appartiendront réellement jamais, mais à la banque (qui nous vend notre existence à crédit).
À l’instar de l’entreprise où il trime comme un esclave du matin au soir, le produit ne lui appartiendra jamais. Au contraire, à la moindre fâcheuse conjoncture financière ou fluctuation économique l’entreprise le congédie comme un kleenex usagé.
Pourtant, il arbore toujours de la fierté d’aliéner sa vie à une entreprise qui lui vend l’espoir d’avoir la possibilité de s’endetter pour acheter sa vie à crédit pour le grand profit des banquiers. Pauvre prolo ! Il se croit libre. En réalité il est pressuré et par son patron, et par ses banquiers, et par ses créanciers.
À la guerre comme à l’usine. Acheter son existence à crédit est le summum de l’aliénation. Tu crois posséder des biens, mais en réalité tu es possédé par les biens. Tu es doublement esclave de la marchandise. Tu la produis sans te l’approprier (elle demeure propriété du capitaliste détenteur des moyens de production). Tu l’achètes ensuite à crédit (elle demeure potentiellement la propriété du banquier en cas de défaillance de paiement).
L’avenir incertain et chaotique est la seule perspective existentielle offerte dans le monde capitaliste. Dans cet univers impitoyable de l’économie libérale anarchique, les promesses n’honorent jamais l’avenir de leur présence. L’avenir se languit toujours de l’absence des promesses au banquet de l’existence qui rate constamment son rendez-vous avec le bonheur, valeur inconnue dans le monde capitaliste. Car le capitalisme ne reconnaît qu’une seule valeur, la valeur marchande, un seul bonheur frelaté, la solvabilité.
L’insécurité est le mode d’existence du capitalisme. Le capitaliste vit constamment avec la peur de la mévente, l’absence de réalisation de la plus-value. Le travailleur vit avec la hantise de la rupture de son contrat d’esclavage-salarié, nommé par euphémisme chômage. Ces épées de Damoclès suspendues au-dessus de la tête de tous les individus aiguisent leur tempérament agressif en le rendant encore plus tranchant, plus sanglant. La société devient à leurs yeux, emplis de hargne et de haine, une arène de combat, où tous les coups (bas) sont permis.
La méfiance et la défiance leur servent de bouclier dans leurs frontales relations. Les échanges entre individus atomisés et lobotomisés (car l’expression courante millénaire « relations humaines » est inappropriée pour qualifier le mode de communication usuel au sein du capitalisme) sont marqués par des rapports mercantiles. L’intérêt encadre leurs relations. La cupidité anime leurs intentions. Le profit guide leurs attentes. Comme sur un marché où dominent uniquement les échanges marchands, dans la société les relations sont également régies par des rapports marchands. On se juge. On se jauge. On évalue nos valeurs pécuniaires respectives pour décider si la relation est profitable et rentable.
La suspicion commande toutes les relations. L’innocente fraternité, la gratuité sentimentale, la pureté amicale sont suspectes aux yeux de la majorité d’individus façonnés par la mentalité cupide. Pour eux, tout échange suinte le parfum d’une transaction lucrative, sent l’odeur monétaire.