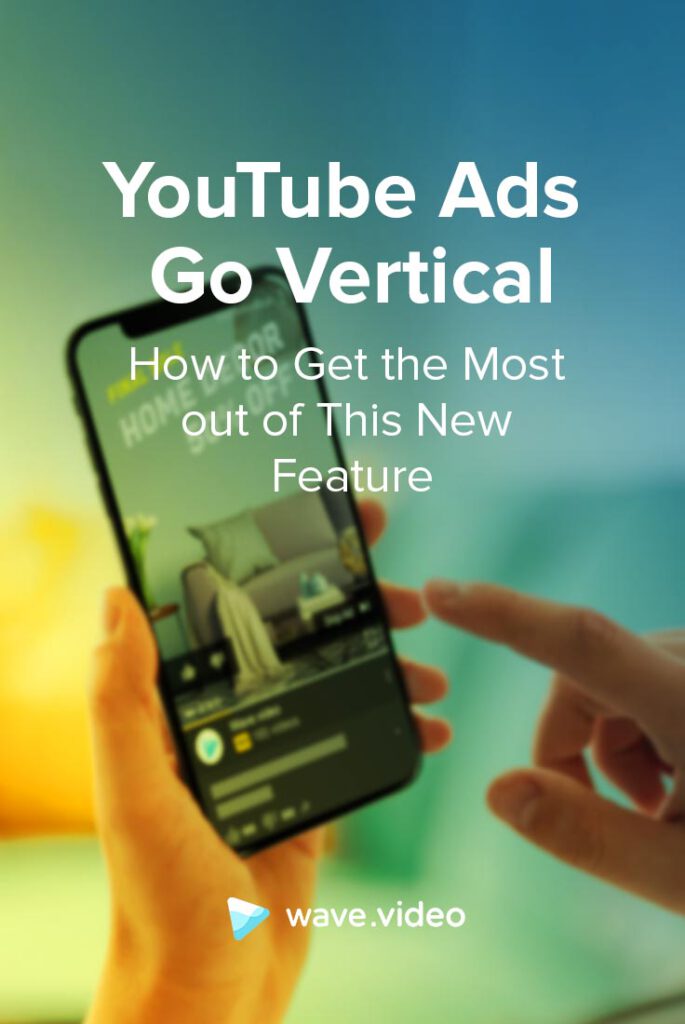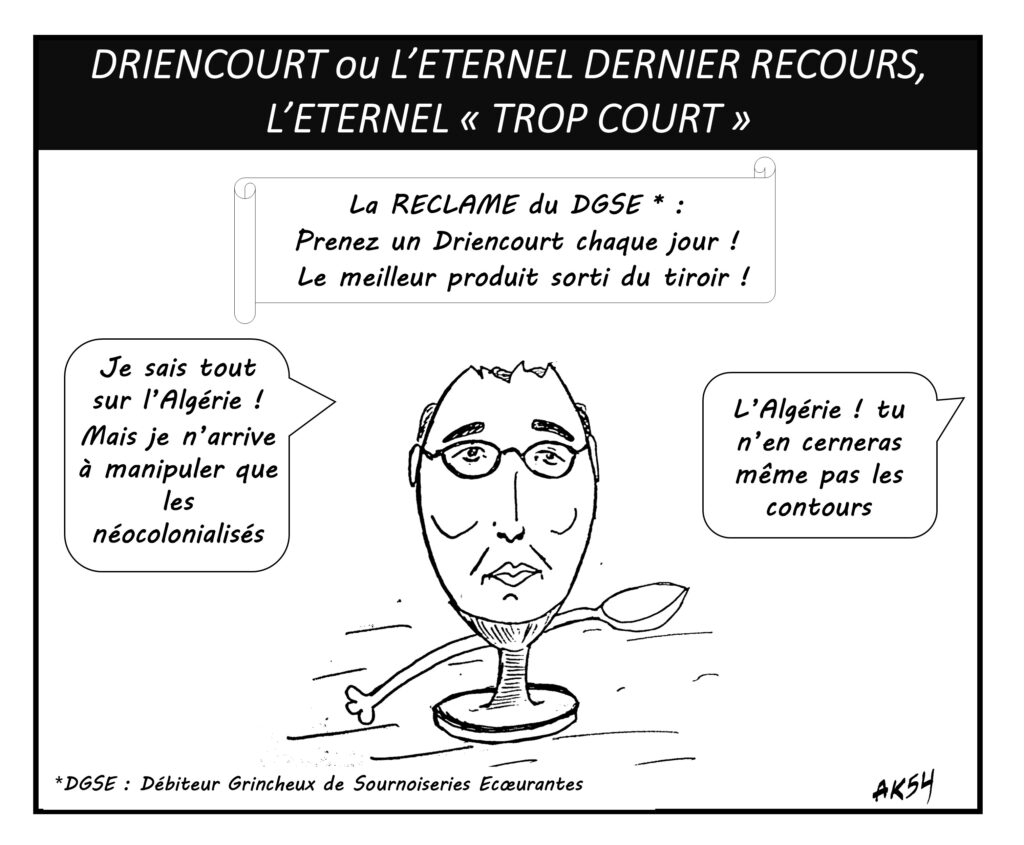Par Abdellali Merdaci
Dans la presse de ces dernières semaines, le commentaire sur la littérature algérienne de langue française de la période coloniale et, aussi, d’aujourd’hui est un enchaînement de certitudes que rien ne devrait briser. Après avoir découvert, avec indignation, les articles de l’agence de presse gouvernementale Algérie presse service (APS), commémorant dans un cérémonial d’un autre âge, les parcours d’Assia Djebar et de Mouloud Feraoun, je lis dans l’édition du jeudi 17 mars 2022 du quotidien de M. Abrous Outoudert que les écrivains « Mouloud Feraoun et Jean Amrouche incarnaient, à eux deux, l’intelligence et la création intellectuelle de l’Algérie combattante » (1). En vérité, réunir ces deux noms tient de l’exceptionnel, car Jean Amrouche a été depuis bien longtemps perdu pour la France alors qu’il n’a jamais appartenu à l’Algérie indépendante.
Hassane Ouali, qui signe cette affirmation en marge de la commémoration de l’anniversaire de la disparition de ces deux écrivains, en a-t-il préalablement vérifié la validité ? Il ajoute : « Porteurs d’une vision universelle de la lutte de libération et surtout d’une société plurielle et ouverte, ‘‘Le Fils du pauvre’’ et ‘‘L’Éternel Jugurtha’’ ont su montrer au monde entier que les maquis de la libération étaient avant tout des maquis de la pensée moderne et d’inspiration humaniste ». Évidemment, dans les faits, tout cela n’est pas vérifiable. Hassane Ouali prête ad libitum aux deux écrivains des intentions qui n’étaient pas les leurs. Ni Jean Amrouche ni Mouloud Feraoun n’ont été les voix des maquis.
Je ne ferais pas l’offense à Ouali de ne pas savoir ce que sont la guerre et les maquis, leurs morts, leurs deuils et le regard aveugle des survivants. Dans l’histoire de la littérature mondiale, plusieurs écrivains ont pris le chemin des tranchées pendant les deux guerres mondiales du XXe siècle. Et, dans cette « guerre des mondes », la Grande Guerre (1914-1918), qu’annonçait Marcel Proust, malade et alité, beaucoup n’en sont pas revenus. En France, Charles Péguy, « tué à l’ennemi », en 1914, ne donnait pas que son corps à la guerre, mais aussi la promesse d’une œuvre intellectuelle, déjà saluée. Et avec lui, Alain-Fournier, l’auteur du « Grand Meaulnes » (1913), Louis Pergaud (« La Guerre des boutons » – 1912 – dont le classement est aujourd’hui révisé par les Français). Cette foudroyante tuerie, Maurice Genevoix, Henri Barbusse (Prix Goncourt 1916 pour « Au feu »), Roland Dorgelès, Guillaume Apollinaire (trépané, puis emporté par la grippe espagnole, en 1918), Louis-Ferdinand Céline, Drieu La Rochelle, Jean Giono, Georges Bernanos, Mohamed Bencherif (Algérie ; « Ahmed Ben Mostapha, goumier », 1920), Bakary Diallo (Sénégal ; « Force-Bonté », 1926), en sont revenus la chair et, surtout, l’âme cisaillées d’échardes. Et derrière eux, Louis Aragon et André Breton, dans l’infirmerie, témoins d’une curée qui ébranlera leur conviction d’une civilisation d’Occident, irrémédiablement faillie. Sentiment partagé par Américain Ernest Hemingway, le Britannique J.R.R. Tolkien, les Italiens Curzio Malaparte et Gabriele d’Annunzio, les Allemands Ernst Jünger et Erich-Maria Remarque, le Suisse Blaise Cendrars (qui y laissera une main). La Seconde Guerre mondiale comptera aussi ses écrivains, comptés en centaines, parmi les engagés volontaires, les mobilisés, les survivants (André Malraux, Romain Gary, Vercors, Louis Aragon, Paul Éluard, mais aussi le Russe Vassili Grossmann, le Japonais Nakajima Atsushi, l’Algérien Mouloud Mammeri) et les victimes (Paul Nizan, Robert Desnos, Jean Prévost, Max Jacob, Antoine de Saint-Exupéry, Irene Nemirovsky, Anne Frank). D’une violence à l’autre, le sentiment de la guerre de ceux qui écrivaient – Anne Frank était une adolescente juive de seize ans, morte dans un camp de concentration – importait peu : la littérature a toujours marché au côté de l’Histoire de l’Humanité pour en être éprouvée.
La guerre des Algériens
En Algérie, pendant la guerre anticoloniale (1954-1962), les romanciers, tous les romanciers, à l’exception de Mouloud Feraoun, s’en sont préservés, choisissant le repli en France ou en Europe (Allemagne, Belgique, Suisse). L’honneur de la littérature algérienne a été porté et assumé jusqu’au bout des cruautés de la guerre par la poésie, ses poètes et, surtout, ses poétesses, sur le front des hostilités. Nommons-les, parce que leur engagement à la fois militant et littéraire est déjà oublié : Nadia Guendouz, Malika O’Lahsen, Leïla Djabali, Anna Greki, Z’hor Zerari, Danièle Amrane, Annie Steiner, Djamel Amrani, Laadi Flici, Ahmed Taleb-Ibrahimi ont écrit derrière les murs de leurs prisons en Algérie et en France. Mais aussi, avec eux, à l’arrière, Hocine Bouzaher, Jean Sénac, Malek Haddad, Nordine Tidafi, Kaddour M’hamsadji, Mourad Bourboune, Jean Amrouche, Tewfiq Farès, M’hamed Aoune, Abdelhamid Baïtar, Kateb Yacine, Henri Kréa (qui reviendra, malheureusement, assez vite à la France). Le seul poète de langue française appartenant aux maquis de la Guerre d’Indépendance a été Boualem Taïbi (« Frère ! Lève les yeux au ciel bleu d’Algérie ! Et rends-toi compte qu’il manque une étoile et qu’il faudra l’y mettre demain… », « Guérilla », maquis de Kabylie, 1956).
Des romanciers ont apporté leur contribution plus civile que militante au FLN et au Gouvernement provisoire de la République algérienne, ainsi Assia Djebar, en Tunisie aux côtés de son futur mari, engagée dans des opération d’alphabétisation des réfugiés algériens sur la frontière tunisienne, Mouloud Mammeri, membre des réseaux « libéraux », à Alger puis au Maroc, Malek Haddad après sa rupture d’avec le PCA, en Europe de l’Est, Mohammed Arabdiou, ouvrier syndicaliste en Allemagne et en Belgique. Djamila Debêche fera le choix radical de la France, mettant en avant l’émancipation sociale des Indigènes algériens sous l’égide de la France avant leur affranchissement politique, rejetant l’hypothèse de l’État national algérien. Lorsque Kateb Yacine avait revêtu sur les routes d’Europe et d’Asie les habits élimés de compagnon de route du communisme international, d’autres se sont tus ou ont simplement déserté face aux fracas de l’Histoire. Ils auront manqué à l’appel de la grande espérance de liberté pour laquelle des Algériens et des Algériennes mouraient.
Je ne connais pas d’écrivain algérien, dont l’œuvre est née et a grandi dans les maquis, qui soit mort dans les soubresauts de la guerre, l’arme à la main. Ni d’écrivain, passionnément idéologue. Peut-être Frantz Fanon ? Sur cette personnalité particulièrement attachante de l’Algérie en guerre d’indépendance, je rejoins Hassane Ouali : nous n’avons pas seulement oublié Fanon, nous l’avons abandonné volontairement au moment où la France, après les Américains et leurs « études postcoloniales », veut l’inscrire au bilan de sa littérature et de sa pensée, et le réinsérer en Martinique (2). Je garde le souvenir d’une photographie jaunie de l’intellectuel Fanon et du colonel Houari Boumediene, à Ghardimaou. Discutaient-ils déjà des thèses qu’allait développer Fanon dans « L’An V de la Révolution algérienne » (1959), puis dans « Les Damnés de la terre » (1961) ? Notamment de la Révolution des paysans en armes ?
Pour son déshonneur, la France en guerre d’Algérie, ses soldats, ses gendarmes, ses policiers et ses milices ont pratiqué non seulement la torture mais aussi des mises à mort extrajudiciaires (Larbi Ben M’hidi, Ali Boumendjel, Maurice Audin et de nombreux martyrs abattus dans d’atroces exécutions dites « corvées de bois »). C’est cette mort, en dehors de toute morale, qu’ont reçue nos écrivains. Des écrivains militants, particulièrement de langue arabe, ont été tués par l’armée française et par ses commandos irréguliers. Ahmed-Réda Houhou (1910-1956 – « Avec l’âne de Hakim », 1953) et le dramaturge Tewfiq Khaznadar (1921-1956 – « Les Oiseaux de proie », 1953), militants nationalistes, enlevés et assassinés à Constantine par une milice de l’armée française, la sinistre « Main rouge ». Rabia Bouchama (1916-1959) et Abdelkrim Aggoune (1918-1959), poètes de l’« âme algérienne », sortis des rangs de ouléma, sont tombés dans les mêmes conditions à Alger, en 1959, sous les balles de l’armée coloniale.
Mais, pour l’historien de la littérature algérienne, il ne saurait y avoir d’exclusion dans ses rangs d’écrivains qui ont fait le choix – ou ont été contraints – de lutter contre leur peuple (3). Abattus par le FLN, le poète et essayiste de langue arabe Saïd Zahiri (1899-1956 – « En visite chez Sidi Abed », 1933), le romancier et essayiste de langue française Cherif Benhabilès (1885-1959 – « L’Algérie française vue par un Indigène », 1914 ; « Âmes-frontières », 1930), le poète de langue arabe Abdelali Lakhdari dont les langoureuses complaintes d’alcôve, mises en musique par Abdelhamid « Erraïs » Benelbédjaoui, sont toujours chantées à Constantine, farouches « amis de la France », proches de l’administration coloniale, chus sous le couperet du « nidham ».
Si le souvenir d’Ahmed-Réda Houhou et de Tewfiq Khaznadar reste vivant et révéré à Constantine, je ne sais pas Si Alger a gardé au fronton de ses rues et de ses établissements de culture la mémoire de Rabia Bouchama et d’Abdelkrim Aggoune. Ces hommes de lettres, qui ont dans leurs mots sublimé le message de la liberté, qui en sont morts, n’appellent-ils pas la reconnaissance de la patrie ? Celle qui est, paradoxalement, consentie à Mouloud Feraoun, à l’homme et à l’écrivain.
Je voudrais m’en expliquer. Contrairement à ce qu’écrit Hassane Ouali, qui trompe ses lecteurs en toute conscience ou par ignorance, Mouloud Feraoun, résidant en Algérie, à Fort National (Larbaâ Naïth Irathen), puis Alger, pendant la guerre anticoloniale, et Jean Amrouche, qui a pu avoir pendant et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une position de premier plan dans le champ littéraire germanopratin, n’était pas retourné en Algérie dans les années 1950, n’avaient l’un et l’autre aucun lien organique avec les maquis de l’ALN, le mouvement national indépendantiste incarné par le FLN et leur Gouvernement provisoire, à Tunis. De leur vivant, ils ne s’en sont pas prévalus. Il n’y pas d’histoire littéraire (ou politique) qui puisse s’écrire par le mensonge, alors disons les faits brièvement :
1°) Jean Amrouche a été depuis l’installation, en 1943, du gouvernement de la France libre, à Alger, dans la proximité politique et intellectuelle du général de Gaulle. Le chef de la France libre avait-il appuyé sa candidature (soutenue par André Gide) à la direction de la revue « L’Arche » (domiciliée à A1ger, puis Paris), contre celle de Robert Aron ? Dans son « Journal » (4), Gide rapporte un aparté avec le général de Gaulle, vers la fin mai-début juin 1943, qui venait installer à Alger, le Comité français de Libération nationale (CFLN). Ils ont parlé d’une alternative à la « La Nouvelle Revue française » (NRF) compromise, sous la direction de Pierre Drieu La Rochelle, avec le nazisme et la collaboration pétainiste, pour remembrer la culture littéraire française. Le nom d’Amrouche a-t-il été prononcé à cette occasion ? De Gaulle s’en rappellera au moment de restructurer, à Alger et à Paris, la Radio française, voix de la France libre. Les idées du général étaient aussi, à cette époque, celles du traducteur des chants profonds de Kabylie (« Chants berbères de Kabylie », 1939) : dans un article de « La Tunisie française littéraire », Amrouche écrivait : « La France adopte les peuples plus qu’elle ne les conquiert, elle soumet pour libérer, elle impose pour associer » (17 juillet 1941). Longtemps, jusqu’au lendemain du 1er-Novembre 1954, Jean Amrouche restait fidèle à l’idée d’« Empire français » exposée par le général à Brazzaville, le 30 janvier 1944. Mais le thème de « l’Union française », dernier habillage de la colonisation française au Maghreb, en Afrique occidentale et équatoriale française s’effritait.

Jean Amrouche, journaliste et écrivain catholique français, a mené de pair des carrières strictement parisiennes : il s’élèvera à la responsabilité de rédacteur en chef de la Radio française tout en échouant dans ses projets d’écriture littéraire, notamment romanesques. Il évoluera certainement dans ses positions politiques pendant la guerre d’Algérie, sans illusion sur le jusqu’au-boutisme colonial. Le général de Gaulle, qui l’avait sollicité pour l’aider à écrire quelques pages de ses « Mémoires » sur la reprise de la radio française après la Seconde Guerre mondiale, l’avait-il, à son retour aux affaires en 1958, requis pour poser les premiers contacts secrets avec le Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA) ? Le fait a été maintes fois évoqué par des historiens et des témoins de l’époque.
Qui mieux qu’Amrouche pour ce rôle d’intermédiaire entre les belligérants français et algériens ? Il a rencontré Ferhat Abbas, en 1946, au cours d’un séjour d’information sur les événements de Sétif, Guelma et Kherrata, et a maintenu le contact avec celui qui deviendra le premier président du GPRA. Il connaissait aussi Ahmed Boumendjel, un des fondateurs de l’UDMA, proche d’Abbas, futur ministre de l’Algérie indépendante dans le premier gouvernement Ben Bella, qui a été comme lui dans les années 1930 un collaborateur de « La Voix des Humbles », organe des Instituteurs algériens d’origine indigène (5). Jusqu’aux lendemains de Novembre-1954, Jean Amrouche était résolument Français et El Mouhoub, Kabyle, avouant dans une conférence de 1958 : « Je ne peux pleurer qu’en kabyle » (6).
À quel moment s’était réalisé, au cœur d’une guerre sanglante, sa mue, se sentant et se projetant nettement Algérien ? Il a mérité de l’Algérie indépendante par un poème, un seul poème, que l’École algérienne n’enseigne plus à ses élèves : « Le Combat algérien » (1958) ; en voici les derniers et symptomatiques vers :
« Nous voulons la patrie de nos pères
La langue de nos pères
La mélodie de nos songes et de nos chants
Sur nos berceaux et sur nos tombes
Nous ne voulons plus errer en exil
Dans le présent sans mémoire et sans avenir
Ici et maintenant
Nous voulons
Libres à jamais sous le soleil dans le vent
La pluie ou la neige
Notre patrie : l’Algérie. »
Le poète a-t-il seulement prêté ses mots aux Algériens qui avaient tout perdu, leur langue et leurs rêves d’espoir ? Il était Français et Algérien dans une histoire qui finissait, à laquelle il avait cru. Il mourra le 16 avril 1962 : les pays qu’il a aimés, la France et l’Algérie, l’ont oublié. Je ne crois pas qu’il faille, à l’instar de Hassane Ouali, lui dresser une encombrante statue et une présence dans la Guerre d’indépendance des Algériens dans laquelle il ne s’était pas engagé, tout en la commentant fiévreusement (7).
Dans les années 1950, le ralliement de Jean Amrouche, rédacteur en chef de la Radio française et personnalité de la littérature française, au combat libérateur des Algériens, aurait eu, dans le monde, plus d’intensité et de répercussions que mille bombes enflammant le Milk bar et les lieux de plaisir de la société coloniale. Non, Jean El Mouhoub Amrouche n’a pas rejoint l’Algérie combattante ; il n’en a pas été l’idéologue proclamé. Pourquoi prétendre le contraire : l’Algérie est plus dans l’attente d’une histoire, fut-elle tranchante, de sa littérature que de mythes trompeurs.
Précisons ceci à l’intention de Hassane Ouali et de contributeurs du quotidien de M. Outoudert qui ont fait du poète kabyle une rente académique : ce ne sont pas les Algériens qui ont minoré le nom et l’œuvre de Jean Amrouche, qui l’ont fait entrer dans l’oubli, mais ses nombreux ennemis dans les champs littéraire et universitaire français. Qui a écrit depuis la fin des années 1950 et qui domine, jusqu’à nos jours, l’écriture de l’histoire de la littérature algérienne de langue française ? Les Français, critiques et historiens de la littérature, qui ont rejeté radicalement Amrouche en raison de son positionnement dans le champ littéraire germanopratin, de son rôle fondamental dans la reprise littéraire française après la Seconde Guerre mondiale en sa qualité de critique et d’éditeur (Charlot) et ami et interlocuteur privilégié de grands écrivains (André Gide, François Mauriac, Giuseppe Ungaretti, Paul Claudel, Jean Giono, Patrice de la Tour du Pin), et de la guerre d’Algérie : ils l’ont écarté de toute légitimité littéraire et chassé de son poste de rédacteur en chef de la radio française . Dans les histoires littéraires de la France depuis les années 1960, même dans celles conçues sous les auspices de la très catholique Faculté libre des Lettres de Paris, sous la direction de Mgr Calvet, Feraoun, Dib, Djebar ont droit à une citation, mais pas Amrouche. Il est mort en portant les stigmates de la marginalisation, plus douloureuses que le mal qui le frappait.
L’Université algérienne, sans courage et sans probité intellectuelle, qui ne fait que répéter les diktats de ses maîtres français, n’a pas défendu le poète et diariste kabyle. Ceci dit, Jean Amrouche devrait revenir grandi, reconnu et honoré dans son seul pays, aux racines vives, l’Algérie. Assez tôt, alors que la France, à laquelle il n’aurait jamais renoncé, avait rappelé ses contingents de réservistes et enrôlé de centaines de milliers d’appelés pour prolonger la guerre coloniale, Amrouche exprimait contre la puissance des armes la promesse d’une Nation : « Je suis Algérien, c’est un fait de nature. Je me suis toujours senti Algérien. Cela ne veut pas seulement dire que je suis né en Algérie, sur le versant sud de la vallée de la Soummam, en Kabylie, et qu’un certain paysage est plus émouvant, plus parlant, pour moi, que tout autre, fût-il le plus beau du monde. Qu’en ce lieu j’ai reçu les empreintes primordiales et entendu pour la première fois une mélodie du langage humain qui constitue dans les profondeurs de la mémoire l’archétype de toute musique, de ce que l’Espagne nomme admirablement le chant profond. C’est cela et bien plus ; l’appartenance ‘‘ontologique’’ à un peuple, une communion, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une participation totale à ses épreuves, à sa misère, à son humiliation, à sa gloire secrète d’abord, manifeste ensuite ; à ses espoirs, à sa volonté de survivre comme peuple et de renaître comme nation » (8). En 2005, l’écrivain et critique littéraire Djamel Eddine Merdaci sortait « L’Absent » (9) d’un long isolement médiatique : « Cet homme (…) n’en est pas moins exceptionnel et exemplaire de ce que signifie l’humanisme algérien. Ce destin prodigieux n’a pas été salué, en son pays lui-même, par la reconnaissance officielle et institutionnelle. On cherchera en vain le nom de Jean El Mouhoub Amrouche dans les espaces où s’incarne la pérennité d’un État dont il n’ jamais douté de sa résurgence » (10). Il faut – toujours – espérer que cette « sanctification » républicaine par la nation qu’il a annoncée dans l’épreuve du feu adviendra.
2°) Mouloud Feraoun. J’ai suffisamment écrit sur la postérité algérienne de Mouloud que je redoute de me redire (11), car il n’y a rien de nouveau qui puisse retenir l’attention de l’historien et du critique. Je me suis insurgé, au printemps 2021, mais aussi en de nombreuses années, contre les propos de Ali et Faïza Feraoun, les enfants de l’écrivain, contre une détestable propension à en faire un militant du FLN et même un membre de l’ALN dans la proximité, il est vrai peu glorieuse à l’époque, de Mohammedi Saïd, qu’il aurait rencontré et fréquenté juste après les tueries de Melouza, en 1957. Bien entendu, les héritiers Feraoun n’apportent aucune preuve de la présence de leur père dans le FLN urbain ou dans l’ALN des maquis. Au demeurant, à cette période, en 1957, rien n’empêchait Mouloud Feraoun, une personnalité kabyle de réputation internationale, adoubée par les milieux littéraires algérois (Grand Prix du roman de la Ville d’Alger, en 1951, pour la première mouture du « Fils du pauvre ») et parisien (Prix populiste 1953 pour « La Terre et le sang ») de siroter un café avec Mohammedi Saïd ou n’importe quel responsable de la Wilaya III (Grande Kabylie) dans un maquis de l’ALN. Le fait aurait été divulgué et n’en aurait pas changé l’écrivain en combattant de l’ALN.

Il est curieux que dans son « Journal, 1955-1962 », Mouloud Feraoun n’ait pas caché son amitié déférente pour le général Olié, chef des opérations militaires en Kabylie, ordonnateur des épandages de napalm sur ses dechras de montagne, lui faisant parvenir en douce, par l’intermédiaire du sous-préfet de Fort National un exemplaire dédicacé de ses « Jours de Kabylie » (Alger, Baconnier, 1954 ; rééd., Paris, Seuil, 1957), mais rien noté sur celle de Mohammedi Saïd dont il condamnait fermement l’opération de Melouza : « Une honte ! Une honte, un acte imbécile par quoi tout un peuple se condamne et découvre avec imprudence sa barbarie » (12). Pourtant, le compagnonnage de Mohammedi Saïd, officier des redoutables « SS Mohamed » et du IIIe Reich, décoré dans le corps des Légions arabes de l’Allemagne nazie, bourreau de Melouza, est désormais revendiqué par les enfants de l’écrivain. Double jeu ? L’écrivain, qui a été un élu municipal de Fort National, proche de l’administration coloniale, démissionnaire après l’ultimatum du FLN aux élus indigènes des assemblées coloniales, en 1955, reconnait dans les pages de son « Journal » avoir louvoyé entre les autorités civiles et militaires coloniales et les tribus kabyles, cherchant à rassurer les unes et les autres. A-t-il, dans la semblable mesure, cherché à donner des gages à l’ALN, notamment auprès de Mohammedi Saïd ? Cela devrait être sérieusement documenté.
Mouloud Feraoun, s’il comprenait le combat de ses frères et sœurs de Kabylie et le voyait comme nécessaire face à l’impasse coloniale, n’a jamais renié son sentiment d’être Français. Il n’a pas été prêt pour franchir, contre toutes les préventions, les siennes et celles d’autrui, son Rubicon et rejoindre le combat libérateur du FLN et de l’ALN. Vers la fin de la guerre, après l’assassinat par une milice coloniale d’un de ses amis français, Feraoun expose son Algérie idéale, le 10 janvier 1962, deux mois et cinq jours avant son exécution par l’OAS, dans une lettre adressée au romancier Jean Pelegri : « Cher ami, oui, j’ai eu beaucoup de plaisir à connaître C. et j’ai passé avec lui deux bonnes journées. C’était comme si j’avais tout d’un coup retrouvé l’équipe Honorât, Pelegri, Moussy. Je vous ai attendu mais à défaut de Pelegri, nous avons eu la visite d’un Kabyle et, à trois, nous avons parlé de nos inquiétudes, de nos espoirs, de nos souvenirs. Dites bien à Honorât ma sympathie, ma profonde tristesse parce que, en tuant C. c’est un peu vous tous qu’on a tués et si un jour la chose m’arrivait, vous pourriez pleurer aussi en songeant que c’était tous vos frères — ceux qui vous ressemblaient — musulmans qui étaient tombés. Ils seraient morts frappés par n’importe quelle main : celle qui a frappé C. ou celle qui aurait pu le frapper… » (13). Une Algérie d’écrivains, sûrement, surmontant les dichotomies coloniales. Était-ce le cas pour les communautés européennes et indigènes de l’Algérie coloniale qui n’ont connu que la séparation ?
Je voudrais insister sur qu’aurait pu être l’apport de Mouloud Feraoun à l’Algérie et aux Algériens. Contrairement à Jean Amrouche, isolé dans le champ littéraire germanopratin, singulièrement en ces années 1950, Feraoun était respecté par l’établissement littéraire de la colonie et de la France. Imaginons que cet écrivain, qui a plus que tous les écrivains indigènes ou européens d’Algérie, ravivé son amour et sa croyance en la France, la France éternelle de Lavisse qu’il a longtemps enseignée sans se dédire aux petits kabyles, aurait surmonté l’alternative funeste de « mourir en traitre » ou en « victime » (14), pour rejoindre Tunis, le FLN-ALN et le GPRA, plutôt que s’adonner au tourisme dans les iles grecques, au large du Péloponnèse ? Il ne l’a pas fait. Alors de quels combats urbains du FLN et des maquis de l’ALN et de quelles mutations décisives de la société indigène algérienne est-il, selon l’éditorialiste Hassane Ouali, le juste observateur ?
Un prêt à penser idéologique
Avec ses centaines de milliers de morts, la Guerre d’Algérie a été une des plus terribles guerres de l’Humanité, sonnant le glas de l’Empire colonial en Afrique. Cette guerre a ses héros et ses martyrs. Lorsque Hassane Ouali habille de vertu patriotique Feraoun, pour contenter les héritiers de l’écrivain, et aussi Amrouche, dont les descendants n’ont rien demandé, il est dans la sourde manipulation de l’Histoire. En quoi ces deux écrivains, parlaient-ils au nom des maquis de l’ALN pour en préfigurer la pensée militante ? À quel titre, outrageusement dérobé, auraient-ils été les chantres « d’une vision universelle de la lutte de libération » et aussi, « et surtout d’une société plurielle et ouverte », celle précisément qu’appelait de ses vœux Albert Camus, qui combattait la possibilité d’une Algérie indépendante, sans la France et sans la communauté européenne d’Algérie, les pieds-noirs.
Le lecteur du quotidien de M. Outoudert peut s’emparer de ce prêt à penser idéologique racoleur de M. Ouali, qui n’en mesure pas la gravité. Historien de la littérature algérienne et critique littéraire, je suis, personnellement, intéressé par les preuves que peut apporter le journaliste sur ses affirmations ; mais, aussi, particulièrement, par celles des héritiers de Mouloud Feraoun relatives à sa présence dans les rangs du FLN-ALN. Je suis, depuis des décennies, dans le combat pour l’autonomie de la littérature algérienne, qui ne peut rester indéfiniment un greffon de la littérature française, sous l’emprise des institutions de la France littéraire. Décidément, l’histoire de la littérature algérienne n’a pas été écrite.
Notes
- Hassane Ouali, « Feraoun, Amrouche et l’indépendance », 17 juillet 2022.
- Je ne crois pas que Moufdi Zakaria ait disparu d’un récit national algérien qui demeure fragmentaire. Ce sont ses paroles de « Qassaman », l’hymne national, qui assurent l’unité et la solidarité des Algériens, malgré les embûches de l’Histoire qui les ont séparés et qui les séparent toujours. Des millions d’élèves de l’École communient chaque jour dans sa poésie, dans ses mots. Il est vrai que son parcours d’écrivain et de militant n’est pas étudié dans l’Université algérienne. Le cas de Fanon est plus complexe. Dans plusieurs villes du pays, des écoles et des collèges portent son nom. Le travail pionnier du philosophe Abdelkader Djeghloul sur la « pensée fanonienne » dont j’ai édité, il y a bien longtemps, les moutures inaugurales, n’a pas été continué. Djeghloul était plus avancé que Homi K. Bhabha et ses coéquipiers de Harvard et Radcliffe sur les horizons historiques du discours fanonien. J’ai, pour ma part, intégré dans mon ouvrage « Auteurs algériens de langue française de la période coloniale. Dictionnaire biographique » (Paris-Alger, L’Harmattan-Éditions Chiheb, 2010) un signalement critique sur l’auteur de « Peaux noires, masques blancs » (1952), qui a fait le choix, sans équivoque, d’être Algérien. Il repose, conformément à son vœu, au carré des Martyrs du cimetière d’Aïn El Kerma, dans la wilaya d’El Tarf. Quelle part lui concèderont les études universitaires et les recherches académiques algériennes ?
- Contrairement à la période coloniale, dans le pays indépendant, il ne faut, certes, pas exclure, mais il convient de respecter la volonté des écrivains. Je suis de ceux qui ne croient pas à la double nationalité littéraire. Dans ce cas, pour tous les pays du monde, dont ils ont pris la nationalité, il appartient aux écrivains d’origine algérienne de se déterminer. Dans le cas de la France, ancien pays colonisateur, la situation est différente : tous les Algériens, nés avant et après l’indépendance de l’Algérie, naturalisés Français ne devraient plus de faire partie de sa littérature. Un écrivain ne peut représenter qu’un seul pays, un seul drapeau.
- André Gide, « Journal (1889-1949 », Paris, Folio-Gallimard, 2021.
- Abdellali Merdaci, « Un groupe d’acteurs culturels de l’entre-deux-guerres : Instituteurs algériens d’origine indigène », Constantine, Médersa, 2007.
- Jean Amrouche, « Conférence de Rabat », 1958. Au cours de cette causerie, Amrouche avait déclaré : « La France est l’esprit de mon âme, l’Algérie est l’âme de mon esprit ». Texte reproduit dans « Jean Amrouche. L’Éternel Jugurtha (1906-1962) », Archives de la Ville de Marseille, 1985, p. 78.
- Cf. Jean El Mouhouf Amrouche, « Journal, 1928-1962 », Alger, Éditions Alpha, 2009 ; « « Un Algérien s’adresse aux Français ou l’Histoire d’Algérie par les textes (1943-1961), Alger, Dar Khettab, 2013. Édition établie par Tassadit Yacine.
- « Conférence de Rabat », dans « Jean Amrouche. L’Éternel Jugurtha (1906-1962) », oc., p. 78.
- Ces mots prophétiques du poète : « Je suis figure de mystère et de sanglante destruction. Je suis absent à moi-même et je serais jugé comme si j’étais présent », dans « Journal de l’Absent », extrait de « Étoile polaire », Paris, L’Harmattan, 1983 (1ère éd., 1937).
- Djamel Eddine Merdaci, « Jean El Mouhoub Amrouche, le poète de l’Algérie immémoriale », « Le Quotidien indépendant », (Alger), 6 janvier 2005.
- Pour qu’il n’y ait pas d’équivoque, je précise que ces vingt dernières années, j’ai surtout proposé une lecture de la stratégie d’écrivain de Mouloud Feraoun, entre autres trajectoires dans l proximité d’Emmanuel Roblès, aujourd’hui dénoncée crûment par Ali Feraoun. Auparavant, je n’ai jamais manqué d’écrire et de soutenir par l’exemple en quoi il était un grand écrivain, qui a gagné en qualité de langue littéraire, de créativité littéraire, depuis « le Fils du pauvre. Fouroulou Menrad, instituteur kabyle », 1950, à « L’Anniversaire » (1968, posthume ; en chantier vers la fin de la guerre). Oui, il faut donner à lire Feraoun dans les écoles d’Algérie au moment où son œuvre et son parcours d’écrivain, éclairé par les déclarations d’Ali Feraoun, depuis 2010, est en attente d’une grande thèse dans l’Université algérienne.
- « Journal, 1955-1962 », Paris, Seuil, 1962 », p. 235.
- « Journal », oc., p. 342.
- « Journal », oc., pp. 132-133.
Post-scriptum
Morceaux pourris d’histoire littéraire et d’histoire politique sous les frondaisons de mars
J’ai reçu tardivement le dossier du quotidien gouvernemental « Horizons » sur Mouloud Feraoun (Jeudi 17 mars 2022). Je n’en exprime qu’un regret : c’est une triste imposture de l’Histoire. L’écrivain kabyle, ami du général Olié, tueur acharné sur les monts du Djurdjura, ne peut être le héros d’une Algérie indépendante à laquelle, il ne croyait pas. Que faudrait-il attendre d’un Ali Feraoun, qui gère abusivement la mémoire de son père et d’un propagandiste longtemps enrôlé dans l’amazighité bureaucratique avec le titre de « secrétaire général » ? Et, aussi, ailleurs, d’un dénommé Arris Touffan, sorti clandestinement des nuées. Misère !