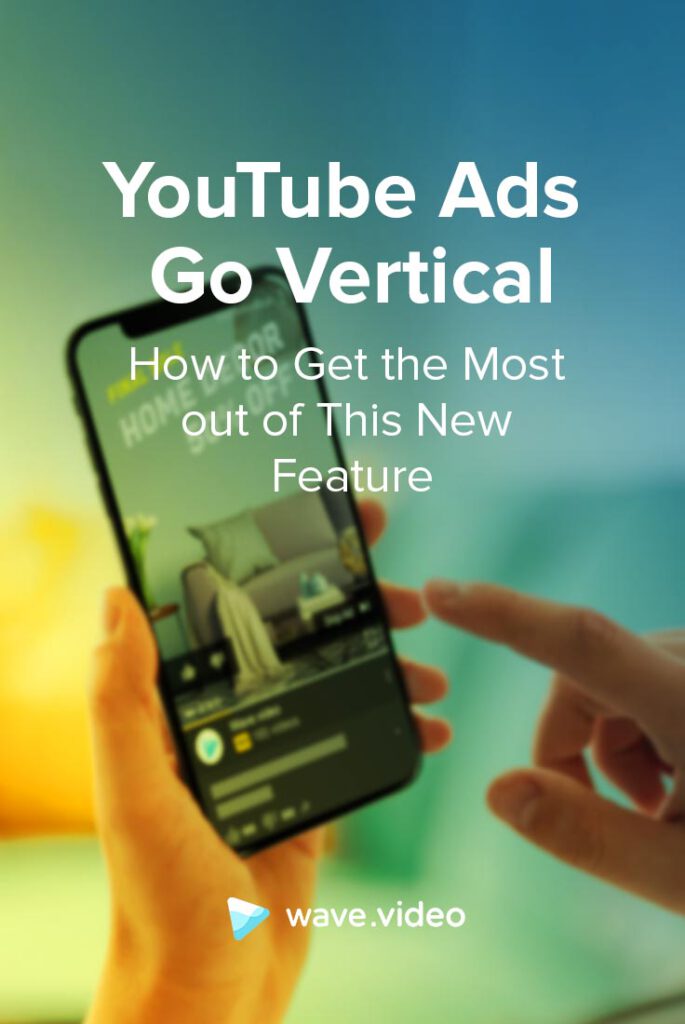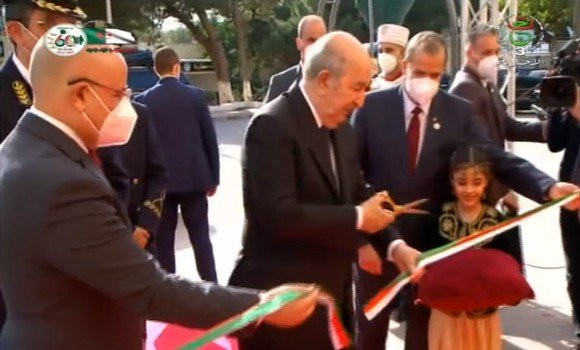Par Abdellali Merdaci
L’éditorialiste du quotidien de M. Abrous Outoudert, Hassane Ouali, qui vient de se prêter indélicatement à une écriture mensongère de l’histoire de la littérature algérienne de langue française, que j’ai mis en cause publiquement (Cf. mon article « Mouloud Feraoun, Jean Amrouche et tutti quanti. L’histoire de la littérature algérienne n’a pas été écrite », « Algérie 54 », 21 mars 2022) en rajoute une couche à l’occasion de l’ouverture du XXVe SILA, s’émouvant de la situation de l’édition algérienne, perturbée par la crise du papier (« La culture, l’âme abîmée de la société », 23 mars 2022). Il omet de préciser que cette crise du papier est strictement algérienne. Les imprimeurs algériens, à défaut de se prendre en charge, s’en sont toujours remis à l’État pour négocier l’achat du papier auprès de fournisseurs étrangers.
Cette crise du papier n’existe pas concrètement pour les éditeurs et imprimeurs occidentaux, particulièrement européens, qui n’ont pas surenchéri le prix du livre. Elle est réelle en Algérie ces deux dernières années de pandémie du coronavirus. De grands imprimeurs comme Casbah, Chihab, à Alger, Dar El Houda, à Aïn M’lila, qui sont aussi des éditeurs, devraient être en mesure d’acheter leurs stocks de papier sans en attendre la providentielle distribution par l’État. Dans le prolongement de cette crise du papier, Ouali érige en victimes des écrivains algériens – ou faussement algériens : « Cette sombre page est encore abîmée par la guerre permanente livrée à nos écrivains. Les Khadra, Sansal, Daoud, Zaoui, Bey, Adimi ».
L’inattendu « critique » Ouali place la littérature sous le signe absolu de la transgression. Est-ce un paramètre fondamental pour écrire et entrer en littérature ? Qu’est-ce que le Russe Léon Tolstoï a-t-il transgressé en écrivant « Guerre et paix » (1867) et l’Américain Mark Twain dans « Huckleberry Finn » (1884) ? Cette liste peut être allongée avec l’Allemand Goethe, l’Espagnol Moratin, l’Italien Manzoni, l’Anglais Wordsworth et mille autres à la mesure de l’humanité des Lettres contemporaines, du XIXe siècle à nos jours. Outre de nombreuses références académiques, lecteur professionnel, je n’ai jamais lu et entendu, partout dans le monde, que la littérature est constitutivement une « transgression ». Transgression de quoi : de normes sociales, politiques ? Franz Kafka y pensait-il lorsqu’il écrivait « Le Château » (1926), qu’il n’achèvera pas ? Et, plus tard, Philip Roth lorsqu’il introduit l’ancien président Clinton dans « La Tache » (2000-2002) ? La naturalisation des acteurs politiques dans la fiction est déjà largement admise depuis John Dos Passos (« Manhattan Transfer », 1925, « La Grosse galette », 1936), suivi en France, par Jean-Paul Sartre (« Les Chemins de la liberté, 1945-1949), pour être reçue comme une transgression.
Aujourd’hui, dans l’Algérie nouvelle de M. Tebboune, un romancier inspiré par les frères Bouteflika et leur ’içaba irait-il en prison pour les avoir campés en personnages séditieux dans son œuvre ? Normes sociétales ? J’ai trouvé d’une décevante platitude les pages pornographiques de « Minuit à Alger » (Alger, Barzakh, 2022) de Nihed El-Alia, qui ne sont pas les plus audacieuses de son roman ; et je n’imagine pas qu’elle puisse coucher dans un cachot pour avoir piqué aux fesses la morale bien-pensante du « salaf ». Est-ce de la transgression ? Non, de la littérature, simplement.
Ouali estime – à tort – que faire de la littérature, c’est être opposé à un pouvoir dans une société subjuguée, cadenassée. Et que les intentions de départ d’un romancier sont toujours concrétisées au terme de son aventure dans son écriture. Deux exemples : celui de Balzac, autrefois étudié par Georg Lukács, écrivant « La Comédie humaine » qui, malgré (et contre) ses aspirations monarchistes, consacre la bourgeoisie, classe ascendante dans la société française de la Restauration (1815-1830) ; celui d’un écrivain que le journaliste Ouali connaît bien : lorsque Kamel Daoud a entrepris d’écrire « Meursault, contre-enquête » (2013-2014), son projet était de prendre à rebrousse-poil « L’Étranger » (1942) d’Albert Camus, projeté dans un contre-champ algérien, spécialement indigène : en fin de course, son texte, retouché par l’éditeur Actes Sud (Arles, France), s’est transformé en hommage à l’écrivain pied-noir, Prix Nobel de Littérature 1957.
Aucun écrivain ne se met à sa table de travail avec le projet d’écrire un roman de transgression. Je ne vois pas, du reste, de transgression dans les œuvres romanesques des protégés du critique littéraire improvisé, Daoud et Sansal. Voilà un fait édifiant : dans les bars à bière du Quartier latin, à Paris, et dans certains magazines français complaisants – ainsi, « Jeune Afrique » – Sansal traitait de « Borgia » les frères Abdelaziz et Saïd Bouteflika, au summum de leur règne. L’image est forte, solide comme une imputation en Cour de Justice. Mais ce roman du sexe et du lucre, ce roman d’improbables ombres cardinalices sorties des catacombes vaticanes des XVe et XVIe siècles et transplantées à la Mouradia, Sansal ne l’a jamais écrit, parce qu’il n’en était pas capable. Il est plus aisé, pour lui et pour ses semblables, de jouer la transgression dans les marges de leurs petits romans d’imitateurs sans génie, dans les médias et sur les plateaux de radio et de télévision parisiens. Orwell, pour lui, Camus pour Daoud. Dans ce cas précis, le raisonnement est abêtissant : « Je publie un roman, je ‘‘tape’’ à mort sur le ‘‘système politico-militaire’’ d’Alger pour complaire à une critique française de zélotes des défuntes colonies, pour le promouvoir et le vendre ». Sansal et Daoud ont révisé le « Cogito ergo sum » : « Je transgresse donc je suis ». Ni l’un ni l’autre n’accéderont à des œuvres majeures de création.
Des écrivains persécutés en Algérie ?
L’éditorialiste de M. Outoudert s’engage dans une énumération trompeuse d’écrivains mis à mal en Algérie : sur les romancières citées en queue de liste, je voudrais informer que Mme Bey fait l’objet, chaque année, d’au moins une cinquantaine de mémoires de masters et de dizaines de thèses dans les spécialités littéraires des universités algériennes. Mlle Adimi, issue de la haute bourgeoisie d’État d’Alger, en résidence à Paris, est certes une écrivaine algérienne, je me souviens l’avoir lue dans un entretien en France affirmer son algérianité. C’est très honorable, mais elle vit en France et n’est pas suffisamment présente en Algérie pour s’y faire lire et entendre. Ceci dit, je ne crois pas à sa littérature et je l’ai exprimé sans ambages en plusieurs circonstances : pour moi, Charlot, qu’elle célèbre dans une exo-fiction, c’est la troisième génération de la littérature coloniale française en Algérie et ses accusations portées légèrement contre Jean Amrouche, qui a collaboré avec lui, ne sont pas fiables. En quinze d’activités éditoriales à Alger et à Paris, de 1935 à la fin 1950, Edmond Charlot n’a publié aucun auteur indigène algérien (à l’exception du cas singulier de Marie-Louise Amrouche et de sa « Jacinthe noire », en 1947). Et, c’est bien lui, qui a refusé la première mouture du « Fils du pauvre. Fouroulou Menrad, instituteur kabyle » de Mouloud Feraoun, en 1946.
Quant à Khadra et Zaoui, petits faiseurs, ils devraient s’appliquer à bien écrire la langue française sans se faire d’illusions, pour le premier, relativement à ses millions d’exemplaires distribués dans le monde. Ce que Pierre Bourdieu a appelé la « sphère de grande production », axée sur la standardisation et le commerce des biens culturels, qui ne marquera ni les consciences ni son temps, est à ce niveau de tirages. Au moment où Balzac était tiré à cinq cents exemplaires et en vendait dix, Eugène Sue frôlait (notamment pour « Les Mystère de Paris », 1842) le million d’exemplaires écoulés. Khadra, dans la pantomime de Sue rejoue une farce littéraire française : il ne sera jamais Boudjedra-Balzac (sur le plan de la créativité littéraire, cela s’entend !). Khadra et Zaoui, sont-ils persécutés dans leur pays ? Grands gueulards, sans talent, ils représentent le genre de romancier qui sera très vite oublié par la postérité littéraire. Alors, fermons tout doucement cette ornière.
La crapulerie conjuguée de Sansal et Daoud se lit ailleurs. Sansal a fait – et fait toujours – dans la contrebande sioniste : il est l’agent du sionisme mondial, défendant, en 2014, en tant que membre d’un comité d’organisation israélien, une exposition de propagande sioniste à l’époque refusée par l’Unesco, un habitué des diners CRIF, officine légale du sionisme en France, y soutenant véhémentement que « la Palestine n’a jamais existé ». À l’imitation de son aîné, Daoud s’est ouvert les portes des champs littéraire et médiatique français en fustigeant dans un journal algérien les Palestiniens et en faisant valoir son droit à l’indifférence envers leurs souffrances ; c’était, en 2014, au moment où l’armée israélienne bombardait Ghaza. Cette profession de foi d’un Algérien (il ne l’est plus depuis sa naturalisation française au mois de janvier 2020, rhabillé en « Français du futur ») lui a valu d’être porté sur les fonts baptismaux par Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Pierre Assouline, chef du lobby sioniste germanopratin, et bien d’autres. Et, l’écrivain-chroniqueur garde en bonne place dans son répertoire la diabolisation du postcolonial, « ça paie », comme dirait un de ses amis. S’ils apparaissent à l’expérience de sûrs buzzeurs, Sansal et Daoud sont de piètres écrivains. Mais, c’est un lobbyiste du sionisme littéraire parisien connu, qui a parié qu’il ferait gagner le Prix Goncourt de littérature aux pages roses d’un dictionnaire, qui les coache. Pour l’heure, ils n’ont pas accroché la mirifique timbale.
Je suis le seul critique et historien de la littérature algérien – hors des clous de la France littéraire et de la France tout court, que je n’ai cessé de combattre – dont auraient à se plaindre les écrivains de Hassane Ouali, à l’exception de Mme Bey, sur laquelle je n’ai rien écrit. Je n’ai pas le sentiment d’agir un tribunal de « l’antinational », et Sansal et Daoud, dans leurs fulgurances médiatiques parisiennes toutes calculées, y sont plongés jusqu’au cou par leur seule volonté personnelle. Il ne faudrait pas l’écrire et le dénoncer ? Mon pays, c’est l’Algérie et je défends ce pays et sa littérature : suis-je dans la nécessité d’applaudir de sombres gredins de la France littéraire ? Pourquoi chacun ne devrait-il pas se reconnaître et se projeter dans ses choix ? Daoud n’en aura pas fini d’afficher, avec cynisme et arrogance, sa francité à Paris et son algérianité, empruntée et tortueuse à Alger, dans le quotidien de M. Outoudert. Belle mentalité de tricheur. Il a averti, ces jours-ci, en sa qualité de Français, dans le magazine parisien qui l’emploie et collige sa prose, qu’il ne faut pas affaiblir l’Occident devant M. Poutine. C’est un choix, qui en fait l’agent de surface des pissotières d’une pensée française coupable, qui n’en a pas fini avec ses compromissions depuis la Seconde Guerre mondiale.
Non, Hassane Ouali, vous persistez dans le mensonge ordurier : il n’y a pas d’écrivain persécuté – ou censuré – dans l’Algérie de M. Tebboune. Ouvrez les yeux pour voir : Boualem Sansal, que vous défendez, un propagandiste du sionisme mondial, un insulteur des martyrs et des combattants de la « Bataille d’Alger (1957), de l’Islam, de l’Algérie et des Algériens, circule librement entre Alger et Paris, en dispensant sa prose venimeuse. Peu de temps avant de recevoir sa naturalisation française, Kamel Daoud appelait, au mois de décembre 2019, les Algériens à faire le choix de la France et de la bi-nationalité, à devenir des « Français du futur », sans aucune réaction de ceux qui ont la charge de la mémoire de la nation. Il a piétiné dans leurs hypogées les sépultures de nos martyrs du combat national. Sans être, l’un et l’autre, inquiétés. Dans quel pays un éditeur peut publier sereinement un roman de propagande coloniale, un roman du « peuple neuf » de la colonisation française d’Algérie ? Dans quel pays, un éditeur peut aussi donner un roman avec « coke » et « nirvana » ? Sans muselière ni entrave ni semelle de plomb. C’est acté, l’Algérie nouvelle ne touche pas aux écrivains, quoiqu’ils fassent, quoiqu’ils disent, quoiqu’ils écrivent.
Les délires d’un « normalisateur »
Hassane Ouali, quant à lui, est connu comme un agent de la « normalisation » avec Israël (ainsi, son « Israël n’est pas un tabou », ânonné sur une chaîne de télévision française), même s’il n’atteindra pas le niveau de forfaiture inégalé de Sansal dans ses souilles. Il vient, encore une fois, de s’y prêter dans un éditorial du 22 mars 2022 : « Le monde bouge, et nous ? ». Voilà le message insidieux de l’éditorialiste : Qu’attend donc l’Algérie pour se jeter aux pieds de l’ogre sioniste et de son valet marocain ? Voici la plus pernicieuse des « leçons » écrites dans la presse algérienne : « On ne peut faire comme si rien ne changeait. Le monde bouge à un rythme soutenu. Il est judicieux d’anticiper sur les événements en rénovant notre logiciel politique national. Il est important d’être à l’initiative de nos propres changements, d’évidence nécessaires, que de les subir par la force des événements. C’est la meilleure voie qui nous permet de négocier au mieux notre place dans ce monde qui s’annonce. » Désormais, pour l’État algérien, la clairvoyance, c’est de négocier le « changement » plutôt que de « le subir » inéluctablement par « la force des événements », parce que « les lignes bougent substantiellement et pas dans la direction souhaitée par des pays comme l’Algérie ». Avertissement et menace prodiguée à l’Algérie pour le compte d’Israël et de l’Occident. Le défaitisme est déjà en marche, avec adresse, raison sociale et patente.
Et, Ouali de désigner au « système politico-militaire », « rentier de la mémoire » (Emmanuel Macron), une porte de secours pour ne pas rater la « marche de l’Histoire » et pour éviter la trique de l’Occident et d’Israël, une issue de stricte politique locale : « Pour ce faire, il faut que la sérénité règne dans le pays et que la confiance revienne. Pour cela, il faut que la vie politique reprenne ses droits, que les opinions soient garanties respectées ». Et le coup de boutoir : « Cette histoire de détenus d’opinion fait trop mal, parasite et empêche d’envisager l’avenir ». L’État algérien et ses institutions sont priés de venir à résipiscence. Sinon, Hassane Ouali se voit déjà sur les chars de l’Otan dans les rues de la capitale, guidant la « normalisation » de l’Algérie. C’est du déjà vu et entendu : amère resucée.
C’est dans le journal d’Ouali et d’Outoudert, qui n’a jamais informé ses lecteurs sur l’interdiction et l’inscription du MAK dans une liste d’organisations terroristes par la plus haute autorité de sécurité de l’État, que le chroniqueur Hammouche a conféré une aura « démocratique » aux agitations du groupuscule séparatiste kabylo-parisien à l’enseigne d’un théâtre-bouffe. Grosse saloperie.
Post scriptum : Vite dit et assumé.
Les organisateurs du SILA ont le droit d’inviter qui ils veulent. 3000 titres exposés, potentiellement 3000 auteurs de toutes provenances. À chaque nouvelle édition de la grande manifestation littéraire algérienne, même si ses dirigeants ont changé, Anouar Benmalek, contempteur de toutes les Algérie(s) depuis Octobre 1988, y est encore admis. Simple curiosité : quel passeport, ce « Français de conviction », qui fut un temps « Algérien en transit », venant du Maroc avec, entre autres, une filiation biologique suisse revendiquée, agitera-t-il devant les services de la PAF à l’aéroport Alger-Houari Boumediene ? À défaut de se battre pour être un écrivain lu et reconnu dans son pays d’élection, la France, Benmalek se rabat sur l’Algérie et sa littérature où il y aurait encore des places à prendre ? Grosse…