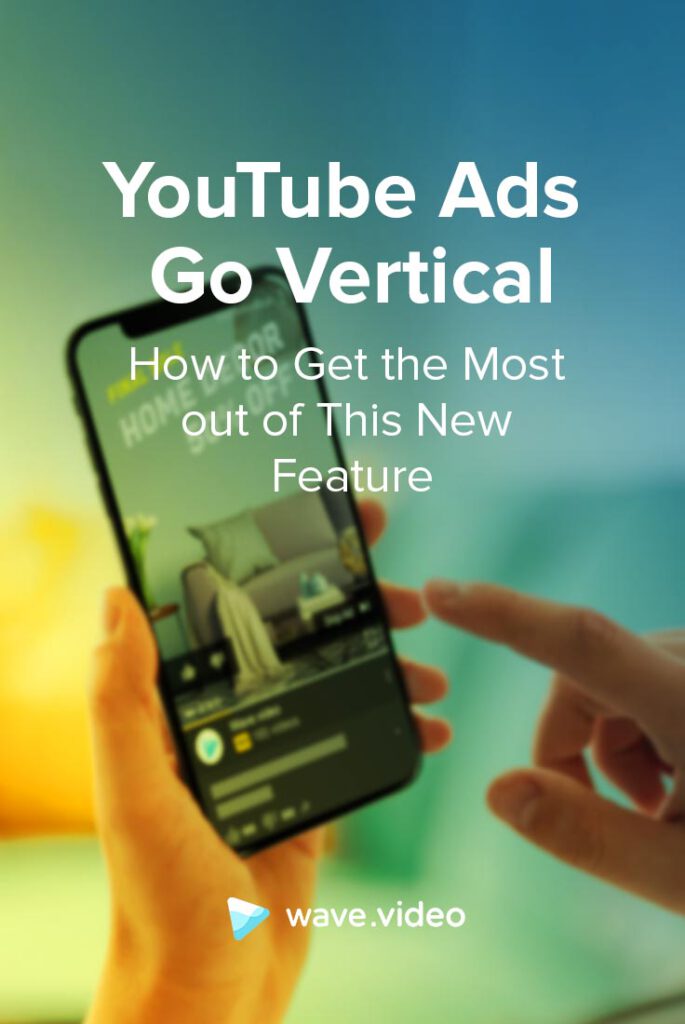Par Abdellali Merdaci
Amine Zaoui est professeur de littérature des Universités, écrivain et subsidiairement chroniqueur dans le quotidien algérois de l’industriel kabyle Issad Rabrab. Ces derniers jours, je le retrouvais dans l’imprévu hasard de deux discussions littéraires, dans des comptes-rendus des quotidien « Horizons » (Alger, 7 juillet 2021) et « El Acil » (Constantine, 11 juillet 2021) d’un entretien avec le site d’information « El Fawassil » au titre programmatique « La littérature est liberté et non idéologie » et dans une chronique, qui ne l’est pas moins : « la littérature algérienne d’expression française est une mémoire positive commune ! » (8 juillet 2021). À l’évidence, Zaoui est un faiseur d’opinion, autant dans ses amphithéâtres et ses écrits de presse que dans ses romans. Et, nettement, un idéologue, qui attaque les convictions religieuses des Algériens et les symboles de leur État.
Un idéologue honteux et contrarié
Les vérités que porte publiquement l’écrivain-professeur-chroniqueur sur la littérature sont d’une légèreté indigne. Quand il a lu la poésie d’Imru El Qays, El Moutanabi, El Farasdaq, mais aussi celle de Charles Baudelaire et René Char, les romans de Proust, Balzac, Dumas et, étonnamment, Michel Houellebecq, comment peut-il prétendre que la littérature est exempte de toute représentation du monde, de toute idéologie ? C’est Georg Lukacs qui rappelait précisément les contradictions du romancier Balzac, proche de l’aristocratie de la Restauration (1815-1830 ; celle qui a commandé le blocus maritime d’Alger en 1827), qui magnifiait dans sa « Comédie humaine » (1829-1850) la bourgeoisie, classe sociale montante, allumant les feux de son idéologie mercantile et libérale. La littérature, si elle déploie une langue et un imaginaire sur la société, n’est pas un art sans aspérité. Restons dans les références littéraires du chroniqueur. Le lecteur Zaoui a sans doute connu le résistant René Char, tel qu’il est portraituré par ses pairs, ainsi Albert Camus, et ses biographes, à l’égal du poète dans ses engagements et dans le foudroiement de ses mots dans une France sous l’occupation nazie. Mais a-t-il vraiment lu Houellebecq, celui de « Soumission » (2015), éclatant assaut contre l’Islam pour célébrer les lubies du « grand remplacement » de Renaud Camus ?
La littérature exclut donc l’idéologie ? Cependant, derrière le professeur de littérature, le romancier est dans l’intenable confusion qui reconnaît explicitement la dimension idéologique de ses propres personnages, principalement ses délégués textuels, porteurs d’une vérité sur le monde qui est potentiellement celle de l’auteur. Alors qu’il soutient l’inanité de toute idéologie dans la littérature, Zaoui admet que l’art de l’écrivain est d’esthétiser la charge idéologique de ses personnages. Dire une chose et son contraire ? Déroute théorique. Qu’enseigne le maître de chaire Zaoui à ses auditoires captifs des Universités du pays où il fait grand bruit ?
La littérature parle de nos sociétés et elle est parlée par elles. Est-elle, même dans le verbe d’Imru El Qays et de René Char un art pur, chassant le discours social et son escorte idéologique ? À défaut d’exprimer un versant idéologique essentiel, l’œuvre littéraire est liberté, claironne l’invité d’« El Fawassil ». Et, si la littérature est liberté de penser et de dire, s’exerçant dans la transgression des idéologies et des politiques dominantes, cette liberté n’est jamais donnée aux écrivains, elle s’arrache dans des batailles toujours incertaines, qui conduisent parfois aux allées de l’exil – récemment, après tant d’autres, l’Égyptien ’Ala El Aswany, qui n’abdique rien de ses convictions. Et, souvent, cette liberté recherchée est si violente qu’elle s’épuise dans la mort, celle inoubliable du poète chilien Pablo Neruda. Autant ne pas mystifier des auditoires et des lectorats acquis. Littérature, idéologie, liberté sont indissociables.
Chez ses hôtes d’« El Fawassil », Zaoui se met volontiers en scène. Il construit une posture d’écrivain, tout voué à la défense de la femme et, pour preuve indiscutable, il a multiplié les titres sur ce thème, tout en se réclamant d’un humanisme compassé. L’ethos d’écrivain féministe qu’il avance n’attend que d’être gravé dans le marbre. Mais, c’est encore une confusion. À l’heure du #MeToo occidental, la femme algérienne qui a accédé aux responsabilités dans les gouvernements et les parlements, dans les grades supérieures de l’armée républicaine, dans les directions d’entreprises de l’État et du secteur privé, inéluctablement présente dans toutes les activités de la société et dans leurs hiérarchies instituées, est « sortie du gynécée », comme l’écrivait Assia Djebar. Les meilleures des libertés qu’il faut souhaiter aux Algériennes, même si elles n’ont pas lu les bréviaires féministes, de la première à la troisième vague, sont celles qu’elles défendront elles-mêmes, loin de toute tutelle et médiation masculine, fut-elle celle d’Amine Zaoui, qui ne sera jamais un Tahar Haddad (1899-1935), militant féministe d’un autre âge, au pays des narcisses. Désormais, en Occident, les « fous d’Elsa » couchent en prison. Bientôt chez nous ? Il viendra un temps ou les Algériennes n’accepteront plus aucun tuteur, qui fait de leurs malheurs un fond de commerce odieux, spécialement dans la littérature.
Quant à l’humanisme, qu’il projette comme une bulle en surplomb de son éthique de personne, j’invite Zaoui sur les cheminements intellectuels escarpés de Montaigne et de La Boétie, apôtre de l’insoumission, humanistes et forcément idéologues. Tout langage est une appropriation du monde, de la société. Comment mettre un voile sur l’idéologie, un mal ultime, pour s’en préserver ?
Littérature algérienne et domination littéraire néocoloniale française
Dans le quotidien algérois où il tient un « souffle » si court, Amine Zaoui s’est prêté à un étroit mouvement de saute-mémoire, simplement affligeant. Il indique que « la littérature algérienne d’expression française est une mémoire positive commune ! », probablement partagée par la France et l’Algérie. Soit. Mais en la circonstance, l’écrivain-chroniqueur est autant dans la pétition idéologique que politique. Il veut poser un jalon – vermoulu – de l’introuvable amitié franco-algérienne. Cela mérite explication. Mais auparavant, tranchons une imbécilité pétrifiée de l’Université algérienne et un concept douteux. Il est déplorable de relever sous la plume du professeur d’Université le vocable « expression française », quand il convient commodément d’envisager une « littérature algérienne de langue française », formulation objective, qui donne ses droits à l’histoire. Entre « expression » et « langue », il y a des nuances, de fortes nuances, tous les dictionnaires de langue en font état. Engageons donc un effort de clarté : en Algérie, il y a une littérature de langue française, la plus anciennement établie sur le plan scriptural et dans ses soubassements socio-historiques (édition, diffusion, constitution de lectorat), à côté de celles qui utilisent les langues arabe et amazighes, au moment où des chercheurs évoquent une littérature orale (bientôt écrite ?) en algérien, la « darija ». Il ne s’agit, ici, que de langues vivantes, l’Algérie garde dans ses pierres et dans ses manuscrits le latin, vestige romain oublié. Cette mosaïque linguistique, témoin d’une histoire insondable de l’État-continent, tout uniment et sans exclusive, forme la littérature nationale algérienne, dans ses idiomes fragmentés et dispersés, fourmillante poussière d’argile, humus de la terre d’Algérie, le véhicule le plus somptueux d’un art littéraire qui vivra.
Le concept de « génération » littéraire, sollicité par le professeur-chroniqueur Zaoui, a eu son heure de gloire dans la vieille sociologie littéraire. Nettement controversé, il a été introduit pour la première fois dans l’histoire littéraire algérienne par Henri Kréa (« Préface au panorama de la nouvelle littérature maghrébine (La génération de 1954) », « Présence africaine » [Paris], oct. 1960-jan. 1961). Lorsque Zaoui désigne à propos des écrivains des années 1950 une « première génération », en tentant une périodisation sans fondements critiques ou scientifiques, où va-t-il caser les auteurs d’avant 1950, qui formeraient selon son entendement plusieurs générations. Pour la seule période historique de 1891 à 2021, et pour la seule fiction, combien de générations devrait-on aligner ? Et comment les fonder selon une méthodologie stricte ? Kaddour M’hamsadji (né en 1933), doyen des lettres algériennes, écrivain émérite, a été suffisamment présent dans la littérature algérienne des années 1940 à nos jours, et son petit-fils Anys Mezzaour (né en 1996), se distingue actuellement dans le pari audacieux d’introduire la fantasy dans la littérature algérienne. Écrivant dans la décennie 2010-2020, peut-on les saisir, l’un et l’autre, dans une même génération de ce début de XXIe siècle – ou renvoyer l’excellent Kaddour M’hamsadji à une problématique génération des années 1940 ou à toutes les générations qui se sont succédé depuis cette date ? Zaoui se contente de plaquer un concept sans en marquer les limites méthodologiques. Est-il navrant d’appeler un professeur des Universités, hautement consacré, à retourner à ses chères études sur un concept obsolète ? Alors, passons.
Il est largement su qu’Algériens et Français n’échangent pas leurs littératures pour en faire le lieu de fructueuses convergences. C’était le cas aux origines de la littérature algérienne de langue française, aux XIXe et XXe siècles, et cela le reste aujourd’hui.
Imagine-t-on un lecteur berrichon ou des îles françaises des Caraïbes, lisant le dernier roman de Zaoui dans son édition originale de Dalimen, Alger, alors qu’il y a plus de chance que Patrick Modiano et Édouard Glissant soient disponibles et lus partout en Algérie sous la jaquette de leur éditeur Gallimard-Folio ? Flux à sens unique et avantage à la France contre l’Algérie et sa littérature dominée. Les écrivains algériens, édités dans leur pays, n’ont pas leur place en France, dans ses librairies, dans ses clubs de lecture, dans ses écoles et dans ses Universités.
La France littéraire et la France politique s’entendent pour maintenir une insurmontable tutelle impériale sur les littératures émergentes de leurs défuntes colonies, notamment celle d’Algérie. Paris barre toute velléité d’autonomisation de l’espace littéraire algérien. Tout écrivain débutant, et Zaoui ne l’est plus, sait que pour être lu à Vientiane et Hanoï, à Dakar, Cotonou et Abidjan, mais aussi à Berlin, Londres, New York, Moscou, Tokyo et Pékin, il faut passer par Paris. Les éditeurs français peuvent le faire et des auteurs algériens tombent sous leurs fourches caudines, certains se muant en « Français du futur ». Un écrivain américain, allemand, anglais, français, espagnol, italien, russe ou chinois, pourra accéder à une carrière mondiale, à partir de son pays, sans abdiquer son intégrité nationale et aussi celle de la littérature qu’il écrit.
Pourquoi cette liberté d’entreprendre librement une carrière littéraire n’est pas consentie aux écrivains d’Algérie ? La réponse est connue : Dalimen, comme d’autres éditeurs nationaux, est un grand éditeur, qui maîtrise son métier sans rien céder en terme de savoirs à n’importe quel éditeur germanopratin, mais il n’a pas la ressource de faire voyager ses auteurs et ses livres dans le monde, parce que, plus que la rigidité bureaucratique des gouvernants, la sujétion littéraire française l’en empêche, pour des raisons économiques et culturelles. Si par un coup de génie Dalimen découvre ou crée un auteur vendeur, et peu importe la qualité de sa langue littéraire, un éditeur français viendra le prendre d’autorité pour en faire un produit exclusivement français et une expression vivante de la culture française, à l’échelle de la planète. Ce n’est même pas nécessaire de donner des exemples et des noms que tous les spécialistes de la littérature algérienne connaissent. Dalimen et ses pairs ont sans doute compris que leur présent et leur avenir est d’être des éditeurs locaux, sous-traitants de l’édition française, sous le joug de règles léonines de l’impérialisme littéraire français.
Les Français, au premier plan les professionnels de la littérature, ne s’attachent aux auteurs algériens ou Français d’origine algérienne qu’à la mesure délirante du bruit qu’ils font dans les marges de leurs ouvrages. Ainsi, Sansal, Daoud et bien d’autres, qui animent un régiment de mercenaires d’une périphérie littéraire algérienne de la littérature française. James Joyce s’attristait, à propos des écrivains irlandais servant la littérature anglaise, à l’instar d’Oscar Wilde et Bernard Shaw, qu’il traitait de « bouffons attitrés des Anglais ». Nos écrivains assimilés sont plutôt des harkis de la plume, qui incarnent à Paris, contre celle que produit Alger, une pseudo-littérature algérienne.
La France littéraire maintient sa domination sur les littératures de ses colonies de jadis et empoisonne l’esprit de leurs auteurs qui la rejoignent. Sansal, à la détestable écriture, est moins un écrivain qu’une bête à prix littéraires fomentés dans un buzz démentiel. Yasmina Khadra, qui fourgue comme des petits pains ses romans à l’aïoli, guerroie contre les Académies littéraires et les médias de France, qui lui font la nique. Ce sont bien des Franco-marocains (Tahar Ben Jelloun, Leîla Slimani) qui sont récompensés, qui ont les faveurs des coteries littéraires et médiatiques germanopratines. Deux Goncourt, déjà, pour le royaume de l’Ouest, zéro pour nos légions de harkis. Bouffons !
De l’impossible confluence mémorielle et de la dette linguistique
Dans son rapport au président Macron sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie », l’historien Benjamin Stora n’y répond pas. Que reste-t-il des mémoires brisées de la France et de l’Algérie au temps colonial, quelles promesses neuves et revigorantes ont-elles forgé depuis la fin du colonialisme ? Hors d’histoires individuelles, à hauteur d’hommes et de femmes, il doit s’en trouver encore à écrire, raconter, imager et chanter, il n’y a pas de mémoire commune collective, éprouvant les territoires de l’Histoire entre les deux États souverains d’aujourd’hui. En Algérie, la France à massacré, dépossédé et transféré des populations, coupés de leurs racines et de leur personnalité, remâchant à l’envi tous les mots de la violence barbare. Ces fractures ne s’effacent pas derrière les conventions hypocrites des diplomaties d’État ou les pieuses préconisations d’un professeur émérite d’histoire contemporaine de l’Algérie. Entre l’Algérie et la France, il n’y a pas de mémoire heureuse.
Amine Zaoui l’inscrit en filigrane : la littérature algérienne de langue française devrait poser une passerelle entre Algériens et Français, en raison de la langue française, « une mémoire positive commune ». Mais, pour qui ? Pour les spécialistes de littérature d’une rive à l’autre de la Méditerranée ou pour les peuples d’Algérie et de France ? La langue française n’a jamais été ressentie par l’État algérien comme un bien commun, le liant à la France. Les chercheurs de l’Université, mais aussi les enseignants de tous les paliers de l’École algérienne, n’ignorent pas le processus de désidéologisation de la langue française depuis la réforme de son enseignement et de ses programmes dans les années 1970. Le législateur scolaire algérien, suivant les attentes des autorités politiques (sous la présidence de Houari Boumediene, Abdelkrim Benmahmoud et Mostefa Lacheraf étaient en charge du ministère de l’Éducation nationale) a opté pour un français basique de communication usuelle, éradiquant les substrats de la culture et de la civilisation françaises. Relativement à la langue française, l’Algérie et l’État algérien ne reconnaissent ni un bien commun ni une dette linguistique.
Je voudrais dire, ici, en quoi Zaoui, sur ce débat, abuse ses lecteurs du quotidien à l’enseigne du « droit de savoir » et du « droit d’informer », et convient-il, en la circonstance, d’accorder à l’écrivain-chroniqueur et professeur pontifiant de littérature des Universités, la présomption de la bonne foi ? Amine Zaoui a été longtemps un pur écrivain arabophone. Dans ces sanglantes années 1990, de « fitna » islamiste, où les Algériens mouraient, il était reçu régulièrement en France, pendant une dizaine d’années, dans des résidences et ateliers d’écriture en langue française. Comme son alter ego Wassiny Laredj, alors qu’il n’avait pas auparavant écrit une seule ligne en langue française, il deviendra un auteur de langue française, même si cette langue française, sa langue française, est une langue corrompue. Venu tardivement à l’écriture dans cette langue, il en pratique un parler altéré sur les plans morphosyntaxique, lexical et stylistique, qui est une traduction littérale de l’arabe. Changements de langue et de statut, qui nourrissent ses assertions d’aujourd’hui : « En Algérie, l’écriture littéraire en français continue avec brio. La lecture en français continue avec engouement ». Est-ce-là un juste retour de ce qu’il doit à la France, qui lui a donné un destin d’écrivain de langue française ?
Mais, s’agissant de la langue française, projetée comme le lieu de jonction entre l’Algérie et la France, à qui l’écrivain-professeur-chroniqueur veut-il donner des gages ? À la France ? Certainement. Toutefois, le français d’Algérie n’est pas celui de la France, comme l’anglais des États-Unis d’Amérique n’est pas celui de l’Angleterre. La langue française des Algériens se greffe dans le rameau de langues d’usage du pays, officielles, comme l’arabe et tamazight, officieuses comme l’algérien (langue véhiculaire enseignée pendant la période coloniale et support de productions artistiques orales, dans la poésie populaire, le théâtre et le cinéma) et, précisément, le français d’Algérie. Quand j’écris en langue française, je n’ai pas le sentiment de devoir quoi que ce soit à la France. Le français d’Algérie est une création de l’État algérien, de tous les pouvoirs qui l’ont servi dans le tumulte d’une histoire inquiète, qui l’ont plus encouragé que banni. Le bilan linguistique de cent-trente deux années de colonisation française est ridicule : à la veille de l’indépendance, sur une population de neuf millions d’Indigènes, 5% entendaient le Français, le parlaient ou l’écrivaient. Combien sont-ils aujourd’hui, cinquante neuf ans après l’indépendance ? Des dizaines de millions ?
La langue française en Algérie n’est ni « un butin de guerre » (Kateb) ni « un bien vacant » (Daoud). Il y a une langue française d’Algérie, rejeton d’une fratrie linguistique, symptomatiquement coupable, en raison de l’histoire violente de la colonisation. Mais, elle existe et perdure, non pas sous la protection du Quai d’Orsay, comme au Maghreb (Tunisie, Maroc, Mauritanie) et en Afrique subsaharienne, mais de celle de l’État algérien nationaliste, issu de la Guerre anticoloniale (1954-1962). Si demain, un président de la République islamiste prend le pouvoir et décide d’éradiquer le français des tablettes de l’École algérienne, il disparaitrait du jour au lendemain à jamais, remplacé par l’anglais ou le chinois. Mais aucun président algérien, d’Ahmed Ben Bella à Abdelmadjid Tebboune, ne l’a jamais souhaité. Tout est à jeter dans ce « système » au pouvoir depuis 1962 sur lequel s’acharnent le néo-hirakiste Amine Zaoui et ses amis ? Sans lui, le français est une langue en sursis.
Toutefois, depuis 1962, les États algérien et français ont davantage recherché des connivences politiques sur fond d’accords économiques que de strictes coopérations culturelles. La France a pu, relativement à la francophonie, considérer l’Algérie comme un vivier de locuteurs de langue française, le premier en nombre après sa population : cela n’a jamais créé un lien significatif.
Entre la France et l’Algérie, une séparation littéraire ancrée dans l’Histoire
Mais revenons à la littérature, au passé de la littérature des Algériens. Lorsque le chroniqueur, arc-bouté sur ses certitudes, colloque sur la littérature algérienne de langue franàaise, je me demande sur quelles discutables références, de Jean Déjeux à Charles Bonn, il s’appuie. Il ne connaît pas la littérature des Algériens pendant la période coloniale pour en gloser sûrement et efficacement, sans berner ses lecteurs. Il cite, certes, par exemple, Abdelkader Hadj Hamou (« Zohra, la femme du mineur », 1925) et Mohammed Ould Cheikh (« Myriam dans les palmes », 1936 ; et non pas 1930). Juste reconnaissance de l’œuvre de critique et d’histoire littéraire d’Abdelkader Djeghloul (1946-2010), d’Ahmed Lanasri et de Hadj Meliani, disparu récemment, que je partage pleinement. Dans mes travaux je remonte aux premiers écrits d’Algériens en langue française, ainsi, pour l’essai, le fameux mémoire sur la gestion municipale d’Alger d’Ahmed Bouderba, qui date de 1833, et pour la fiction littéraire aux romans d’Omar Samar (signant Zeïd Ben Dieb) dont j’ai publié en 2003 et 2013 l’édition critique, le tout premier romancier du monde arabe et du continent africain signant, en 1893, « Ali, ô mon frère ! », expérimentant bien avant « Les Faux monnayeurs » (1935) d’André Gide la technique de mise en abymes dans l’écriture romanesque, et en 1895, « Divagations d’âmes. Roman de mœurs exotiques et mondaines », roman centré comme chez le théoricien du naturalisme français Émile Zola sur le regard et sur les topoïs géographiques et sociétaux. Un précurseur de la modernité littéraire avant Mohammed Dib, Kateb Yacine, Malek Haddad et Rachid Boudjedra.
Il n’y a jamais eu de confluence littéraire franco-algérienne dans l’Algérie coloniale, lorsqu’elle n’a pas été tardive et insignifiante. Vers la fin des années 1940, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après le funeste mai 1945, quelques revues de Français d’Algérie, entre autres « Forge » d’Emmanuel Roblès et « Simoun » de Jean-Marie Guirao, accueillaient des auteurs indigènes proposant leurs premiers textes littéraires, souvent poétiques. En 1948, à Sidi-Madani, non loin de Blida, à l’initiative de Charles Aguesse, cadre de l’État colonial, investi dans les camps de la jeunesse, futur fondateur des Centres sociaux éducatifs (1956), un conclave littéraire réunissait des écrivains français réputés (ainsi Brice Parrain, Louis Guilloux, Francis Ponge, Jean Cayrol, Raymond Queneau, Henri Calet, Michel Leiris, JeanTortel, Albert Camus ; Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et André Breton étaient annoncés) et écrivains européens (entre autres, Robert Randau, Emmanuel Roblès, Jean Pomier, Edmond Brua, Émile Dermenghem, Jean Sénac) et indigènes d’Algérie (ainsi Mohammed Zerrouki, El Boudali Safir, Mohammed Dib, Hamza Boubakeur, Mlle Rabi’a Lacheraf, Kouribaa Nabhani, Cherif Zehar, Abdelkader Mimouni, Malek Bennabi et le docteur Abdelaziz Khaldi ; Kateb Yacine y était pressenti). Hormis le cas du jeune Mohammed Dib, rencontrant Jean Cayrol, qui va le publier au Seuil, les Rencontres de Sidi-Madani, placées sous le sceau du parrainage, demeuraient sans lendemain.
Entre Français et Algériens, il n’y avait pas de lieu commun et leurs œuvres ne forgeaient pas une « mémoire commune ». Sur ce registre, l’anthologie de Guy Dugas, « Algérie, un rêve de fraternité » (1997) est une évidente escroquerie littéraire et historique. Comment, en effet penser cette « fraternité » dans la France coloniale, où il existait un Grand Prix littéraire de l’Algérie, fondé en 1920, réservé aux seuls Européens d’Algérie, et une tardive section indigène de ce Prix, créée par arrêté gubernatorial, en 1941, sous l’État français de Vichy, qui couronnait dès 1941, Ali Benhadj (pseudonyme de Mohamed Sifi), Rabah et Akli Zenati, en1943, et Saadeddine Bencheneb, en 1946, critique et traducteur, recalant Mouloud Feraoun et son « Fils du pauvre. Fouroulou Menrad, instituteur kabyle ». Comment ne pas nommer un apartheid littéraire ? C’était cela l’image répulsive de la littérature la colonisation française en Algérie.
Dans l’Algérie coloniale, il y avait dans l’espace politique deux collèges, celui des Français et des Européens d’Algérie francisés, d’une part, et des Indigènes, de l’autre. Les littératures de ces deux communautés, nées quasiment à la même période, ne se mélangeaient pas. Les historiens de la littérature coloniale française d’Algérie, rejetant les écrivains de France publiant sur la colonie une « littérature d’escale », la situent avec exactitude à la date de publication, en 1894, des premières pochades d’Auguste Robinet, utilisant le pseudonyme Musette, créateur de Cagayous, héros raciste et antisémite, à la ressemblance de sa propre communauté. Hors de l’essai, les historiens de la littérature algérienne, dont l’auteur de ces lignes, en fixent une datation pertinente avec la publication dans une revue tunisienne, en 1891, de « La Vengeance du cheikh », nouvelle de M’hamed Ben Rahal (1855-1928), acteur connu et reconnu dans la société indigène, originaire comme Ahmed Bouri de Nédroma, dans la wilaya de Tlemcen.
Si la littérature des Français d’Algérie bénéficiait dans le pays d’un réseau dense d’éditeurs-imprimeurs, de diffuseurs et de libraires, de l’appui de la presse coloniale et d’un accueil exceptionnel de l’édition parisienne, les écrivains indigènes étaient dans une situation de précarité à la fois injuste et entretenue. En dehors d’Abdelkader Hadj Hamou, qui était un politicien indigène louangeur, en 1930, du siècle colonial, coopté dans l’Association des écrivains algériens, d’inspiration colonialiste, dont il est élu, aux côtés de son ami Robert Randau, vice-président de 1937 à son décès en 1952, aucun auteur algérien n’était reçu dans le milieu fermé de la littérature des Français d’Algérie et dans ses institutions. Si le Capitaine Ben Chérif (« Ahmed Ben Mostefa, goumier », 1920), fils de Grande Tente, soldat français, était parrainé, à Paris, par l’ancien gouverneur général Célestin Jonnart, plusieurs auteurs de la période, comme Omar Samar, Ahmed Bouri, Choukri Khodja, Aïssa Zehar se tournaient vers la presse indigénophile ou vers l’autoédition. Mohamed Sifi, compagnon de route du Parti communiste algérien (PCA), récipiendaire, en 1941, du Grand Prix littéraire d’Algérie, section indigène, pour son manuscrit « Souvenirs d’enfance d’un blédard », n’a pas trouvé un éditeur ou un imprimeur de la colonie pour le publier.
Le tournant des années 1950, requis dans l’argumentaire de Zaoui, doit plus à la vitalité du mouvement national, bientôt entré en guerre insurrectionnelle (1954-1962) pour la fin du colonialisme français et l’indépendance du pays, qu’au prodige d’auteurs, tous jeunes et inconnus, qui n’avaient à faire valoir que leur volonté d’être publiés. Cette période et cette littérature des années 1950 devraient-elle susciter d’inaltérables convergences franco-algériennes ? Face à la brûlante actualité d’une Algérie en guerre, les éditeurs parisiens ne pouvaient rater l’opportunité d’ouvrir leurs collections aux auteurs natifs d’un peuple en rébellion contre le colonialisme français, mais qui n’étaient pas ses représentants. Les attitudes de ces éditeurs ne manquaient pas d’être équivoques et Malek Haddad dénonçait, à partir de sa position et de celles de ses confrères et consœurs, les « Arabes de service » de l’édition française.
Cette littérature algérienne enregistrait, tout comme le peuple algérien en guerre anticoloniale, le soutien ferme d’une élite intellectuelle de gauche, qui ne le concèdera pas à l’Algérie indépendante. Amine Zaoui devrait réviser ses savoirs sur les désengagements et les défections de l’intelligentsia de gauche française relativement à l’Algérie, qui était sortie de ses réflexions ; il lira, avec profit, ce désaveu de l’Algérie et de ses dirigeants dans les mémoires de Simone de Beauvoir et de Jacques Lanzmann. Il est inadéquat, comme le prétend le chroniqueur, de croire que les écrivains algériens publiés par l’édition française, en ces années 1950, groupe d’individualités isolées, étaient unis et répondaient à l’idéal indépendantiste du mouvement national et du FLN, son fer de lance. Hors des poètes (Ahmed Taleb-Ibrahimi, Nordine Tidafi, Kaddour M’hamsadji, Jean El Mouhoub Amrouche, Hocine Bouzaher, Tahar Baïtar, Tewfik Farès) et des poétesses (Leïla Djabali, Zhor Zerari, Annie Steiner, Danièle Amrane-Minne, Nadia Guendouz, Malika O’Lahcen, Anna Greki), jetant leurs cris, parfois derrières les murs et les barreaux des prisons de la colonie et de la France, combien de romanciers ont concrètement milité dans leurs œuvres et en dehors d’elles dans la guerre libératrice ?
Les écrivains des années 1950 ont compté dans leurs rangs de remarquables auteurs dont les œuvres et les parcours appartiennent désormais à l’histoire littéraire – et, peut-être aussi à l’histoire politique. Ces derniers mois, la réécriture révisionniste de l’histoire battant son plein, Mouloud Feraoun aurait été, selon ses héritiers, un membre de l’ALN, et, dans cette logique imparable, Djamila Debêche, l’égérie de l’Algérie française défendant dans le dernier quart d’heure colonial la politique d’« intégration », serait une poseuse de bombes de la résistance urbaine. Arrêtons de créer des mythes.
L’art de la provocation anti-algérienne
J’ai pris le soin de lire quelques chroniques, récentes et anciennes, de Zaoui, pour comprendre d’où il parle, enfant perdu de la France néocoloniale. Son ordinaire se dilue dans les ombres en quart de ton des minarets de l’Islam, en le dégurgitant à longueur de colonnes. C’est foncièrement un provocateur dans la même ligne d’horizon que les buzzeurs Sansal et Daoud (qui a mis, ces derniers mois, de l’eau dans son vin), doublé d’un lèche-bottes de la France, moins fortuné et outillé.
Amine Zaoui décrie dans ses chroniques du quotidien de M. Rabrab l’Islam pour récolter quelques sympathies outre-Méditerranée et renouveler son bail à Paris. Le fait est que, contrairement à Daoud et à Sansal, qui ont pu créer des relais dans l’édition et les médias, en France, il a mené une première expérience éditoriale française, chez Fayard, lamentablement inaboutie. Il veut la relancer à travers ses brûlots au lance-flamme contre l’Islam et les Musulmans, un domaine dans lequel s’est révélé malencontreusement Boualem Sansal. Tant que le pouvoir algérien, qui a compris sa stratégie d’appel en direction des lobbies littéraires et médiatiques germanopratins, ne l’a pas jeté en prison, il fera du surplace : il ne retournera pas de sitôt – auréolé – à Paris.
Autre intérêt du chroniqueur : la Kabylie est un faux-semblant. La Kabylie n’est ni une région sinistrée ou confinée d’Algérie, elle n’a pas aussi l’exclusive onction de la démocratie, de la clairvoyance républicaine et de la modernité. Il veut s’attacher à force de flagorneries, parfois bêtifiantes, les lecteurs de cette région. Ils ne sont pas toujours dupes : tant mieux pour eux et pour la Grande Algérie que nous aimons.
Ce que je retiens de la chronique du 8 juillet 2021 de Zaoui, c’est une nième provocation sans honneur. Une insulte au drapeau et à l’hymne (qui est aussi une indépassable œuvre poétique de Moufdi Zakaria) de notre pays, qui rassemblent les Algériens, lorsque chaque jour, chaque heure de leur vie, ils font Nation. Derrière « Qassaman » et l’emblème national, c’est le sacrifice de millions d’Algériens pour donner une identité et une histoire à un peuple longtemps soumis. Il faut toujours le rappeler : la France n’a pas offert l’Algérie aux Algériens, elle est l’aboutissement de leurs sacrifices au gré de siècles de douleurs. Amine Zaoui, écrase l’hymne et l’emblème de l’Algérie, il y a des lois pour ces méfaits. Tout en admettant que « l’hymne national et le drapeau sont la fierté et le symbole d’une nation », il assène son infâme credo : « Mais l’indépendance n’est pas le fait de planter librement et avec allégresse le drapeau national sur la terrasse d’un immeuble ou le balcon d’une institution ! L’indépendance ne s’arrête pas au bord de l’hymne national ‘‘Qassamane’’ entonné avec jubilation dans la rue ou dans la cour d’une école, elle est un projet sociopolitique qui mène le pays vers la modernité, dans la cour des grands ». Or, en Occident, aucun des « grands » pays que le chroniqueur prend comme modèles vertueux, à l’exemple des États-Unis d’Amérique où ils sont sacrés, n’ont brûlé leur hymne et leur drapeau pour parvenir à la modernité, à la démocratie et à la justice sociale. Ces valeurs restent attachées aux attentes et aux luttes quotidiennes des peuples unis autour de leur hymne et de leur drapeau. Mais, ce briseur des symboles et de l’identité de l’État algérien devrait encore faire un effort pour attirer l’attention de Bernard-Henri Lévy, le fossoyeur de la Libye, conspirateur de « guerres oubliées », de Pierre Assouline, le chef du lobby sioniste du champ littéraire français et de leurs comparses, entre autres l’officiant d’un « Front populaire » ressuscité.
Est-il envisageable qu’Amine Zaoui, recouvrant sa dignité d’écrivain et d’Algérien, en finisse avec des chroniques incendiaires brimant ses compatriotes, l’État algérien et son pouvoir, qui n’ajouteront rien à son parcours dans la littérature, qu’il s’attelle au grand œuvre qui l’imposera au niveau mondial sans aucune concession aux gourous et aux lobbies germanopratins. Son éditeur Dalimen, ou un autre, vendra le droit de reproduction de son œuvre, de ses œuvres, dans toutes les langues du monde et, vraisemblablement, choisira l’éditeur parisien à sa mesure pour sa diffusion en France. Il aura contribué à l’avènement de l’autonomie politique et esthétique d’un champ littéraire national algérien débarrassé d’archaïques tutelles d’une France littéraire néocoloniale, comme l’ont fait chez eux en Irlande, James Joyce et Samuel Beckett, sortant leur littérature nationale de l’ornière de la littérature anglaise, mais aussi dans des littératures dites mineures du monde, Naguib Mahfouz, en Égypte, Gabriel Garcia Marquez, en Colombie, Wole Soyinka, au Nigeria, Svetlana Aleksievitch, en Bielorussie, Imre Kertész, en Hongrie, tous Prix Nobel de Littérature. Mais ne rêvons pas trop. Cet écrivain qui sauvera l’Algérie littéraire et la conduira dans les rangs des grandes nations littéraires libres est à venir. Pour l’heure la seule préoccupation de Zaoui est de taper sur son pays, sur ses dirigeants qui ne sont pas, certes, toujours irréprochables, pour gagner un strapontin à Paris. C’est une démarche minable, affreusement minable.
Cinquante-neuf après l’indépendance de l’Algérie et l’accession à sa souveraineté territoriale et politique, l’autonomie de son espace littéraire national attend d’être proclamée. Insistons, là-dessus : contre la France et contre sa valetaille stipendiée.