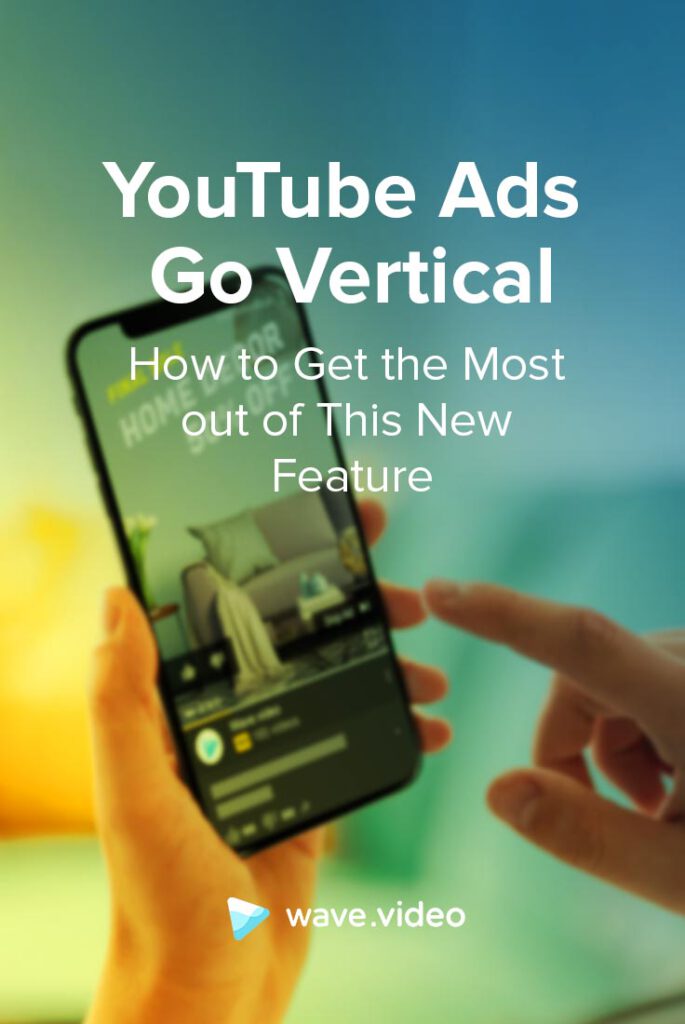Par Abdellali Merdaci
Institué récemment sous les auspices des autorités de l’Université Constantine 1-Mentouri, un prix littéraire, particulièrement dédié au roman, vient élargir la mince palette de consécration d’œuvres et d’auteurs algériens dans leur pays. Il faudra s’en féliciter, car il n’y a pas de vie littéraire sans la reconnaissance et les encouragements apportés aux écrivains. Dans tous les pays du monde, lorsqu’elles existent et lorsqu’elles sont appuyées par des institutions publiques, les compétitions d’auteurs et d’œuvres participent à l’évolution des champs littéraires nationaux et soutiennent la diffusion du livre.
Dans plusieurs contributions sur l’espace littéraire algérien, j’ai déploré l’absence d’interactions entre le lectorat, non quantifiable dans notre pays, et les écrivains. C’est la vocation des prix littéraires et des jurys qui les décernent d’accompagner, au-delà du travail des libraires, des critiques et des académies, l’enracinement social des textes littéraires et de la littérature, une des représentations les plus sensibles de la culture nationale.
Un jury de prix littéraire, spécialement sous l’égide de l’Université, garde relativement à la littérature et à ses lecteurs une mission d’orientation et de sélection des œuvres. Or, à l’Université Constantine 1-Mentouri, un jury vient de faire pour sa session inaugurale un choix d’œuvre qui n’est pas sans conséquences à la fois morales, politiques et historiques, en couronnant « La Kafrado. Un nouveau départ » (1), un roman typiquement colonial de Malika Chitour Daoudi, qui fait l’apologie d’une colonisation française de l’Algérie positive. Jusqu’à quel point le recteur de l’institution délivrant ce prix littéraire et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique assumeront-ils clairement la responsabilité de ce scandale politico-littéraire ?
Lire une œuvre

Connaît-on cette tirade de Guy de Maupassant sur le peuplement colonial de l’Algérie ? L’auteur d’« Au soleil » (1884), qui n’était pas un anticolonialiste avéré, le décrivait sévèrement : « C’est le pays du casier judiciaire, le royaume des apparences plus ou moins sauvées, la patrie des tares mal dissimulées. Et vraiment, sans le connaître, je plains l’Arabe, l’Arabe des provinces, que gouvernent ces gens » (2). Par hypothèse, il ne devrait pas y avoir pour un(e) Algérien(ne) de « bon colon ». On devrait pourtant croire en lisant le roman de Malika Chitour Daoudi, « La Kafrado », que c’est le cas, qu’il devait s’en trouver pour mériter près de deux cents pages d’une écriture – presque – raboteuse (3). Chitour Daoudi, dont c’est le premier roman, a envisagé de raconter une histoire spécifiquement coloniale, celle de l’appropriation de terres, souvent enlevées aux Indigènes, quand elles n’étaient pas négociées à vil prix ou saisies sur commandement du service des hypothèques pour non-paiement de dettes.

Le récit « La Kafrado » se situe en 1862, quelques mois avant les soulèvements des Ouled Sidi Cheikh, de Bou ’Amma et du massacre de la colonne Beauprêtre, en 1864, et bien avant la promulgation de la loi Warnier, en 1871, qui donne une assise juridique à la colonisation et à la francisation des terres indigènes. Roman de la terre, « La Kafrado » n’évite aucune des situations caractéristiques de la dépossession du patrimoine terrien ancestral des tribus et des familles indigènes. En voici le pitch. Pélissandre, un terne fonctionnaire des Chemins de fer, à Alger, prend une charge d’agent des Domaines dans la « ville du jujube » – Bône, dans l’Est algérien – pour mener sur le long terme une opération d’accaparement d’un vaste domaine en bordure d’une importante voie de communication urbaine : « J’ai trimé, intrigué pendant des années. Ma trame je l’ai tissée il y a bien longtemps » (p. 199), concède-t-il. Il est aidé dans ce projet par le capitaine Jean-Louis de la Vernerie, un nobliau de France, délesté de l’héritage du nom en vertu du droit d’aînesse, qui trouve un providentiel débouché dans la carrière des armes dans une Algérie progressivement occupée par son pays depuis la prise d’Alger, le 5 juillet 1830. Bône,conquise le 27 mars 1832, se souvenait des heures glorieuses des capitaines d’Armandy et Yusuf. Et, à leur image, le capitaine de la Vernerie rêvait de gloire, attendant de piéger et d’abattre un chef arabe séditieux dénommé Kader, le seul rival à sa mesure.
Cette ville maritime vit sur la Place des Armes, lieu de la distinction sociale où l’on se montre lorsqu’on n’est pas montré. C’est là que se décrètent les honneurs et les déchéances et que se tiennent les réjouissances recherchées, ainsi le bal de M. le Maire. Cette cité ronronnant dans ses demeures bourgeoises, assurée de la paix coloniale gagnée dans de meurtrières escouades contre les Indigènes rebelles, ne bruissait que des ambitions de Bruno le Maltais (4) de mettre la main sur l’immense propriété de Kader.
De la Sicile à l’Algérie française…
Pendant ce temps-là, en Sicile, « une jeune orpheline sincère, qui croit en l’amour » (p. 192) en est toute blessée pour songer à un destin au-delà de l’île natale. Francesca, aimée, abandonnée, meurtrie et terrorisée par Angelo, décide de partir en Algérie, colonie française ouverte à tous les peuples européens du nord de la Méditerranée. Elle y va toute déterminée, emportant dans ses bagages deux ceps de vigne qu’elle projette comme le symbole d’une nouvelle vie, loin de la misère de son pays et de l’oppression d’un amant volage. Issue d’une famille démunie, elle correspond au profil de ces candidats-colons du XIXe siècle qui tombent sur l’Algérie, ainsi que le notait un poète, « comme un vol de gerfauts ».
L’argent volé à Angelo peut soutenir cette ambition coloniale. En plus d’un trousseau de princesse, Francesca achète au marché une esclave noire du pays des Dogons qu’elle appelle Dorado, en raison de sa peau dorée. Elle ne manque pas d’assurance : « De fille du port je serais princesse de mes terres » (p. 8). Oui, de ses terres, soulignons l’expression. Et dans « le royaume des apparences plus ou moins sauvées », cette princesse se donne un nom et une lignée : Francesca Erina Giovanna de Casas a Castelli, une comtesse de Sicile. Avant l’embarquement nocturne pour l’Algérie, Francesca, aidée par Dorado, laisse Angelo, qui voulait l’en empêcher, gisant dans une mare de sang, grièvement poignardé, entre la vie et la mort. La fortune de la Contessa cache un crime inavoué, mais la colonie française d’Algérie est, répétons-le avec Maupassant, « le pays du casier judiciaire ».
Dès le lendemain de son arrivée à Bône, Francesca, qui se présente dans un accoutrement de princesse portant le deuil de son époux, commande à son aubergiste une calèche et un guide pour visiter le pays. En cours de chemin, l’accompagnateur arabe avise une jeune fille qu’il entreprend d’importuner, mais son père et ses hommes n’étaient pas loin pour s’en émouvoir. Il est abattu sans sommation d’un coup de fusil. Voilà les mœurs arabes étalées d’un trait fugace : on tue sans état d’âme l’imprudent fripon – ou la jeune fille adultère, comme dans « Chairs d’ambre » (1901) de Raymond Marival ; et, on s’entretue sans répit comme chez Ferdinand Duchêne (« France nouvelle », 1903). Le père de la jeune fille agressée, Selma, n’est autre que le fameux Kader dont les terres attisent bien de convoitises coloniales. Contre toute attente, la Contessa et sa servante Dorado sont l’objet d’une signalée attention du chef arabe, qui a tué leur guide, qui leur fait l’honneur de sa tente. Des égards qu’elles acceptent, s’adaptant naturellement aux codes du pays, méticuleusement décrits dans la littérature coloniale française d’Algérie. Dès lors, le récit plonge dans la typicité coloniale et il ne manquera pas de scènes de genres, parfois dans une description ethnographique, abusant de clichés et poncifs d’époque, notamment la séquence des liseurs de la Sainte Parole lors de la veillée mortuaire improvisée de Kader (pp. 127-128).
La rencontre de l’Étrangère et de l’Indigène a suscité autour des XIXe et XXe siècles plusieurs romans coloniaux. Et les mises en scène d’héroïnes françaises et européennes affrontant le « bled el khouf », le pays de la peur, sont suffisamment documentées dans la bibliographie littéraire de l’Algérie coloniale. Ainsi, « Drusilla, Dame d’Alger » (1930) d’Antoine Chollier, « Helia, une Française d’Algérie » (1932) de Jeanne Faure-Sardet. « La Kafrado » participe à la mythologie de la conquête française et de son peuplement colonial, mettant l’accent sur l’engagement de la femme européenne campée en personnage emblématique. Ce roman, écrit et publié par une Algérienne, en ce début de la troisième décennie du XXIe siècle, peut paraître paradoxal parce qu’il ressuscite un âge d’or de l’occupation française de l’Algérie. Kader va proposer à la Contessa Francesca d’acheter la partie la plus fructueuse de son domaine que Bruno le Maltais désire acquérir pour agrandir ses propres terres. L’opération se conclue très vite et voici la jeune orpheline, qui fut dans un passé proche une « fille du port » promise à une riche et respectée existence de propriétaire d’une terre bônoise, autrefois apanage d’un puissant lignage local. L’occasion pour elle de ressortir ces ceps de vigne, survivance d’ancrage sicilien perdu. Une relique de l’ancien monde dans le nouveau où elle veut prendre sa part et « un nouveau départ », comme l’anticipe le sous-titre du roman.

Malika Chitour Daoudi chronique distinctement cette entrée en Algérie, qui ne s’embarrasse pas de doute. Francesca le martèle à l’intention de Dorado : « […] je ne sens pas oppressée car nous sommes maintenant chez nous » (p. 25). Dans le pays et dans les terres enlevés aux Indigènes par la France – convient-il de le préciser ? À l’imitation du roman colonial, « La Kafrado » est un récit d’aventures aussi nombreuses qu’imprévues où la mort est présente. Même ambiance dépressive, mêmes menaces souterraines de toutes sortes d’ennemis où la nature – encore indomptée comme dans « La Fontaine rouge » (1953-1955) de Janine Montupet – joue un rôle maléfique : Francesca est longtemps atteinte de la fièvre des marais, qui a emporté plusieurs âmes dans le pays.
Une cruelle symbolique
Comme dans le roman colonial, insistons là-dessus, le récit de Chitour Daoudi construit une intrigue simple et introduit un ensemble de situations et de personnages distribués en archétypes : héros typés (la Contessa, Kader), faux-héros (le capitaine de la Vernerie), opposants (Bruno le Maltais et Maurice le Muet, temporairement, Pélissandre), adjuvants (Dorado, Lucas-Bataga, Youmma, Lella, etc.). La narration est partagée entre Francesca et Dorado, qui en sont les actrices principales, investies chacune de la vérité des faits, s’exprimant à la première personne dans une profusion de micro-récits enchaînés.
La colonisation de l’Algérie vécue par la Contessa Francesca promet-elle d’être éminemment positive ? La mise en valeur par la Sicilienne du domaine « la Kafrado » n’est pas passée inaperçue dans la « ville du jujube ». Mais, c’est le capitaine de la Vernerie qui lui attribue son statut de colon (et non pas de « colone » – p. 117 – comme l’écrit Chitour Daoudi, ce terme générique prend la marque masculin) : « Vous faites Contessa, une femme d’affaire très avisée. Vous avez transformé le domaine. Les produits que vous proposez au marché ont un succès certain ! Vous faites des jaloux en un temps record ! » (p. 99). « Transformer », un maître-mot s’agissant de l’économie coloniale qui se développe par l’exploitation intensive du travail des indigènes. La Contessa Francesca emploie plusieurs familles, qui étaient auparavant au service de Kader : « Ils sont quarante-deux à travailler pour moi » (p. 100). Elle déclare avec afféterie : « Le travail avançait bien. Le travail et la préparation des terres se font rapidement. Mes gens sont habitués à la tâche, et les bêtes et le matériel sont en nombre suffisant pour l’accomplir » (p. 72). « Mes gens », sûrement…
Au capitaine de la Vernerie, Francesca présente le portrait d’une patronne proche de ses ouvriers, un colon à la personnalité exceptionnellement humaniste : « […] le sort de mes employés ne m’est pas indifférent… » (p. 100), relève-telle en s’indignant des propos outrés du capitaine sur « ces sauvages d’arabes », réfractaires à la civilisation des conquérants. Pour autant, cette indigénophilie, cette « arabophilie », moins marquées que chez André Gide et Isabelle Eberhardt, affichée par son personnage principal sauve-t-elle le roman de Malika Chitour Daoudi d’une coloration « colonocentriste » (5) irrécusable ?
La romancière pose un marquage historique qui devrait l’absoudre de tout soupçon : la Contessa Francesca rappelle la figure révérée dans l’Orient chrétien de l’Émir Abdelkader et son ami Kader, dont la première épouse et ses deux enfants ont péri dans l’enfumade des grottes du Dahra par le lieutenant-colonel Pélissier, en 1845, est aussi le chef d’un groupe de résistants à la colonisation française. Cette double caution reste toutefois inefficiente dans le fonctionnement idéologique du roman, qui n’efface pas les contradictions de la nouvelle propriétaire de la Kafrado et l’emprise coloniale. Qu’elle soutient lorsqu’elle se préoccupe de tempérer les attentes et les ardeurs guerrières de Kader : « Pensez à Selma ! Que deviendra-t-elle quand son père sera en prison ? Ils sont trop forts, ils ont trop de moyens ! Voues êtes responsable de nombreuses vies. Vous l’avez dit vous-même. Ce sont des monstres ! Ils ne sont pas prêts de quitter ce pays. Faites-vous une raison et acceptez de partager les terres de vos ancêtres » (p. 116). Invitation à un partage de dupes et au défaitisme.
Prétendument mort dans un incendie, stratagème pour disparaître de la localité de Bône et se consacrer à son combat contre les colonisateurs et les spoliateurs, Kader se dépouille de ses terres au profit de sa fille Selma, encore adolescente, et confie la tutelle de l’héritière et la gestion de ses biens à la Contessa Francesca. Dans cette projection de la romancière, il y a une colonisation vertueuse, celle de Francesca et de son amant Angelo qui la rejoint dans d’inattendues retrouvailles dont le chef arabe rebelle Kader se porte garant. Cependant, Siciliens, Francesca, souillon de port, et Angelo, pilier de taverne dont les seules ressources proviennent de jeux de hasard, intègrent le melting pot colonial, bientôt francisé, qui réunit à l’exclusion des Arabo-berbères, Espagnols, Mahonnais, Maltais, Grecs, Italiens, Alsaciens, Allemands. La confiance de Kader (et, derrière lui, l’autrice) est bien placée.
Si la Contessa et Angelo marchent vers un avenir de riches colons d’Algérie, Kader, confronté à de sporadiques assauts contre l’armée coloniale, sait que tout est compromis pour lui, qu’il ne reviendra pas auprès de sa mère et de sa fille. Sa destinée est de mourir en combattant, sans rien changer dans l’avancée victorieuse de la colonisation française de l’Algérie dont le réputé domaine La Kafrado est le modèle envié. À l’échelle du pays, cette symbolique du transfert des terres et des pouvoirs aux colons qu’illustre et asserte le roman de Malika Chitour Daoudi est cruelle.
Un prix injurieux envers l’Algérie
Publié au printemps 2021, au lendemain de la diffusion du rapport Stora sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie », le roman de la colonisation heureuse de Malika Chitour Daoudi écrit une histoire de la conquête française de l’Algérie à travers la douce captation de terres par la rouée princesse d’opérette Francesca, qui serait acceptable pour Kader, propriétaire déchu, et par capillarité pour les Algériens. Cette vision euphorique du monde colonial et de la colonisation, accentuée par la réussite foudroyante d’une Sicilienne sans capitaux matériels et symboliques, fut-elle consciente pour l’autrice ? Entre le roman d’aventures avec ses nombreuses péripéties sanglantes et le roman à l’eau de rose, ainsi les tribulations d’amants siciliens terribles, « La Kafrado » témoigne de l’irrésistible ascension de l’œuvre de peuplement et de colonisation de la France en Algérie.
Osons une rapide comparaison d’intentions d’auteurs pour relever ce qu’il y a d’excessif dans les conclusions du roman de Chitour Daoudi. Pourquoi, dans le temps de son écriture, le regard de la romancière de « Kafrado » sur les colons européens est-il moins critique que celui d’Abdelkader Hadj Hamou écrivant, au début de années 1920, « Zohra, la femme du mineur » (1925), mettant énergiquement en cause dans le personnage de l’Italien Grimecci, qui corrompt Miliani, le mari de Zohra, la politique coloniale française de peuplement de l’Algérie ? Pourtant, en son temps, Hadj Hamou, élu indigène, vice-président de l’Association des Écrivains algériens d’obédience coloniale, proche de Robert Randau, était le soutien inébranlable de la France coloniale et de sa présence en Algérie.
Il n’y a pas de colonisation positive et il n’y a pas de « bon colon » comme le suggère « La Kafrado ». Collectivement ou individuellement, la colonisation française de l’Algérie, œuvre sans égale dans l’histoire de l’humanité de dépossession des terres, de déplacements de populations, avec son cortège d’infinies guerres sanglantes, n’est ni excusable ni amendable. Rien ne devrait justifier dans l’Algérie de 2022, qui vient de sortir d’une longue brouille mémorielle et diplomatique avec la France en raison des propos inconsidérés de son président sur l’existence de la nation algérienne, qu’un roman expressément colonial écrit par une Algérienne reçoive les honneurs d’un prix littéraire décerné par une institution officielle de l’État, l’Université Constantine 1-Mentouri. Si Malika Chitour Daoudi a la liberté de penser et d’écrire selon des choix politico-idéologiques discutables, en en prenant la responsabilité auprès de ses lecteurs et de l’opinion publique, appartient-il à l’Université algérienne de consacrer un hymne à la colonisation française et à sa politique de peuplement de l’Algérie ? Le jury qui a voté à l’unanimité cette récompense mortifère et injurieuse envers les souffrances de l’Algérie sous la domination coloniale française, le recteur de l’Université qui l’a proclamée et le ministre de tutelle devraient-ils échapper à leur responsabilité devant ce qui est un dévoiement de l’unité nationale ?
Notes
- Alger, Casbah Éditions, mars 2021.
- Cf. « À vol d’oiseau », « Le Gaulois » [Paris], 17 juillet 1881. Texte repris dans « Au soleil » (1884).
- Dès l’incipit (p. 7), une erreur de transcription : « cerf », animal ruminant des forêts, au lieu de « serf », paysan attaché à la glèbe dans l’économie médiévale. L’autrice confond le démonstratif « ce » et le pronom personnel réfléchi de la 3e personne du singulier et du pluriel « se » (entre autres, pp. 11, 54). Plusieurs passages dans le texte relèvent davantage de l’expression orale que de l’expression écrite. L’imprévisibilité linguistique que supposent des personnages de différents horizons (arabe, berbère, italien, sicilien, français, dogon) est surmontée artificiellement pour les stricts besoins de communication du récit.
- Ce personnage apparaît dans le récit sous deux patronymes : il se présente sous l’identité de « Bruno Lauratini » (p. 50) et devient « Bruno Guardilimo » dans la narration de Francesca (p. 83). Probable distraction dans la révision du texte par l’autrice ?
- Alain Calmes qualifiait sous ce concept un sous-genre du roman colonial marqué par la prévalence de l’œuvre coloniale française en Algérie (Cf. « Le Roman colonial avant 1914 », Paris, L’Harmattan, 1984). Robert Randau, un de ses chefs de file et théoricien de « l’algérianisme », poussait les écrivains de sa mouvance à peindre « la plus belle Algérie »