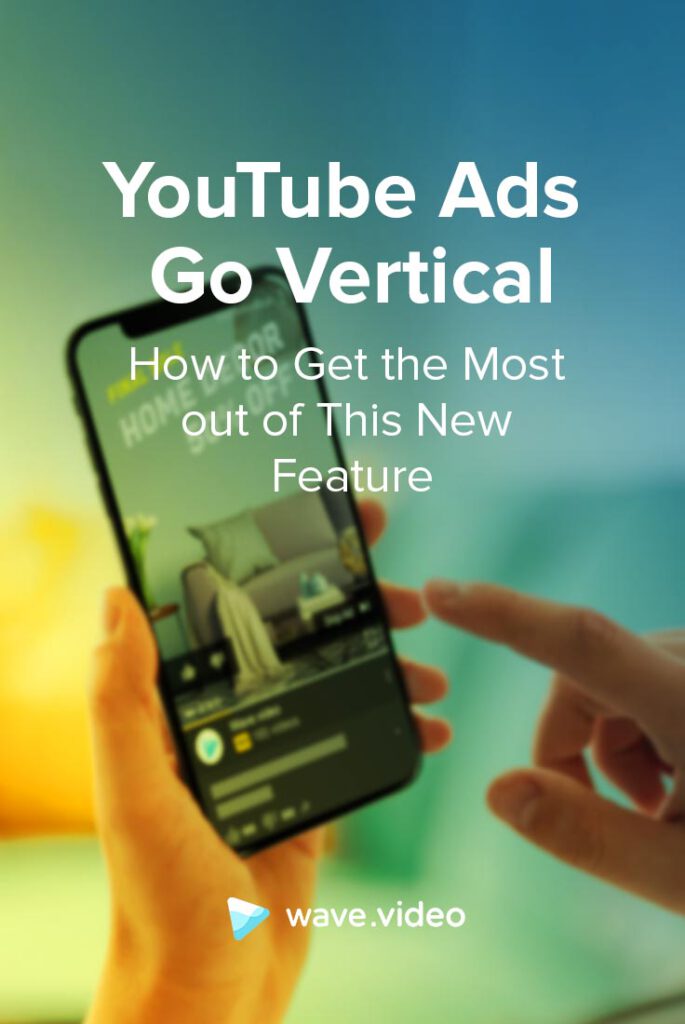Par Abdellali MERDACI
Depuis quelques années, les descendants de l’écrivain Mouloud Feraoun, à leur tête son fils aîné Ali, président de la Fondation Mouloud Feraoun pour l’Éducation et la Culture, ont entrepris de réécrire l’histoire de leur père, souvent une triste hagiographie, circonvenant les faits réels, vérifiables.
Ali Feraoun et sa sœur Faïza font table rase du parcours dans la littérature et dans les Centres sociaux éducatifs (1) de l’écrivain et « Instituteur du Bled ». Leur fallait-il pour sortir de l’oubli leur père souiller, en 2014, la mémoire d’Emmanuel Roblès et de Paul Flamand, des éditions du Seuil, à Paris, et en 2021, de Max Marchand, Robert Eymard, Salah Ould Aoudia, Marcel Basset, Ali Hammoutène, animateurs des Centres sociaux éducatifs en Algérie ? Le correspondant d’Algérie Presse Service à Tizi-Ouzou rapporte les propos d’Ali Feraoun au « Forum » de la RTO (Radio Tizi-Ouzou), début mars 2021, sur la tuerie de Château-Royal (2) : « Pour lui, les autres victimes assassinées ce jour lors de l’attentat qui a coûté la vie à son père n’étaient que des ‘‘victimes collatérales destinées à maquiller son assassinat et à faire croire à un attentat quelconque’’ » (3). Déclaration abjecte, enlevant leur destin et leur martyr à des hommes de conviction.
L’auteur du « Fils du pauvre » (1950, 1954) avait-il besoin de ce déferlement de haine de ses enfants pour revenir dans l’actualité de son pays ? Chaque 15 mars, les Algériens se souviennent de l’écrivain Mouloud Feraoun, assassiné peu de temps avant la signature des Accords d’Évian par les représentants de la République française et du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), mettant fin, le 19 mars 1962, à la guerre d’Algérie (1954-1962). Le 15 mars 1962, un homme et cinq de ses compagnons des Centres sociaux éducatifs étaient assassinés par un commando de l’OAS, mouvement paramilitaire fasciste de la communauté française d’Algérie. Cet homme était un écrivain prometteur de la jeune littérature algérienne de langue française. Mais aussi un acteur du champ politique de la colonie qui ne fut pas irréprochable : plus d’un demi-siècle après sa disparition, ses ayant-droit ne l’acceptent pas, quitte à se fourvoyer dans de désolants mensonges sur fond de haine et de règlement de compte.
L’indélicat jeu d’ombres d’héritiers infatués
Ce n’est pas la première fois qu’Ali Feraoun réécrit, à nouveaux frais, le passé politique de son père. En 2012, il annonçait un scoop à la journaliste d’« El Watan » Nassima Oulebsir, se prévalant de documents qui attestent de l’intégration de son père à la Glorieuse Armée de libération nationale :« On reprochait à mon père de ne pas s’être engagé dans la Révolution. Or, aujourd’hui, je détiens la preuve qu’il était membre de l’ALN » (4). Mais où sont ces documents qui en imposeraient à tous ? Disons sans détour les faits assignables à l’histoire du mouvement national pendant la période d’insurrection armée anticoloniale :
Feraoun n’était ni un compagnon de route du FLN ni, encore, impliqué dans la marche de la Glorieuse Armée de libération nationale. Aucune recherche historique, aucun témoignage de combattants, n’en font état.
Rappelons-donc d’ineffaçables pages de l’histoire coloniale. Conseiller municipal de Fort-National (Larba Nath Irathen), Mouloud Feraoun a été l’un des rares écrivains, sinon l’unique écrivain de l’après-Seconde Guerre mondiale, à briguer un mandat électoral et à se projeter pleinement dans la politique locale. Il rendra son mandat vers la fin du mois de décembre 1955, craignant les représailles du FLN : « Nous avons tous démissionné dans les délais fixés » (« Journal, 1955-1962 », Paris, Seuil, 1962, p. 50). Mais, jusqu’au début de l’année 1956, il était convaincu que sur les événements qui troublaient le pays force reviendrait à la loi, précisément à la loi coloniale. Comme il l’écrit dans une note du 7 janvier 1956 du « Journal » :« Les journaux parlent en gros titre de mon collègue Dupuy enlevé jeudi. Ses deux adjoints ont pour ainsi dire été relâchés, mais lui est emmené par les rebelles. Il a dit à l’un de ses adjoints : « C’est moi qu’ils veulent. » Qu’a-t-il fait le malheureux ? Jusqu’ici les patrouilles sont restées impuissantes. Arrêter des suspects (?). Evidemment » (p. 57).
Que font donc la police, la gendarmerie, l’armée et leurs patrouilles, s’inquiète-t-il ? Assurément, ce ne sont pas les paroles d’un sympathisant de la guerre anticoloniale. Voilà Feraoun, tout entier dans cette notice du 7 janvier 1956. Cette année, dans le pays qui s’enfonce dans la guerre, observant la paralysie de l’activité politique dans la colonie, l’écrivain Feraoun n’a pas rompu avec l’état-major de l’armée française combattant les soldats de l’ALN en Kabylie, notamment avec son chef le général Olié à qui il fait parvenir discrètement, insiste-t-il dans son « Journal », son dernier ouvrage « Jours de Kabylie » (1956), aimablement dédicacé: « Hier, j’ai chargé H. de porter discrètement à la sous-préfecture un exemplaire de Jours de Kabylie avec dédicace pour le général Olié. Le sous-préfet se chargera de le faire parvenir. Il a approuvé cette discrétion, estime que je ne saurais être trop prudent et que quelle que soit mon attitude actuelle, ils me comprennent tous. ‘‘M. F. est un homme d’avenir. Nous avons confiance en lui’’ » (p. 132).
Ali Feraoun veut-il jeter une chape de plomb sur le général Olié ? Il dédouble la relation qu’entretenait son père avec le chef de l’Armée coloniale en Kabylie, clairement évoquée dans les notes de son « Journal », par celle qui l’aurait lié au colonel Saïd Mohammedi, chef de la Wilaya III, qu’il révèle pour la première fois publiquement au « Forum » de la RTO. Se rengorge-t-il de ce nouveau scoop sans lendemain ? Le colonel Saïd Mohammedi, ancien officier de la Deutsche Arabishe Legione, titulaire de plusieurs médailles de guerre du IIIeReich, nazi proclamé est l’ordonnateur des massacres – crânement revendiqués – de Melouza (5) sur lesquels l’écrivain-diariste s’exprimait en ces termes : « Une honte ! Une honte, un acte imbécile par quoi tout un peuple se condamne et découvre avec imprudence sa barbarie » (« Journal », p. 235). Quel dialogue absurde pouvait réunir le lecteur ému de « Jean-Christophe » (1904-1908) de Romain Rolland avec le maître d’œuvre du carnage de Melouza ? Cette scène de leurs conversations nocturnes serait une page digne d’un théâtre ubuesque.
Comment l’homme politique qu’est resté Feraoun, en dépit des drames quotidiens de la guerre minutieusement reportés dans son « Journal », a-t-il pu, comme le soutient son fils Ali Feraoun, procéder à une radicale révision politique pour rejoindre les moudjahidine de l’ALN ? Mensonges obstinément répétés pour amender un parcours politique qui fut ambigu. En vérité, il n’y a pas pour Mouloud Feraoun, après son retrait de la municipalité de Fort-National, de repli définitif de la politique ni de changement de cap.
Les engagements politiques de Feraoun pendant la Guerre d’Indépendance le portent du côté de la collaboration avec les forces coloniales. S’il se dressait contre le FLN-ALN dans nombre de pages de son « Journal », il détestait avec la semblable hargne les extrémistes français ; il s’en ouvrait de cette nécessité à deux reprises dans des lettres à l’islamologue arabisant Paul Flamand, directeur des Éditions du Seuil, l’informant de l’écriture de son « Journal » ; le 23 décembre 1957 : « Enfin, j’ai tenu un journal qui relate tout ce dont j’ai été témoin depuis mon dernier voyage à Paris, bientôt trois ans. Un brûlot rageur ou chacun en a pour son compte » (6) ; le 6 août 1961 : « Si jamais un tel livre voyait le jour, les gens comprendraient que la guerre d’Algérie n’est pas une plaisanterie et TOUS les guerriers en prennent pour leur grade » (7). D’un côté le FLN-ALN, de l’autre l’armée coloniale et les extrémistes français et au milieu, la République et la France éternelle, idéalisée, qui lui est un havre dans le remugle des tueries. Feraoun se tenait dans un entre-deux propitiatoire. Est-il possible de raturer les pages de son « Journal » qui l’énoncent sans équivoque ?
Et, au-delà de la guerre, cette inentamable animosité envers le FLN, partagée dans la famille Feraoun. Dans une conférence à Haïzer (Bouira), en 2014, Ali Feraoun devait s’en prendre rudement au FLN : « Quand le journal de Feraoun est sorti en 1962, les gens du FLN ne l’ont pas aimé. Ils n’ont pas aimé que Feraoun dénonce les complots qu’ils étaient en train de faire depuis 1958 » (8). Quels complots de la guerre révolutionnaire dont il aurait été acteur ou témoin a dénoncés Mouloud Feraoun dans son « Journal » ? La seule évidence reste que l’écrivain ne pouvait s’empêcher de taper fort sur les militants et moudjahidine FLN-ALN, utilisant à l’envi pour les désigner les vocables « fellagha », « rebelles », « terroristes ».
Il faudra bien sortir de la fiction, construite par ses héritiers, d’un compagnonnage de l’écrivain kabyle avec la Glorieuse Armée de libération nationale. Au plus fort de la guerre, l’avenir de l’Algérie auquel aspirait Feraoun réunissait, toujours sous la protection de la France, les modérés des deux camps : « Vive la France, telle que je l’ai toujours aimée. Vive l’Algérie, telle que je l’espère », « Journal », pp. 319-320). Et ces mots prémonitoires adressés à Jean Pélégri au mois de janvier 1961 : « Dites bien à Honorât ma sympathie, ma profonde tristesse parce que, en tuant C[otensou] c’est un peu vous tous qu’on a tués et si un jour la chose m’arrivait, vous pourriez pleurer aussi en songeant que c’étaient tous vos frères — ceux qui vous ressemblaient — musulmans qui étaient tombés. Ils seraient morts frappés par n’importe quelle main : celle qui a frappé C[otensou] ou celle qui aurait pu le frapper… » (« Journal », p. 342). L’OAS, d’une part, le FLN, de l’autre, dans un terrible engrenage.
L’écrivain n’a jamais été aussi ferme dans ses choix politiques. Cette Algérie rêvée n’était pas celle pour laquelle mouraient ses frères et ses sœurs derrières les ubacs, dans les maquis embrasés par le napalm français. Pourquoi en faire un révolutionnaire de la Glorieuse ALN, le fusil au pied ? Odieuse falsification des faits.
Les foucades d’Ali Feraoun
Pour quelles obscures motivations, les ayant-droit de Mouloud Feraoun s’en prennent-ils aux personnes qui ont été proches de leur père ? Ali Feraoun, en maître d’œuvre d’une infamante destruction dans trois actes d’un théâtre de haine et de mensonges.
1) EMMANUEL ROBLÈS ET PAUL FLAMAND. En 2014, Ali Feraoun vilipendait les éditeurs de son père, Roblès et Flamand, dans des propos offensants et insoutenables (9). En cause, le traitement de deux romans de Feraoun : « Le Fils du pauvre » (1954) et « L’Anniversaire » (1959, inédit ; réédité par ses héritiers, en 2007, sous le titre « La Cité des roses », Alger, Yamcom). Il en ressort une mise en cause tonitruante prononcée lors d’une conférence à Haïzer (Bouira) au mois de janvier 2014 : « Si on parle de l’assassinat de Feraoun, son entrée dans les éditions le Seuil, ça a été déjà une trahison et un assassinat. Et c’est Roblès qui l’a fait »(10). Propos ignobles, qui ne correspondent pas au travail éditorial de Roblès et à l’accompagnement fraternel qu’il a toujours voué à Feraoun. En quoi l’entrée au Seuil de Mouloud Feraoun, qui le révèle comme écrivain, fut-elle un « assassina » et une « trahison » ? Roblès a-t-il vraiment détourné les textes de Feraoun, et le tout premier d’entre eux « Le Fils du pauvre », pour être châtié par le fils ?
Ce texte, promu dans les années 1960-1970 par le Père Jean Déjeux, au détriment des vérités d’une histoire littéraire qui restait à écrire, comme le texte fondateur de la littérature algérienne de langue française, est passé par plusieurs phases d’écriture et constituait dans son ultime version publiée à compte d’auteur, en 1950, à Pau, aux Cahiers du Nouvel Humanisme, un ensemble incohérent dont la seconde partie (« Fouroulou Menrad », composée de trois chapitres) a été retranchée par l’auteur comme l’explique l’éditeur dans une note infrapaginale expliquant sa publication dans « L’Anniversaire » (1972) : « Ces trois textes figuraient dans l’édition originale du récit « Le Fils du pauvre ». Mouloud Feraoun les en a retirés avec le dessein de les incorporer plus tard dans un second ouvrage autobiographique. On trouve une trace de ce projet dans sa lettre du 17 juillet 1956 (Cf. « Lettres à ses amis ») où il écrivait : ‘‘Je voudrais aussi terminer la suite au Fils du pauvre’’. Si la vie est longue… » Il avait commencé à retoucher une partie de ces pages en vue de cette utilisation » (p. 103). Roblès et Flamand, c’est bien leur rôle d’éditeurs, ont-ils demandé à Feraoun d’enlever cette seconde partie ? L’auteur en assume seul l’entière responsabilité. Mais est-ce une humiliation, une blessure indélébile au front de l’auteur et de sa famille ? À titre d’exemple, à la même période, au Seuil, Jean Cayrol, directeur de collection, faisait réécrire plusieurs fois « Nedjma » par Kateb Yacine, qui s’y était prêté. Il est communément admis que « Le Fils du pauvre », dans sa mouture du Seuil, a consacré mondialement Feraoun et lui a donné sa légitimité d’écrivain. Ali Feraoun dénonce Roblès qui a ouvert à son père les portes du Seuil et un chemin dans la littérature et l’accuse perfidement et malencontreusement. Hors du Seuil et de sa collection « Méditerranée », aucun éditeur parisien n’aurait, en ces années 1950, accueilli un auteur particulièrement provincial. Pourquoi tant de haine ?
Mouloud Feraoun saluait dans son « Journal » le dévouement de Roblès, son ami et ancien condisciple de l’École normale de Bouzaréa : « Je reçois fréquemment des lettres de Roblès. Dans cette faillite de la camaraderie et de l’amitié, la sienne n’est restée fraternelle et entière. Mais Roblès n’est pas seulement un ami ou un Français. Je ne lui donne aucune patrie car il est de n’importe où, c’est-à-dire exactement de chez moi » (p. 161). Dans une lettre-testament qu’il lui adresse le 26 décembre 1959, Feraoun, régulièrement menacé par les ultras de « Résistance Algérie », l’alerte : « Tu agiras en cas de pépin |…] Tu t’occuperas des manuscrits » (11). L’éditeur du Seuil, mais aussi l’ami et le frère, a recueilli, révisé et édité les manuscrits laissés par Feraoun, notamment « Le Journal » (1962), la correspondance (« Lettres à ses amis », 1967) et les quatre premiers chapitres d’un roman inachevé, portant en titre « L’Anniversaire » (1972), auxquels sont rajoutés des articles publiés dans des revues et la seconde partie expurgée du « Fils du pauvre ». Roblès a été fidèle à cette prière de son ami disparu. Mais les héritiers Feraoun ont conservé par devers eux quelques textes qui échapperont à sa vigilance. En 2020, les Éditions El Kalima, à Alger, publient à leur initiative sous le titre « Le Tueur et autres inédits » les derniers textes inédits de Feraoun. Il n’y en aura pas d’autres.
2) LES « AUTORITÉS COLONIALES ». Au « Forum » de la RTO, Ali et Faiza Feraoun mettent en cause les « autorités coloniales » accusées d’avoir censuré « la pensée » de leur père. Mais qui donc, hors de la sphère privée, connaissait, en ces années de guerre, la « pensée » du « Fils du pauvre », qui a été divulguée post-mortem dans les pages de son « Journal ». Mais regardons-y de plus près : ces « autorités coloniales » ne sont qu’un épouvantail, un « bourourou ». Mouloud Feraoun raconte dans son « Journal » une anecdote éclairante. C’était, au mois de septembre 1956, à la réunion de la djama de Fort-National. Chacun y exprimait ses récriminations envers les Français. Et l’écrivain et homme public y rajoutait du sien à ce concert de lamentations. Mais, il devait reconnaître le caractère artificieux de son discours devant la djama : « Le premier soir à la djama, tout le monde m’écoutait parler et j’exagérai complaisamment mes griefs contre les Français de Fort-National pour bien souligner que j’étais un persécuté comme les nôtres […] Erreur. Ils s’en fichent. Ils savent à quoi s’en tenir : que du côté français précisément, je ne risque pas lourd » (« Journal », p. 146) ». L’écrivain savait qu’il était protégé des sanctions officielles, celles que pouvait infliger l’ordre colonial au tout-venant. L’écrivain, célébré à Paris, était intouchable en Algérie. Les institutions de l’État colonial y veillaient. Et ses ouvrages, circulant librement dans les librairies du pays, n’ont pas connu la censure militaire.
À quel moment de son parcours dans la guerre, Feraoun, ami respectueux du général Olié, a-t-il été censuré par les autorités coloniales ? Ali et Faïza Feraoun ne le disent pas et, là encore, ils n’en donnent pas d’irréfutables preuves. Ce qui était, par contre, établi, indiscutablement établi, c’est l’aura de l’écrivain en Algérie et en France, qui pouvait convoquer, depuis sa terre de Kabylie, le ban et l’arrière-ban de la presse parisienne et algéroise, pour marteler ses vérités – sa « pensée » – sur la guerre d’Algérie : il ne l’a jamais fait et il n’a jamais songé à le faire. Jusqu’au bout, il s’est montré assez prudent pour rechercher une confrontation aux autorités coloniales, qui le ménageaient en raison de ses ancrages littéraires parisiens.
3) LES ANIMATEURS DES CENTRES SOCIAUX ÉDUCATIFS. Cette institution, spécialisée dans l’éducation de base (EDB), dépendant du rectorat de l’Académie d’Alger, a été créée en 1955 par le gouverneur général Jacques Soustelle répondant à de propositions de Germaine Tillon pour sortir une grande partie de la population indigène du sous-développement. Dans des bidonvilles des cités et dans les campagnes où sévissaient depuis longtemps la misère, la maladie, le chômage, l’ignorance, un million sept-cent mille enfants algériens n’étaient pas scolarisés. Triste constat d’une colonisation qui ne fut pas civilisatrice. Feraoun, qui avait demandé son affectation aux Centres sociaux éducatifs en 1960, devait vite déchanter et déposer une lettre de démission, instamment refusée. Le 8 avril 1961, il fait part de sa désaffection à Roblès : « Aux centres sociaux, je fais un travail assommant dont je me fiche éperdument et qui n’intéressera jamais personne » (12). Pour autant, il y côtoyait des amis et collègues estimés, notamment Salah Ould Aoudia avec lequel il parcourt les régions démunies du pays dans d’infinies et improbables enquêtes de terrain.
Il est certain que la création des Centres sociaux éducatifs dans l’Algérie en guerre recèle des arrière-pensées des autorités coloniales, mais comment juger que les collègues de Feraoun (qui s’employaient à rattraper le retard de la population indigène) manquaient de conviction et de sincérité dans leur charge, fréquemment mis en cause par les chefs de l’Armée française et les milieux fascistes européens. Au « Forum » de la RTO, Ali Feraoun renoue avec l’infamie de ses premières attaques contre les éditeurs de son père, en piétinant les sépultures de ses amis et collègues des Centres sociaux éducatifs, rabaissés en « victimes collatérales ». Ne va-t-il pas jusqu’à inventer la fourberie d’un assassinat collectif « maquillé », parce que la seule cible des tueurs de l’OAS était l’écrivain Feraoun ? Nouvelle ignominie. Max Marchand, Robert Eymard, Salah Ould Aoudia, Marcel Basset, Ali Hammoutène, ne sont pas morts, assassinés par l’OAS, pour leur engagement dans les Centres sociaux éducatifs, et leur martyr pour une généreuse idée de la République, qui a manqué à l’Algérie française, leur est dénié. Dans un document publié par l’Association des amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leur compagnons, présidée par Jean-Philippe Ould Aoudia, il y a la réponse sans fioriture à la question « Pourquoi sont-ils morts ? » : « Max Marchand, Mouloud Feraoun et leurs compagnons sont morts parce que comme beaucoup d’hommes et de femmes de même conviction, ils ont cru et ont travaillé à une Algérie plus fraternelle, fondée sur la tolérance l’égalité et fortement imprégnée des valeurs de la République. Ces enseignants ont mis leurs actes en accord avec cet idéal parce qu’ils estimaient que cela faisait tout simplement partie de leur mission éducative » (13). Ali Feraoun est relativement aux collègues de son père dans un reniement choquant, irresponsable et immoral. Ces éducateurs n’avaient donc ni conviction, ni valeurs, ni idéal. Cette mort sacrificielle des dirigeants et inspecteurs des Centres sociaux éducatifs était aussi celle de son père.
Ali Feraoun est volontairement dans l’injure pour liquider de supposés conflits avec les Éditions du Seuil et les Centres sociaux éducatifs, que ne lui a pas légués l’écrivain-instituteur. Et dans le mensonge absurde, faisant de son père un membre de la Glorieuse ALN, pour racheter les scories d’attachements politiques condamnables. Il est tout à fait remarquable que l’Algérie indépendante de Ben Bella et Boumediene ait respecté le grand écrivain kabyle, qu’elle ne se soit jamais opposée à sa célébration dans ses écoles et dans ses manuels scolaires, avant de l’oublier résolument. Feraoun n’était pas Paul Morand, Louis-Ferdinand Céline, Drieu la Rochelle, Lucien Rebatet, Alain Laubreaux, Robert Brasillach, Jacques Chardonne, maîtres à penser de la collaboration avec le régime nazi, encore moins un soldat perdu des « SS Mohamed ». Il était et il est resté, malgré de vives désillusions, un enfant de la France de la IIIeRépublique. L’Algérie n’a pas gardé l’homme, elle a toléré l’écrivain. Personne n’a le droit, et principalement ses héritiers, de réviser ou de falsifier les engagements publics de Mouloud Feraoun devant son pays et devant l’Histoire.
Notes
1. Cf. sur cette institution, l’ouvrage de Serge Jouin, Marcel Lesne, Louis Rigaux, Jacques Simon, « L’École en Algérie : 1880-1962. De la Régence aux Centres sociaux éducatifs », Paris, Publisud, 2001. Préface de Nourredine Saadi.
2. Jean-Philippe Ould Aoudia, « L’Assassinat de Château-Royal », Paris, Éditions Tiresias (Textes de Pierre Vidal-Naquet, Germaine Tillon, Emmanuel Roblès).
3. Algérie Presse Service (APS), « La pensée de Feraoun victime de la censure des autorités coloniales », c-r du « Forum » de la Radio de Tizi-Ouzou, reproduit dans « L’Est républicain » [Annaba], 7 mars 2021.
4. Cf. « El Watan Week end » [Alger], 19 mars 2012.
5. Sur la reconnaissance du massacre de Melouza par Mohammedi Saïd, voir « Les Années algériennes », documentaires de Benjamin Stora et Bernard Favre, INA-France 2, 1991 ; Cf. Abdellali Merdaci, « Algérie, une suite allemande », Constantine, Médersa, 2008.
6. « Lettres à ses amis », Paris, Seuil, 1967, p. 137.
7. Id, p. 187.
8. Cf. Ali Cherarak, c-r de la conférence d’Ali Feraoun, « El Watan », 13 janvier 2014.
9. Cf. Abdellali Merdaci, « Une polémique franco-algérienne », « Reporters » [Alger], 11 février 2014.
10. Ali Cherarak, art. cité.
11. « Lettres à ses amis », oc., p. 163.
12. Id., p. 182.
13. Document repris dans Serge Jouin et alii, « L’École en Algérie : 1880-1962. De la Régence aux Centres sociaux éducatifs », oc.