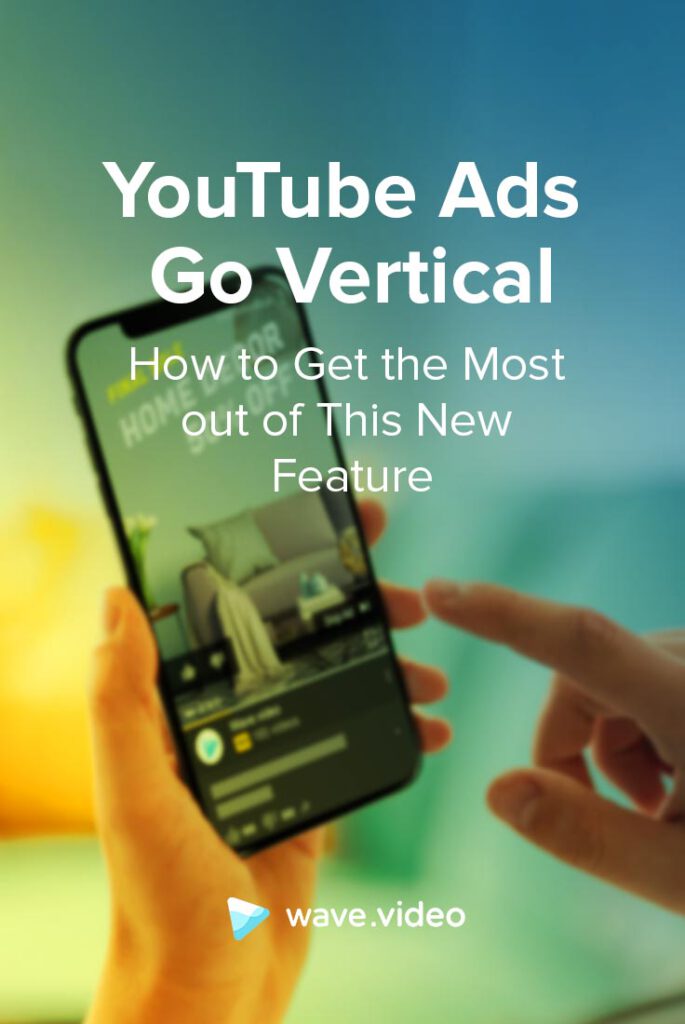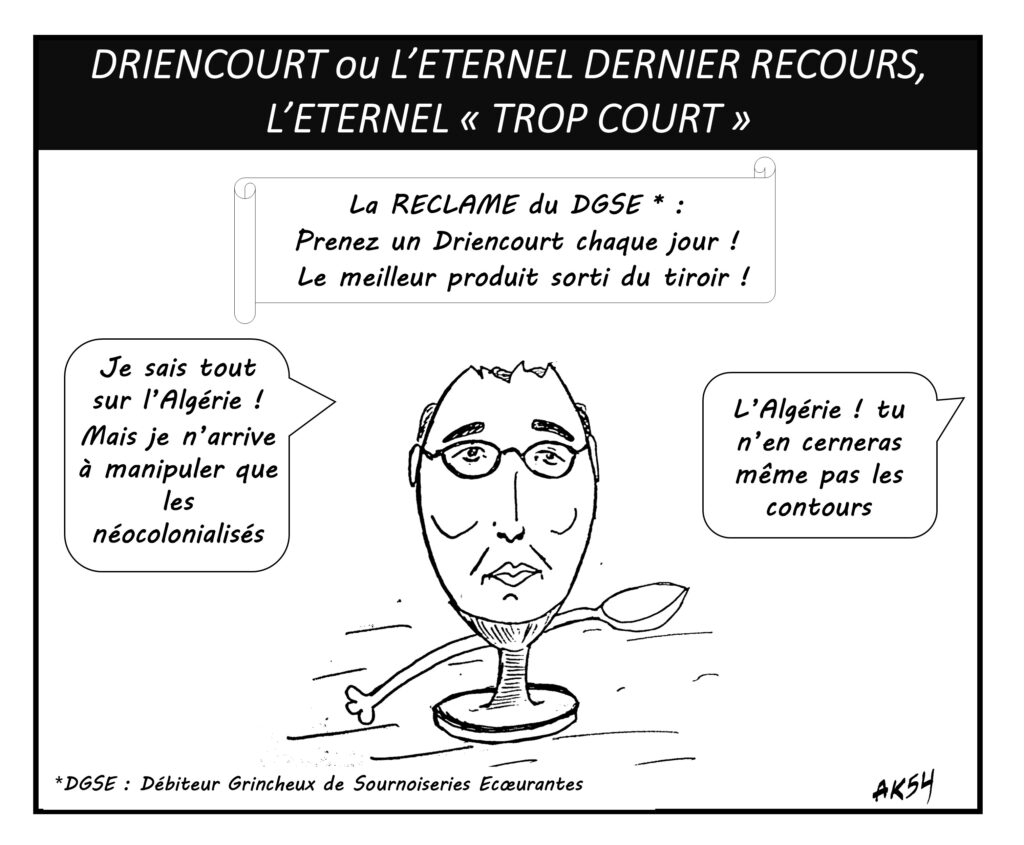Par Jacob Cohen
Le sionisme politique a réellement pris naissance dans la seconde moitié du XIX ème siècle, lorsque les idéologies nationalistes avaient embrasé tous les peuples européens. Certains États déjà constitués renforçaient leur nationalisme par l’expansion vers d’autres continents.
D’autres cherchaient des unifications politiques derrière une langue, un drapeau, un monarque, une idéologie.
C’est dans cette atmosphère de nationalisme exacerbé que des historiens juifs européens avaient décidé de réécrire l’histoire du peuple juif pour lui donner un caractère national, une continuité historique, des repères communs. Autrement dit d’inventer ex nihilo un nationalisme juif. Ce peuple sorti d’Égypte s’est établi
sur la terre promise, a vécu les glorieux royaumes de David et de Salomon, puis a connu l’exil et une errance de près de deux mille ans tout en restant fidèle et uni malgré la dispersion, avec pour seule et unique espérance le rétablissement de la nation juive.
Ce nouveau nationalisme avait donc un fondement cohérent sur lequel pouvait s’écrire une nouvelle page héroïque en lien avec le passé et tout à fait inséré dans l’air du temps. Les juifs dispersés mais unis par la tradition et surtout par leur désir de reconstruire l’État historique allaient se précipiter dans l’antique patrie et refermer une parenthèse accidentelle de deux mille ans. Ce mouvement qui avait la légitimité historique sur cette terre devait pouvoir y retourner sans difficulté puisque les peuples qui y vivaient n’avaient vraiment aucune attache. On prétendait même qu’ils n’aimaient pas leur terre et en tout cas la négligeaient.
Il est important de souligner que le sionisme politique est d’essence européenne, et plus précisément de cette Europe de l’Est en proie aux bouleversements de l’Histoire, des révolutions, des migrations, des transformations sociales et politiques. Il n’aurait pas pu naître ailleurs, et même si l’idéologie avait pu séduire certaines couches, il
n’aurait pas trouvé l’élément humain nécessaire et suffisamment militant pour tenter l’aventure et lancer les bases concrètes d’une future nation juive. Toute cette fermentation politique et intellectuelle serait restée à l’état théorique.
Je suis né au Maroc dans les années quarante dans un ghetto juif pétri de traditions bibliques, peu ouvert à l’instruction, à la politique, à l’histoire. Presque tout le monde était religieux et rêvait au Messie évidemment. Mais à un Messie descendant de David qui viendrait par la grâce de Dieu soulager les souffrances de son peuple. Si on avait dit à ces juifs marocains à l’époque, ou même dans d’autres pays arabes, de s’engager pour aller se battre et reconstruire la nation juive, ils se seraient récriés et vous auraient traité de «renégats ». C’est d’ailleurs ainsi que les autorités religieuses de notre ghetto, les vraies dépositaires du pouvoir spirituel, avaient traité les messagers sionistes qui avaient osé y ouvrir un local qui fonctionnait pendant le shabbat.
On remarquera aussi que les juifs de la sphère occidentale n’accordaient à l’idéologie sioniste qu’un intérêt limité teinté d’incrédulité.
Tout s’est joué sur quelques dizaines de milliers de militants juifs, socialistes, communistes ou syndicalistes, qui cherchaient le salut révolutionnaire du peuple juif, voire l’émergence d’un nouveau juif débarrassé des oripeaux de la diaspora et des tares qui lui étaient associées: l’exercice du commerce voire de l’usure, l’absence de tout lien avec la terre, le refus du travail manuel, une faiblesse physique confinant à la lâcheté, et une propension aux études aussi ardues que vaines. Ces futurs « pionniers-bâtisseurs », comme ils allaient se faire appeler en passant de la théorie à la pratique, n’avaient pas adopté l’une des deux voies qui s’offraient aux militants juifs à l’époque : intégrer les forces révolutionnaires nationales principalement en Russie, ou chercher le salut révolutionnaire en Europe voire en Amérique. Leur révolution se voulait totale. C’était la fameuse théorie de la Pyramide inversée de Dov-Ber Borochov, né dans l’empire tsariste en 1881. Il avait théorisé le nationalisme juif en termes de lutte des classes et de matérialisme dialectique. Pour lui les juifs d’Europe sont répartis socialement selon une pyramide de classes inversée. Dans toutes les sociétés, la base la plus large est constituée par la paysannerie, puis vient la couche du prolétariat, ensuite celle des artisans, puis celle des commerçants, des fonctionnaires et enfin les travailleurs de l’esprit. Chez les juifs diasporiques, la base de la pyramide est constituée par ces derniers. C’est une société malsaine et vouée à être minoritaire, à la merci des pouvoirs locaux. La révolution juive, nationale, sociale et politique doit tendre à construire cette nouvelle société. D’où l’importance de redevenir des agriculteurs,
des bâtisseurs et des soldats.
Illustrons ce phénomène au moyen d’une petite anecdote. Un retraité israélien se promène avec son petit-fils à Tel Aviv. Devant le port se trouvent un pont, une usine, un immeuble. Il lui dit: « J’ai participé dans ma jeunesse à la construction de tout cela ». Le petit-fils lui demande alors: «Dis papy, quand tu étais jeune, tu étais Arabe ? »
Le rêve d’une société juive moderne fondée sur des principes marxistes aurait pu demeurer une belle utopie, à l’instar de nombreuses autres. Car se posait alors la question fondamentale d’un territoire autonome pour mettre en pratique tous ces beaux principes. La plupart de ces révolutionnaires vivaient dispersés dans des centres urbains sous la férule du Tsar. Ils n’étaient pas rassemblés dans une formation unique. Comme tous les tenants du marxisme, ils pouvaient défendre des visions différentes. Les controverses les plus importantes, en dehors de celle du territoire, portaient sur la nature du futur État. A l’exigence d’un État-Nation
juif répondait le courant culturel représenté par Ahad Ha’am. Selon ce penseur nationaliste, leader des Amants de Sion et l’un des pères de la littérature hébraïque moderne, la libération du peuple juif passait par la création d’un centre spirituel sur la terre d’Israël. D’où son opposition au sionisme politique de Herzel. Einstein et Hanna Arendt avaient d’ailleurs exprimé des réserves semblables. Cela n’a pas empêché Ahad Ha’am de s’établir en Palestine et de mener son combat. Il décède à Tel Aviv en 1927. L’autre controverse importante qui divisait les leaders sionistes portait sur l’inclusion des Arabes de Palestine à leur combat. Ben Gourion avait
même caressé l’illusion, selon Shlomo Sand, que ces derniers étaient les descendants des Hébreux restés sur place après la destruction du second Temple, avant de changer rapidement d’avis. Il n’en reste pas moins que Borochov, en vrai penseur marxiste, estimait que les classes prolétaires arabes et juives avaient des intérêts communs en tant que travailleurs, et devaient participer ensemble à la lutte des classes après le retour des juifs en Palestine.
Restait l’essentiel: trouver le territoire. Rappelons que l’urgence à l’époque pour les tenants d’une solution nationale résidait dans l’antisémitisme. L’affaire Dreyfus pour Herzel, et beaucoup plus dramatiques les pogroms dans l’empire russe. Le président de l’Organisation sioniste mondiale multipliait les contacts diplomatiques mais se vit opposer une fin de non–recevoir par le sultan de l’Empire ottoman pour s’installer en Palestine. Dans son livre L’État des Juifs publié en 1896, il envisageait même une installation en Argentine. Suite au pogrom de Kichinev en 1903,
Chamberlain offrit à Herzel un territoire en Ouganda. Les sionistes se divisèrent violemment sur cette solution, avant d’adopter une résolution en 1905 rejetant toute implantation en dehors de la Palestine. Rappelons pour mémoire le territoire autonome du Birobidjan offert aux juifs en 1934 par Staline et qui ne rencontra qu’un enthousiasme limité.
Le choix de la Palestine par les sionistes constitue une rupture, voire une déclaration de guerre, avec les communautés juives et avec la tradition judaïque. Il est bon de préciser que les partisans sionistes étaient pétris d’idéologie marxiste, donc athées et farouchement opposés aux traditions culturelles et cultuelles de la diaspora. Les tenants de la tradition juive ne voyaient pas d’un bon œil ce mouvement révolutionnaire dans tous les sens du terme. Lorsque Herzel a voulu tenir le premier congrès sioniste à Munich, près de 95% des rabbins allemands s’y opposèrent, et le congrès
a eu lieu finalement à Bâle en 1897. L’utopie sioniste n’avait pas non plus trouvé un écho favorable parmi les centaines de milliers de juifs qui fuyaient l’empire tsariste et cherchaient refuge en Amérique, ni parmi les juifs d’Europe de l’Ouest, heureux
de leur sort malgré quelques vicissitudes.
Pendant les dix-neuf siècles que dura l’exil des juifs épisode reconstruit artificiellement pour donner ce fameux caractère national et unitaire à l’épopée diasporique – la «Terre d’Israël » ne fut jamais regardée comme une patrie perdue ni comme un refuge possible. La tradition talmudique interdisait d’ailleurs toute installation massive avant l’arrivée du Messie. Interdiction levée seulement en 1948 sous la pression des événements. Les juifs la voyaient comme un mythe lointain et intemporel. Le fameux «l’année prochaine à Jérusalem» était plutôt une incantation idéalisée sans véritable volonté de lui donner une suite concrète. Je vivais dans le mellah (équivalent de ghetto) de Meknès, dans le respect des traditions religieuses. Nous étions près de vingt mille âmes. Lorsqu’en 1948 les sionistes y ont débarqué pour faire
«monter » les juifs en Israël, ils eurent énormément de mal à trouver des volontaires.
Pourtant les conditions de vie étaient très difficiles pour la majorité d’entre eux. De plus le Maroc traversait une période instable due à la lutte pour l’indépendance. Six commerçants juifs furent assassinés non loin de Meknès dans des manifestations contre le protectorat français. Pourtant, les sionistes ont dû recourir à toutes sortes de manipulations pour faire partir quelques dizaines de milliers de juifs. Ce n’est qu’en 1961, suite à des manœuvres parfois criminelles, et grâce à l’appui du nouveau roi Hassan II, que le Mossad et l’Agence juive avaient enfin réussi à organiser une immigration de masse. Mais une fois sur place, ce fut la tristesse et la désillusion. Mon père m’avait dit en 1969, une année après son départ quasi forcé : «Tu sais, les gens d’ici, les sionistes, ce ne sont pas de vrais juifs ». D’ailleurs l’autre moitié des juifs marocains a trouvé son salut en France, au Canada, en Espagne, etc.
Une fois que les sionistes eurent jeté leur dévolu sur la Palestine dont ils n’avaient aucune idée pour la plupart, ni comment elle était faite, ni qui y habitait rien ne semblait pouvoir les arrêter. Il m’arrive de donner cette image des « pionniers-bâtisseurs » qui cherchaient la rédemption du peuple juif moribond en une nation moderne, fière, dynamique, forte, puissante, intraitable, indestructible, unie, socialiste, humaniste, solidaire, pure, morale. Imaginez une petite « armée rouge » façonnée à la manière de celle de Trotski, forte de cinquante mille soldats environ, déterminée à atteindre ses objectifs coûte que coûte. Rien ne saurait les arrêter. La fin justifie les moyens. Bien sûr, ils avaient une éthique, ils étaient pétris d’humanisme, ils appartenaient aux courants socialistes. Ils se présentaient comme des idéalistes, insensibles aux honneurs et aux biens matériels. Ils avaient déferlé en des vagues successives sur la Palestine, construisant cette société idéale avec le réseau des kibboutzim qui avaient lancé leur réputation dans le monde, réputation qui avait aveuglé pendant des décennies une grande partie de la gauche française.
Ces collectivités proches du communisme parfait, creusets de l’engagement sioniste, représentaient aussi les autres aspects les moins nobles et les plus cyniques.
Elles étaient toujours stratégiquement installées comme des fortins pour les futurs combats contre les Arabes. Certaines furent installées au-delà du Jourdain pour bien marquer la volonté sioniste d’en occuper les deux rives, mais furent délocalisées dans le territoire mandataire après 1918. Un autre exemple concerne Tel Hai, colonie implantée dans l’extrême-nord, loin des centres de colonisation juive, pour tracer en quelque sorte les frontières du futur État. Détruite par les Arabes en 1920, et remplacée par Kiriat Chmona, « la cité des huit » après l’indépendance, elle glorifie l’esprit pionnier de résistance et du sacrifice. Ces collectivités ont produit les principaux dirigeants politiques et militaires, et donc façonné les fondements de cette nouvelle société : ethniquement pure, investie d’un projet quasi divin, décomplexée, imbue de sa bonne conscience.
Car ces sionistes on n’ose pas dire ces juifs tant ils avaient substitué le « national-judaïsme» au «judaïsme messianique», la formule est de Yakov Rabkin avaient établi une règle d’acier en découvrant la population arabe. Ce sont les kibboutzim joyaux du collectivisme sioniste qui avaient interdit aux Palestiniens d’en faire partie. La grande centrale syndicale, la Histadrout, fondée par les progressistes sionistes, n’acceptait que les membres juifs. Lorsque les villes prenaient leur essor, comme Tel Aviv, « on » conseillait aux indépendants de ne pas employer des Arabes,
sauf à voir leur business brûler nuitamment. Il faut imaginer une population juive, plutôt des réfugiés d’origine germanique ou russe, qui cherchait à s’en sortir dans des conditions difficiles et ne partageait pas nécessairement la vision suprémaciste de l’establishment sioniste, et qui aurait pu très bien vivre avec les habitants du pays. Cet establishment avait commencé dès les années 30 à ébaucher le projet de «transfert» des Palestiniens hors du futur État juif. L’historien Benny Morris l’a bien décrit dans sa thèse. Une citation du président du Fonds National Juif illustre bien
cet état d’esprit: « Il doit être clair qu’il n’y a pas de place pour deux peuples dans ce pays. La seule solution, c’est la Terre d’Israël, sans Arabes. Il n’y a pas d’autres moyens que de transférer les Arabes d’ici vers les pays voisins. Pas un village ne doit rester, pas une tribu bédouine.» On connaît la suite et le nettoyage ethnique de 1948. Les humanistes sionistes n’ont pas été jusqu’à l’extermination. Il n’y aurait eu qu’un millier de morts, officiellement.
Cet épisode n’appartient pas seulement à l’histoire. Il a marqué profondément le développement de la société israélienne jusqu’à aujourd’hui. Il y a une séparation quasi hermétique entre les deux populations. Il existe deux systèmes scolaires séparés de la crèche jusqu’au baccalauréat, juif et arabe. La loi de 2018 sur l’état de la nation juive permet aux villes « juives » d’interdire l’installation de citoyens arabes israéliens. Lorsqu’on a ouvert un collège médical à Safed, dans la Galilée, des étudiants arabes israéliens s’y sont inscrits. Les rabbins de la ville ont publié un décret religieux, contresigné par cinq cents rabbins de la région, interdisant
aux habitants de la ville de vendre ou de louer aux étudiants arabes. À Haïfa, ville historiquement mixte, les hôpitaux ont créé des maternités séparées. Il faut admirer enfin le « génie » sioniste qui arrive encore à exclure sournoisement et cyniquement les citoyens non-juifs. Près de soixante-dix mille bédouins vivant dans le Néguev n’ont ni eau ni électricité ni écoles parce que leurs villages n’ont pas été « reconnus » par l’administration. Pour finir avec le « transfert » des populations indésirables, Avigdor Lieberman, originaire de Moldavie soviétique, actuel ministre des
Finances et « grande gueule », évoque régulièrement cette possibilité à l’encontre des Palestiniens de Cisjordanie, pendant que les sionistes « humanistes » se taisent prudemment.
A défaut de repères religieux ou historiques, les sionistes vont faire du pays, de sa nature, de son paysage, l’objet de leur culte, le centre de leurs sacrifices. La Terre remplacera la Bible. La «Terre d’Israël» va acquérir le rang d’un mythe. Elle va être sanctifiée, admirée, idéalisée, célébrée, chantée. C’est tout un peuple qui va poétiser la Terre à la manière d’un Charles Péguy. Son attachement et sa ferveur semblent vouloir rattraper l’absence de deux mille ans. La Terre devient l’alpha et l’oméga du projet sioniste. On n’imagine pas, à l’extérieur d’Israël, l’adoration quasi obsessionnelle qu’on lui porte. Dès l’école primaire, on initie les élèves, par des excursions régulières et obligatoires, à connaître les moindres recoins de la patrie nourricière et bien-aimée. Mais c’est dans la chanson que s’est gravé dans la mémoire des Israéliens
le lien viscéral et indestructible avec la Terre. Ces chansons n’ont pas d’âge. Certains « tubes » datent parfois d’avant la création de l’État, mais elles se transmettent de génération en génération. Le shabbat est propice, pour toutes les stations de radio, à rediffuser ces éternels succès qui rappellent l’époque héroïque. L’une de ces vieilles chansons dit : « Nous construirons notre terre, notre terre-patrie, car cette terre est à nous, elle est à nous. C’est le commandement des générations précédentes, le commandement de notre sang ». Une autre chanson célèbre dit: «Nous sommes
venus ici pour construire et pour nous reconstruire». C’est la dynamique qui conduit au «juif nouveau ».
Hélas! Cette terre était déjà occupée. Alors, à la manière des conquérants de l’Ouest américain, et d’autres conquérants qui suivront, les sionistes vont reprendre les mêmes mythes. Celui de la terre vierge ou du désert. Ou si elle est relativement peuplée, alors c’est seulement de façon éparse, par des tribus qui ne s’y fixent pas et dont les droits de propriété sont douteux, car elles n’en prennent pas soin, ne la cultivent pas et la négligent. A la limite, elles n’y auraient pas droit face à la légitimité de populations bien organisées qui sauraient la travailler. Dès les premières vagues
des «pionniers-bâtisseurs », la propagande sioniste parlait déjà de «terre désolée et abandonnée réclamant impatiemment ses rédempteurs ». D’où le succès du slogan : «une terre sans peuple pour un peuple sans terre», qu’il a fallu adapter en fonction
des réalités. La Palestine est ainsi dépeinte, avant l’arrivée des sionistes, comme étant délaissée et abandonnée, une terre en friche ayant perdu sa fertilité, et dans un état d’anarchie
primitive. Seules les implantations juives pourraient la régénérer, car établies en priorité sur des étendues désolées, sur des marais et du sable, sur des collines arides et désertiques. Encore un mythe tenace de la propagande sioniste. Et si cela ne suffisait pas, on construira celui d’une population arabe étrangère à la Palestine qui a profité de la présence britannique et juive et de la prospérité qu’elle y a apportée pour s’installer illégalement sur ce territoire. Toute revendication arabe sur la Palestine serait ainsi délégitimée, et prouverait la justesse du dogme sioniste sur les liens intimes, éternels et sacrés entre cette terre et le peuple juif. Ne lui avait-elle pas été promise ? Seul ce peuple pouvait établir un lien organique et authentique avec la «Terre d’Israël» et mener à sa régénération. Le coup de «génie » sioniste, cruel et brutal, fut de raser toutes les installations palestiniennes. C’est probablement la seule fois où un conquérant se prive des installations existantes: fermes, ateliers, pressoirs, vergers, magasins, églises, mosquées, villages entiers. Les futurs visiteurs pourront ainsi s’exclamer (j’en fus témoin): «C’est extraordinaire ce que vous avez réalisé. Il n’y avait vraiment rien ici et vous avez tout édifié. »
À l’instar du Far West magnifié par la légende, l’épopée sioniste a connu son heure de gloire, étalée sur plusieurs décennies. Le film Exodus, réalisé en 1960 avec Paul Newman, a marqué l’inconscient collectif occidental pour au moins une génération.
Même après la guerre de juin 1967, soigneusement préparée et transformée en guerre préventive légitime, qui a vu Israël occuper militairement d’immenses territoires, des millions d’Arabes et des dizaines de milliers de jeunes Européens s’offraient à travailler bénévolement des mois durant dans les kibboutzim pour s’y imprégner de l’humanisme, du pacifisme, de l’égalitarisme, supposés être les vertus du sionisme en action. Cela n’a fait que renforcer la conviction des sionistes que tout leur était dû, et
qu’ils pouvaient presque tout faire à condition d’y mettre les formes. Et pour ce qui est des formes, ils s’y connaissent. Comment expliquer sinon cette espèce de droit divin sur la Palestine promise par l’Éternel et dont on reprend possession après deux mille ans d’absence ? Bizarre et insuffisant ? Que diriez-vous alors du besoin impérieux de la nation juive, discriminée et ballottée depuis des siècles par les gentils, d’avoir un petit bout de terre à soi, un tout petit, pour vivre enfin en paix et en sécurité ? Et puis les juifs n’ont jamais été violents, ils ne feront de mal à
personne. Bon, ils apprendront à se défendre, il le faut bien, mais seulement s’ils sont attaqués, si on les empêche de réaliser leur idéal socialiste et humaniste… On peut faire un rapprochement, vu leur proximité idéologique avec le bolchévisme, avec l’idée que toute idéologie révolutionnaire contient en elle la légitimation de l’usage de la violence, la fin justifiant les moyens.
Le problème avec les sionistes, c’est leur conviction indécrottable d’être dans leur bon droit. Quoi qu’ils fassent. Même lorsqu’ils tuent. Ils ont une armée, certes, et de grande valeur, mais de « défense». Et d’ailleurs c’est l’armée la plus morale du monde, et qui obéit à l’éthique juive dont on connaît la tolérance et l’égalitarisme. Si à l’étranger on ne l’entend pas beaucoup, les médias israéliens en font des tartines.
Concrètement, cette armée ouvre des dossiers chaque fois qu’un Palestinien de Cisjordanie est blessé ou tué dans une manifestation ou par « accident », dossiers refermés sauf si une caméra traîne par là ; alors on fait un simulacre de procès pour montrer au monde et à sa propre société combien on est juste et bon. Il existe une formule célèbre qui s’applique à Tsahal: «On tire et on pleure ». On peut commettre es pires exactions voir les quelques témoignages accablants sur les crimes de guerre perpétrés contre les civils palestiniens pour les faire fuir en 1948 on n’en est pas moins innocent, car on ne l’a pas voulu, la faute en incombe aux circonstances, d’ailleurs on le regrette fortement et on en est très malheureux.
À l’issue de la guerre des six jours, on a réuni les témoignages de soldats issus des kibboutzim – autant dire l’élite morale et politique du pays – dans un ouvrage intitulé Le Septième jour. Il en ressort que les soldats israéliens ne nourrissaient aucune animosité personnelle à l’égard des Arabes, et que les violences qu’ils leur faisaient subir les tourmentaient. «Les circonstances nous forçaient à être durs, durs jusqu’aux larmes. » Ce sont des guerriers tragiques à leur corps défendant. L’anxiété morale que traduit le livre ne résulte pas des effets de la violence sur le vaincu mais sur le vainqueur. Il s’agit ici de la corruption de l’âme juive. Golda Méïr disait: «Nous ne pardonnerons jamais aux Arabes de nous obliger à tuer leurs enfants. » Le célèbre écrivain sioniste-humaniste-progressiste dont les Israéliens adoraient se prévaloir pour se disculper et pour montrer au monde leurs vertus profondes, Amos Oz, fut l’un des interviewers; il avait alors fustigé les Arabes pour « avoir corrompu l’âme d’Israël en l’obligeant à les détester».
Je me souviens avoir entendu dans un documentaire israélien ce témoignage accablant prononcé par un homme dans la trentaine, de profession médicale, pendant sa période de réserve militaire. Alors qu’il patrouillait en Cisjordanie, à deux heures du matin il frappe à la porte d’une maison, à la manière des militaires. On tarde à ouvrir, il lance une grenade assourdissante dans la cour qui tue une fillette de cinq ans. L’homme exprime ensuite des remords. À la question du journaliste qui lui demande : « avez-vous pensé à vous excuser ? », il répond après une minute de silence : «M’excuser ? Mais c’est aux habitants de la maison de s’excuser. En tardant à ouvrir, ils m’ont mis dans la nécessité de lancer la grenade et de provoquer la mort de la fillette.»
C’est la même bonne conscience qui fait qu’on peut détruire un immeuble à Gaza contre deux ou trois roquettes artisanales. Mais les militaires israéliens ont la délicatesse d’avertir vingt minutes à l’avance, le même laps de temps qu’ils laissent à une famille palestinienne pour prendre quelques affaires et évacuer la maison avant de la faire sauter. La famille peut toujours fouiller dans les gravats pour récupérer quelques souvenirs. C’est une punition collective interdite par les conventions de Genève mais, voyez-vous, ces Arabes ne comprennent que le langage de la force, et
au fond ils ne veulent pas de nous sur cette terre…
C’est une attitude partagée par l’écrasante majorité des Israéliens juifs, les seuls qui fassent le service militaire (en dehors des Druzes mais ces derniers comptent très peu). De fait, l’hostilité sioniste envers les Arabes date de leur arrivée en Palestine, d’abord parce qu’ils contrecarraient leurs projets et ensuite parce qu’ils représentaient le prototype des indigènes que des Européens civilisés traitaient par le mépris dans toutes les colonies.
On a beau être juif et progressiste, on n’en garde pas moins un sentiment de supériorité teinté de mépris, même envers ses « coreligionnaires » moins bien lotis. Déjà l’idéologie sioniste n’avait que mépris pour le juif diasporique coupable de toutes les déficiences historiques. Après la création de l’État en 1948, les sionistes avaient besoin de soldats, de main d’œuvre industrielle et agricole, et de familles nombreuses pour peupler le pays. Ils n’étaient que six cent mille à l’époque. Où trouver tous ces
futurs citoyens ? Les juifs installés en Europe et dans les Amériques répugnaient à y aller. On était «sioniste » de cœur, et on aidait mais c’était tout. Restaient les pays arabes avec leurs immenses communautés, mais aussi réticentes à quitter leur cadre de vie qu’à croire aux balivernes en contradiction avec les textes sacrés. Les sionistes usèrent des manœuvres les plus déloyales (c’est un euphémisme) pour les faire partir.
Mais arrivés sur place c’était l’horreur. Car de ces communautés n’étaient partis que les juifs les plus pauvres et les moins éduqués. A vrai dire ils ressemblaient furieusement aux Arabes qu’on venait d’expulser. L’image d’Israël en prenait un rude coup.
Imaginez la répulsion de ces « pionniers-bâtisseurs » européanisés à la pointe de la modernité devant ces hordes orientales. S’ensuivit alors une très longue période de racisme à peine déguisé – la pire de leurs crapuleries étant l’enlèvement de bébés yéménites dans les maternités pour les confier à des familles ashkénazes de bon
aloi – de dénigrements, de discriminations, dont les séquelles ressurgissent ici ou là jusqu’à aujourd’hui. Puis vinrent les « juifs » (10 à 15% d’entre eux n’étaient pas de vrais juifs selon la loi rabbinique, ce qui pose problème pour les marier ou pour les enterrer) de l’ex-Union soviétique, discriminés en fonction de leurs origines, les Moscovites préférés aux Géorgiens. Enfin les Falashas qu’on a admis à contrecœur, qu’on a essayé de reconvertir, et qui subissent le racisme ordinaire réservé aux noirs.
Entretemps, les orthodoxes qui représentaient 2 ou 3% en 1948 sont aujourd’hui entre 15 et 20%. Les nouveaux nationalistes religieux 10 à 15%. Les Arabes dont on avait pensé s’être débarrassés en 1948 se sont multipliés jusqu’à atteindre 20 à 25%. Sans compter les résidus divers et les sous-divisions dans toutes ces catégories. Contrairement au rêve des premiers sionistes d’un État juif, exclusivement juif, socialiste, progressiste, humaniste, pacifique, sécuritaire, il y a maintenant un puzzle de communautés diverses, qui dans le meilleur des cas s’ignorent en se détestant, et
qui en arriveraient facilement aux mains sinon plus s’il n’y avait pas le danger extérieur, un danger cyniquement entretenu par l’establishment israélien.
Entre 1969 et 2004, j’ai effectué une dizaine de séjours en Israël. Toute ma parenté s’y était installée. Et d’un point de vue marocain, cela fait beaucoup de monde. Ces personnes sont réparties dans presque tous les milieux, des points de vue de la politique, de la religion, de la culture, de l’économie. L’état de guerre fait partie de leur quotidien mental. Et même quand Israël signe un traité de paix avec un pays arabe, elles restent sur leurs gardes, elles n’y croient pas. Elles ont adapté le slogan des conquérants américains sur les Indiens: «Un bon Arabe est un Arabe mort. »
Israël a été édifié sur la haine de l’Arabe. Peut-être ne pouvaient-ils pas faire autrement. Mais à partir de 1967, cela est devenu un choix délibéré que l’establishment militaro-sécuritaire a réussi à imposer à sa propre population. Celle-ci s’y est résignée. La fameuse formule d’Ehud Barak, un héros qui a occupé toutes les fonctions prestigieuses, garde sa véracité dans l’inconscient collectif: «Israël est une villa dans la jungle. »
Les sionistes ont poussé le degré de propagande et de manipulation à un point inégalé. Tout a été fait pour que les citoyens juifs et arabes aient le moins de possibilités de se fréquenter. Ils ont réussi le tour de force de rendre pratiquement invisible le cinquième de la population. Alors que les sociétés européennes affichent leur diversité avec moins de 10% d’étrangers, Israël donne l’illusion d’être une société quasiment juive.
Dans les années 1970, circulait une formule dans les médias français: « Israël en danger de paix.» On ne croyait pas si bien dire. La paix, la vraie, comme celle dans laquelle vivent la France et l’Allemagne, est impossible, ce serait la fin du rêve sioniste ou de ce qui en reste. Il suffit pour s’en rendre compte de réaliser une chose très simple : une vraie paix signifierait que juifs et Arabes israéliens aillent dans les mêmes écoles, fréquentent les mêmes lieux de loisirs, partagent un service militaire national, cohabitent dans les mêmes immeubles. C’est un cauchemar dont un non-initié ne peut imaginer ni l’ampleur ni l’horreur.
Dans ce sens, le sionisme a raté son objectif. Si on remonte aux premiers manifestes, aux engagements, aux dévouements, aux idéaux, aux personnalités, aux édifications… En dehors de la dimension palestinienne, ce fut, jusque dans les années 1970, une société relativement juste et égalitaire, solidaire dans les épreuves, simple dans ses prétentions. La plupart des ministres et des députés, des militaires de haut rang, issus des kibboutzim, ne possédaient ni logements ni biens matériels en propre. Les familles et les nouveaux couples recevaient un appartement adéquat. En
dehors de quelques businessmen, il n’y avait quasiment pas de millionnaires. Les kibboutznikim allaient encore fièrement en ville en sandales et tenues kaki.
Le 9 mars, on avait célébré le trentième anniversaire de la mort de Menahem Begin, dans l’unanimisme et la ferveur. On sentait, dans les médias, la nostalgie d’une époque révolue. On l’avait pourtant diabolisé lorsqu’il remporta les élections en 1977. Il n’appartenait pas à l’establishment bien-pensant. Son élection sentait la revanche du petit peuple juif d’origine arabe dont on brocardait les penchants fascisants. Mais il transpirait les valeurs sionistes dans son intégrité, ses costumes de confection et son petit trois-pièces qu’il n’a jamais quitté.
Cela change avec le luxueux penthouse d’Ehud Barak dont on a loué l’habileté spéculative immobilière, ses conférences largement rémunérées, ainsi que sa proximité avec Jeffrey Epstein. Car la classe politique israélienne a bien changé. Israël est probablement le seul État au monde – preuve aussi de son système judiciaire indépendant – à avoir condamné à des peines de prison ferme un chef d’État pour agression sexuelle, ainsi qu’un premier ministre et d’autres ministres pour corruption. Le procès de Netanyahou se déroule actuellement avec plusieurs chefs d’accusation; ce même Netanyahou qui a pulvérisé toutes les solidarités sociales avec sa politique «thatchérienne».
Le sionisme n’a plus la cote. L’argent est devenu son élément moteur. L’esprit «pionnier-bâtisseur » s’est déplacé vers la Cisjordanie, pas dans les grands blocs de colonisation où on réside pour des raisons économiques, mais près des lieux bibliques
comme à Hébron, ou dans des petites collectivités à buts purement coloniaux: à l’instar des premiers kibboutzim, pourchasser le maximum de Palestiniens et encercler leurs cités. Ce mouvement suscite de la compréhension ou de l’indifférence, parfois une gêne, car il entache l’image du «Bel Israël», un mythe auquel les Israéliens s’accrochent désespérément.
Mais l’État juif existe enfin, et quel État! Il fait la nique à la communauté internationale et jeu égal avec la Russie dans la région, terrorise l’Union européenne avec le souvenir de la Shoah, négocie avec la Chine et l’Inde sur un pied d’égalité, manipule
la politique américaine, conserve des zones d’influence en Afrique. Israël est devenu un acteur majeur sur la scène internationale. Des pays arabes le sollicitent sans exiger de concessions sur la Palestine. Que du bonheur ?
Je ne suis pas sûr que cela aurait rempli d’aise les sionistes historiques, et en ce sens, ce n’est pas moins une triste déconvenue. L’utopie sioniste a accouché d’un État comme les autres, et pas aussi moral que la moyenne occidentale. L’establishment – j’utilise exprès ce terme pour montrer que ce n’est pas le fait d’un homme politique ou d’un parti – broie tout aussi bien les valeurs juives et les aspirations de sa propre population. Pour des raisons de propagande en direction du monde occidental et pour bien montrer qu’il en est un membre actif et fiable, Israël est à la pointe du combat LGBT++, GPA, PMA, toute la panoplie. Tel Aviv en est devenu une des capitales mondiales. Pourquoi pas ? Mais cela est imposé avec la brutalité qu’on connaît à cet État. Une Gay Pride est organisée dans la ville de Jérusalem par ailleurs sainte, protégée par des forces de sécurité considérables, suite à un meurtre homophobe commis il y a trois ans, alors que l’homosexualité reste un tabou profond pour la majorité des citoyens juifs et arabes, et est punie par la peine de mort dans l’Ancien Testament.
Les partis religieux, qui font et défont les gouvernements en se sucrant largement au passage, n’y trouvent rien à redire. Le nouveau premier ministre Naftali Bennett, chef d’un parti nationaliste et religieux, portant kippa, suit fidèlement la doxa. On
peut étendre le raisonnement à la manière dont le pouvoir israélien a géré le Covid et la vaccination – dans le plus pur conformisme à l’oligarchie mondialiste et contre les intérêts de ses citoyens.
C’est sur cette société – inclus les aspects coloniaux et discriminatoires qui sont de notoriété publique – qu’est tombé le terrible jugement de Yair Golan en 2016, le jour de la commémoration de la Shoah : la situation dans le pays lui rappelait le début des années 1930 en Allemagne. Chef d’état-major adjoint de Tsahal, il signait là la fin de sa carrière militaire et renonçait ipso facto au poste le plus prestigieux en Israël. L’establishment sait gérer ce genre d’incartades. La population a d’autres chats
à fouetter, et on n’aime pas les Cassandre dans ce pays qui va de l’avant avec fierté et assurance. L’hubris sioniste est à son apogée. On ignore superbement les signaux alarmistes, comme le récent rapport d’Amnesty International qualifiant d’apartheid, documents à l’appui, la colonisation israélienne ainsi que le système discriminatoire imposé aux citoyens arabes israéliens. On préfère y opposer l’argument éculé – et qui finira par avoir l’effet inverse – de «l’antisémitisme». L’écrasante majorité de la classe politique et de la population juives israéliennes ne voient tout simplement pas
d’alternative. Et les institutions juives de la diaspora n’ont le choix que d’obtempérer.
Car le destin du peuple juif tout entier est désormais lié à ce qui se passe là-bas.
Pour le meilleur ou pour le pire. Ce peuple avait assisté médusé, indifférent, sceptique, à la tentative de quelques milliers d’illuminés de modifier le cours de son histoire. Le succès de l’entreprise l’amena à les soutenir, de plus en plus fort, de plus en plus aveuglément. Les plus tièdes et les plus critiques de ses éléments étaient écartés des institutions communautaires. Le sionisme est devenu, nolens volens, sa religion, sa boussole, sa raison d’être. Or cette idéologie, qui ne s’impose que par la force, la conquête, la discrimination, le diktat, finira par être délogée de la région. «On peut tout faire avec des baïonnettes sauf s’asseoir dessus » disait un révolutionnaire de 1789. On ne peut dire ni quand ni comment. Mais les peuples arabes vomissent ce régime malgré les accords de «paix » signés par des dirigeants illégitimes. Et les élites européennes, tétanisées par la Shoah que les institutions judéo-sionistes imposent ad nauseam, s’en libéreront un jour ou l’autre. Le temps appartient à l’Histoire. Même des responsables, de la diaspora ou israéliens, le murmurent dans des moments de lucidité. Et alors le sionisme, qui a voulu offrir une alternative de sauvegarde au peuple juif, le précipitera peut-être dans une tragédie d’une ampleur inconnue.
Jacob Cohen
Publié par la revue Krisis