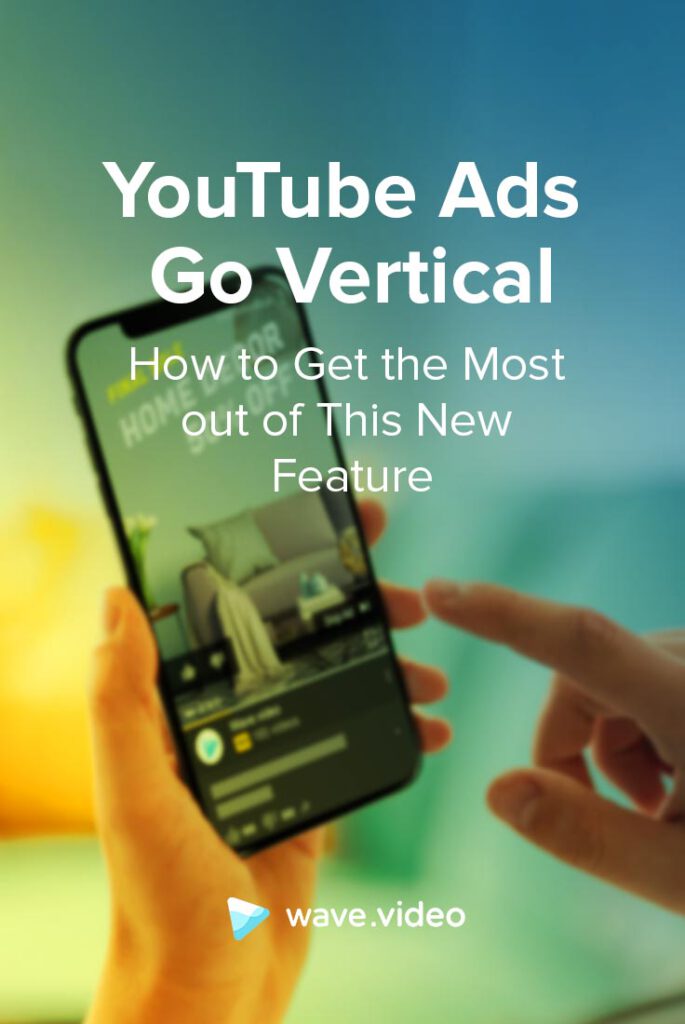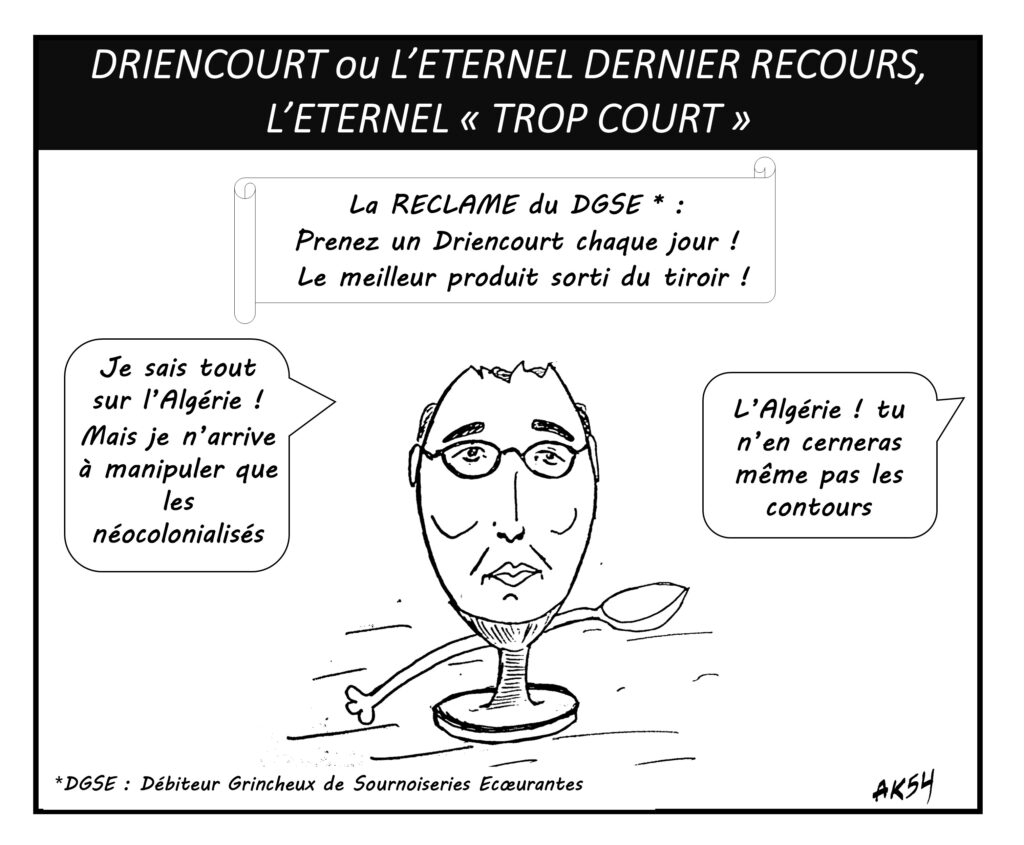Par Khider Mesloub
La parution du livre « Management totalitaire », écrit par la journaliste Violaine des Courières, m’offre l’opportunité de livrer aux lecteurs d’Algérie54 une étude consacrée aux méthodes managériales occidentales, désormais répandues dans le reste du monde, et à leurs conséquences, la souffrance au travail, incarnée par le burn-out. Cette étude légèrement réactualisée, je l’ai rédigée en 2021. Elle demeure d’une brûlante actualité. Ainsi, dans cette étude est démystifié le modèle entrepreneurial occidental totalitaire tant vanté par les thuriféraires du libéralisme, notamment en Algérie.
Souffrance au travail
Longtemps ignorée par la sociologie du travail comme par la médecine du Travail, la souffrance au travail fait l’objet d’études depuis seulement trois décennies. Les premiers fondements théoriques sont élaborés, du moins pour ce qui est de la France, par le sociologue Danièle Linhart et le psychiatre Christophe Dejours.
Ainsi, l’étude de la souffrance au travail, notamment dans ses dimensions pathologiques psychiques, s’amorcent dans les années 1990, grâce aux travaux pionniers de Christophe Dejours, psychiatre, ancien médecin du travail, auteur de nombreux ouvrages sur le phénomène de la psychopathologie au travail (comme « Souffrance en France : la banalisation de l’injustice sociale » ou « Travail, usure mentale »). De même, les études sur le suicide résultant de la souffrance au travail se développent à la même époque, impulsées à la suite de la multiplication du nombre de suicides au travail.
Dans ses travaux, Christophe Dejours démontre le rôle de la « centralité du travail » dans l’émergence de la souffrance au travail. La « centralité du travail », devenue l’élément essentiel de socialisation, contribue amplement à la santé psychique de chaque femme et chaque homme dont le statut social repose principalement sur son activité professionnelle. Aussi, l’apparition d’une souffrance dans la sphère professionnelle se répercute-t-elle immédiatement dans la sphère privée ou familiale. Incontestablement, elle perturbe plus dramatiquement l’individu salarié qu’une souffrance résultant de la sphère personnelle.
Parmi les facteurs favorisant l’émergence de la souffrance au travail, Christophe Dejours incrimine la croissance de la surcharge de travail. Paradoxalement, cette surcharge de travail résulte du développement exponentiel des nouvelles technologies censées permettre théoriquement, grâce à l’automatisation et à la numérisation des multiples tâches, l’allègement de la pénibilité au travail. Or, l’introduction des nouvelles technologies provoque, au contraire, l’augmentation de la charge de travail. Au Japon, devant l’expansion de la charge de travail, les spécialistes ont dû inventer un nouveau vocable pour caractériser ce phénomène : le Karôshi, désignant la mort subite au travail (par crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral) de salariés sans antécédents pathologiques particulières. C’est ce qui s’appelle familièrement «se tuer au travail », mais, en l’espèce, au sens propre, mourir d’épuisement psychique.
Psychopathologies professionnelles
Ces psychopathologies professionnelles se développent aux États-Unis et en Europe. Favorisée par l’implantation du libéralisme débridé impulsé dans les années 1970, accentué par les politiques libérales de Reagan et de Thatcher, appliquées ensuite dans la majorité des pays développés, induisant de profonds remaniements dans l’organisation des entreprises, la souffrance au travail s’invite brutalement dans le débat public avec l’explosion des tragiques suicides liés à la dégradation dramatique des conditions de travail. En effet, à la suite de nombreux suicides liés aux conditions déplorables de travail, l’opinion publique prend conscience de la gravité de la souffrance au travail. Ces cas de suicides défrayent la chronique. Depuis le surgissement de ce phénomène, les médias rapportent régulièrement les tentatives de suicide échouées ou abouties survenues sur les lieux de travail. Au reste, de multiples rapports parlementaires ont été rédigés pour décrire le phénomène du « mal-être » au travail. Ces rapports ont mis en lumière les « risques psycho-sociaux », les aspects psychopathologiques corrélés au travail.
Historiquement, le phénomène du suicide avait déjà été étudié, dès la fin du XIXème siècle, par le sociologue Émile Durkheim. Dans son étude visionnaire sur le suicide, Durkheim avait décelé les racines sociales du suicide, au-delà des fragilités manifestes individuelles : « Si l’individu cède au moindre choc des circonstances, c’est que l’état où se trouve la société en a fait une proie toute prête pour le suicide ».
À cet égard, cette soudaine contemporaine focalisation sur la souffrance au travail n’indique pas qu’elle était inexistante auparavant dans le monde du travail. Au contraire, les pathologies liées au travail et à la pénibilité émergèrent dès l’apparition des premières fabriques généralisées au début du capitalisme. Cependant, ces souffrances faisaient l’objet de négociations entre employeurs et travailleurs. Elles donnaient lieu à diverses compensations sociales et financières, notamment par les réductions ou aménagements du temps de travail et les primes (de toxicité, d’insalubrité, etc.). De plus, cette souffrance (physiologique ou psychologique) était gérée par des collectifs de travail officiels ou officieux de solidarité afin d’assurer une prise en charge mutualiste. Enfin, dans le cadre de ce partenariat séculaire entre patronat et syndicats, de leur complicité en matière de gestion de la force de travail, une véritable chape de plomb fut posée sur cet aspect de la souffrance au travail, problème éminemment politique propice à la contestation sociale, à la politisation de la lutte.
Certes la pénibilité au travail a considérablement diminué. Mais elle a été remplacée par une souffrance encore plus pernicieuse, insidieuse, douloureuse : la perte du sens du travail dans l’entreprise ; la dépossession de soi, en un mot l’aliénation.
Favorisées par la crise économique amorcée dès 1973, accentuées par le développement exponentiel de l’individualisme, l’effondrement des solidarités collectives, du désengagement syndical, les difficultés sociales, les souffrances liées au monde du travail sont désormais vécues sur le mode personnel. De nos jours, la souffrance est perçue comme une insuffisance personnelle (« Je ne suis pas à la hauteur de la tâche qu’on me confie »). Les problèmes liés au monde du travail sont vécus sur le mode de l’échec personnel. En proie au mal-être professionnel, les travailleurs se résignent à s’enfermer dans une solitaire souffrance pétrie de culpabilité. La souffrance professionnelle n’est plus vécue sur le mode collectif avec comme perspective d’unir la force des travailleurs pour surmonter leurs difficultés et ainsi mieux se battre contre les patrons afin d’améliorer leurs conditions de travail par l’obtention de compensations sociales et financières, l’allégement de la pénibilité.
Dissolution des collectifs de travail
Aujourd’hui, depuis maintenant trente ans, nous sommes entrés dans l’ère du management. Toutes les entreprises ont introduit les méthodes de management dans la gestion des salariés. Cette individualisation de la gestion salariale s’est généralisée dans toutes les entreprises. De même, les méthodes managériales de gestion du privé se sont implantées dans le secteur public, soumettant les fonctionnaires aux mêmes exigences de compétitivité et de rentabilité. La mission capitale d’intérêt général a été supplantée par la mission générale de l’intérêt du capital.
Par cette nouvelle politique de gestion salariale, le patronat a voulu briser la force collective des travailleurs, particulièrement dans les bastions ouvriers puissants et organisés. Il n’est pas surprenant que cette volonté de réorganisation de l’entreprise soit intervenue après Mai 68, dans le sillage des mouvements de luttes radicales massives engagées dans l’ensemble des pays industriels développés. En effet, pour prendre l’exemple de la France, au lendemain de Mai 68, marqué par l’affirmation de la force collective des travailleurs illustrée notamment par l’augmentation des salaires et la politique participative des salariés dans la gestion de l’entreprise, le patronat, effrayé, entama sa revanche dès le début des années 73-74, à la faveur de la crise pétrolière, pour briser cette dynamique collective ouvrière.
Sous couvert d’autonomie, le patronat avait entamé progressivement la dissolution des collectifs de travail de leur puissance de frappe. D’abord, par l’instauration de petites unités de production censées mieux répondre à l’autonomie des salariés. Ensuite, par l’introduction de méthodes de management individuelles. Enfin, par la mise en œuvre de techniques de division salariale et d’éclatement professionnel opérées au moyen de la polyvalence et de la mobilité, occasionnant une profonde flexibilité du personnel. Aussi, pour mieux soustraire le salarié à son assignation permanente à la même équipe de travail propice à la création de liens professionnels solidaires et combatifs, le patronat recourut à la méthode de la mobilité professionnelle au sein de la même entreprise. Aux salariés interchangeables. Cette politique managériale sera amplifiée par l’introduction des nouvelles technologies. Dès lors que les compétences ne sont plus essentielles, en raison de l’intervention de l’intelligence artificielle, alors les salariés deviennent interchangeables. Le salarié n’est plus recruté pour ses compétences professionnelles, mais pour sa capacité concrète à produire rapidement et à être rentable.
Pour parachever cette reprise en main totalitaire du patronat dans la gestion salariale, les entreprises imposèrent également l’individualisation du contrat et de la carrière professionnelle. Notamment par l’instauration de l’entretien individuel, les primes individuelles, la grille salariale individualisée, le remplacement de la qualification par les compétences, etc. Toutes ces nouvelles dispositions se prêtent mieux à la gestion arbitraire définie par les méthodes managériales fluctuantes mises au service du patronat.
De fait, outre ces méthodes managériales, l’agitation récurrente de la menace des plans de licenciements et de délocalisation, le recours permanent à des intérimaires, la désintégration des liens interpersonnels entre salariés, ont conduit à rendre le travail plus difficile à supporter au plan psychologique. Par ailleurs, du fait du déplacement des capitaux privés, détenus jadis par un patron physiquement et géographiquement à proximité des salariés, vers un actionnariat mondialisé anonyme, la riposte ouvrière est devenue inopérante, donc rarissime. Selon Violaine des Courières, ce nouveau mode de management est apparu à la faveur de la financiarisation des grandes entreprises, de la fusion-absorption. Elle déclare dans une interview : « entre 1985 et 2017, le nombre de fusions-acquisitions dans les entreprises a été multiplié par 18. On a ainsi instauré une culture de l’instabilité, qui a été théorisée par des scientifiques, notamment Peter Kruze. Ce médecin allemand a développé la théorie de la « culture du changement » dans son ouvrage Change management. Selon elle, l’instabilité permet d’avoir une meilleure rentabilité, parce que le changement permanent pousse l’employé à se dépasser. Il n’a pas considéré le fait qu’à moyen et long terme, le changement finit par user, ce que l’on voit très nettement aujourd’hui avec l’explosion du nombre de burn-out ». Globalement, depuis trente ans, nous sommes rentrés dans l’ère des managers tyranniques qui appliquent sans scrupules des consignes brutales venant d’en haut, des exigences de rentabilité d’actionnaires hors de portée. « On dénonce aujourd’hui la moindre violence dans notre société, mais dans l’entreprise tous les coups sont permis au nom d’une idéologie de la performance », déplore Violaine des Courières dans une interview publiée dans Le Figaro.
De manière générale, si le taylorisme se fondait sur une logique collective prescriptive, le management moderne s’appuie, lui, sur une approche individuelle et participative. Il fait appel à l’intelligence individuelle et à l’engagement subjectif du salarié pour optimiser la production.
Cependant, l’introduction du management dans la gestion de l’entreprise n’a pas signifié la fin du taylorisme. Au contraire, l’entreprise capitaliste s’inscrit toujours dans la logique taylorienne. Car le taylorisme ne constitue pas seulement une technique d’organisation scientifique du travail matérialisée par la division rigoureuse des postes de travail, la définition des fonctions, la standardisation des tâches, le chronométrage, etc. C’est avant tout, dans une société divisée en classes fondée sur l’exploitation du travail et l’extraction de la plus-value, une conception sociale capitaliste des fonctions déterminées par la contrainte et le contrôle afin d’assurer la soumission du salarié au procès de production.
En fait, le management est la version modernisée du taylorisme poussé à l’extrême. Toutefois, si le taylorisme s’appliquait à l’ensemble du collectif travailleur pour mieux le soumettre aux impératifs du capital, le management moderne régente individuellement le salarié pour mieux l’intégrer à la logique du capital, à la culture de l’entreprise, à la logique salariale participative. Le management exige du salarié le déploiement optimal de sa subjectivité pour développer ses capacités productives en vue d’obtenir l’augmentation constante du rendement, notamment par l’élimination du gaspillage au cours de toute la phase de production (le fameux Lean management, gestion dégraissée, l’excellence opérationnelle). Avec le management, l’aliénation du salarié est accentuée, acculée à son paroxysme.