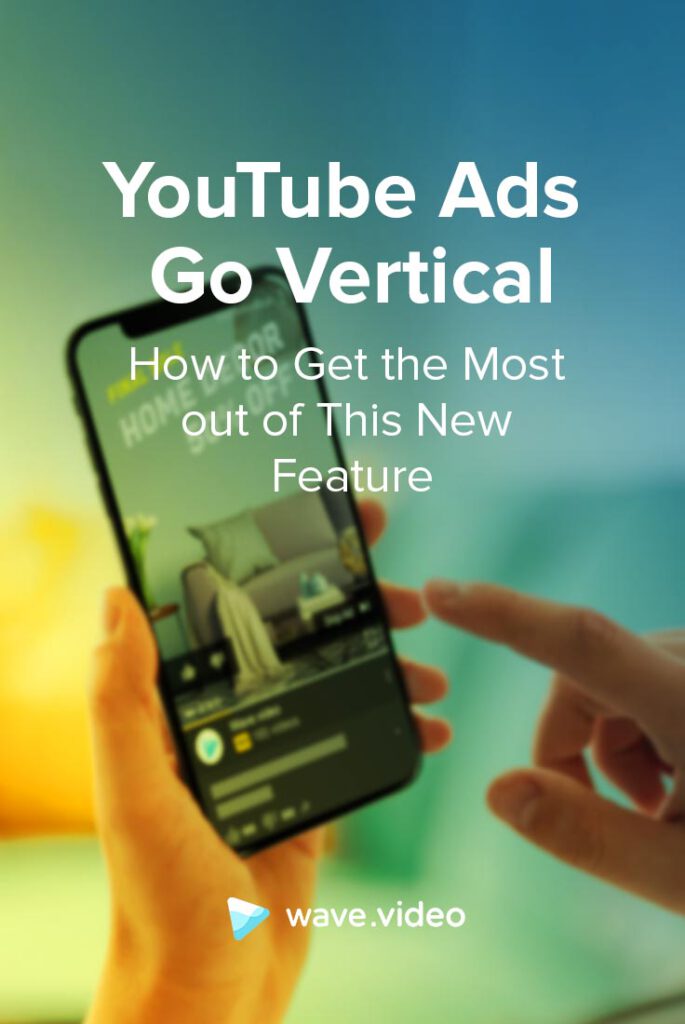Par Miloud Chennoufi, Ph.D, Universitaire établi au Canada
La Tunisie se trouve toujours la tourmente. Il y a une semaine, le président Kaies Saied décidait de prolonger les mesures d’exception qu’il avait imposées le 25 juillet. Le parlement demeure gelé et l’immunité de certains députés levée. Depuis le limogeage de Hichem Mechichi, le pays ne connait toujours pas son chef du gouvernement. Comment le fleuron de la démocratisation en Afrique du Nord est-il tombé dans une telle incertitude? Et surtout, quelles leçons en tirer, pas seulement pour la Tunisie et les Tunisien-nes, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui veulent réfléchir sérieusement aux exigences de la démocratisation?
Les adversaires du président ont qualifié ses actions de coup d’état. Ils se sont, pour la plupart, vite ravisés. On peut les comprendre; la situation est plus complexe pour se laisser saisir par quelque paradigme manichéen. Ceci, même si la référence du président à la constitution n’est pas sans faille. Le fameux article 80 stipule bien qu’« En cas de péril imminent (…), le président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances exceptionnelles. » Mais le même article précise tout de suite après que ces mesures doivent être prises « après consultation du chef du Gouvernement, du président de l’Assemblée des représentants du peuple et après avoir informé le président de la Cour constitutionnelle. » Or les mesures en question visaient justement le gouvernement et le parlement. La crise qui l’opposait à eux depuis le début de l’année avait atteint un point tel que la communication était rompue, ce qui rendait la consultation impossible. Plus fondamentalement encore, la cour constitutionnelle ne pouvait tout simplement pas être informée car elle n’existait et n’existe toujours pas, même si sa création était prévue dans la constitution de 2014.
Si elle avait été créée et si elle fonctionnait selon les exigence d’un état moderne, avant même de trancher sur la question de savoir si l’usage fait par le président Saied de l’article 80 était légitime, elle aurait mis un terme, et très tôt, à la crise qui l’a opposé au chef du gouvernement et au parlement. Elle n’aurait pas laissé les choses dégénérer et aurait pour ainsi dire étouffé le problème dans l’œuf. Elle aurait statué sur le bien-fondé de la nomination de certains ministres soupçonnés de corruption et sur le refus du président de les confirmer dans leurs postes. La Tunisie aurait évité de voir ses institutions paralysées pendant des mois. Mais pourquoi donc la cour constitutionnelle n’a-t-elle jamais vu le jour? Là réside un point d’accès de première importance à la complexité de la situation tunisienne. Pour que la cour constitutionnelle fut créée, il aurait fallu que les acteurs politiques tunisiens, toutes tendances confondues, admettent ce que prévoyait à cet effet la constitution qu’ils ont eux-mêmes adoptée, à savoir une institution non-partisane, faites de juges et de juristes n’obéissant à aucun parti, agissant au-dessus des intrigues politiques et des ambitions idéologiques des uns et des autres. Or chaque fois qu’il a été question de la mettre sur pied, tous les acteurs politiques ont tout fait pour qu’elle soit soumise à leur préférences idéologiques pour en faire un outil supplémentaire au service des luttes de pouvoir. Ils se sont donc neutralisés les uns les autres. La démocratie tunisienne demeurera ouverte aux crises à répétition tant et aussi longtemps que la conscience politique dans ce pays n’aura pas admis que dans un état de droit, pas même la politique ne saurait se soustraire au droit. Et qu’un tel impératif ne saurait être réalisé que lorsqu’on admet qu’une institution comme la cour constitutionnelle assure, non pas la justification idéologique des actions politiques, mais la conformité des actions politiques au droit.
L’autre élément de première importance mérite qu’on s’y attarde. Comment se fait-il qu’un peuple qui s’est soulevé si courageusement contre un système politique brutal, appelle le président à agir de manière ferme contre des institutions élues, puis approuve ses décisions? Le paradoxe s’estompe de lui-même dès qu’on ramène les pratiques de l’élite politique tunisienne issue du printemps arabe aux anticipations que les Tunisien-nes associent au changement. On peut dire que les attentes populaires appartiennent à trois catégories : celle du développement économique et social qui concerne la lutte contre le chômage et la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie, et l’efficacité du système de santé; celle de la bonne gouvernance qui concerne la lutte contre la corruption et la qualité des services à la population; enfin celle de l’inclusion politique qui concerne la liberté d’expression, le respect des droits humains et des élections libres.
Ces trois catégories forment une entité moléculaire qui exige d’être traitée comme telle par tout acteur intéressé à gouverner. Elle exige des compétences qu’il s’agit de développer alors qu’on se trouve encore dans l’opposition, une vision claire qui conçoit le pouvoir politique comme un moyen à mettre au service de la population sur chacune de ces trois catégories; et un sens élevé de la responsabilité qui se mesure à la capacité d’anticiper les conséquences de l’action politique. Ni ces compétences ni cette vision ni ce sens de la responsabilité n’apparaissent comme par enchantement une fois au pouvoir, encore moins lorsque la conscience politique dominante ne leur aura jamais prêté la moindre attention. Or ce sont là les attributs qui font que les politicien-nes soient aussi des hommes et des femmes d’état. Ce problème ne se limite pas à la Tunisie; il touche tous les pays de la région et même d’ailleurs.
L’observation de l’évolution politique en Tunisie nous permet de constater que l’élite politique tunisienne a concentré toute son attention sur la troisième catégorie. Et pour cause; elle leur permet d’accéder au pouvoir. On peut se réjouir de la convergence de toute la classe politique vers un tel moyen non-violent, du moins physiquement non-violent. C’est une condition nécessaire à l’édification démocratique, mais certainement pas une condition suffisante. Car lorsque seuls comptent l’accès au pouvoir et le maintien au pouvoir, la pratique politique est réduite à l’intrigue contre l’adversaire, aux polémiques stériles, à l’invective polarisante, bref à une dégradation de la politique qui épuise toutes les énergies et consument un temps précieux. Et cela a duré trop longtemps en Tunisie; l’exaspération de la population ne devrait surprendre personne.
Mais il y a pire. Réduite à sa forme la plus élémentaire de la lutte exclusive pour le pouvoir, la pratique politique est idéologique et fortement polarisante. Le pouvoir est à ce titre le moyen de dominer les démembrements de l’état, non pas dans le but de répondre aux préoccupations populaires des deux premières catégories (le développement économique durable et équitable, la qualité des services, la bonne gouvernance, etc.), mais pour imposer un projet idéologique rigide et finalement contraire à l’esprit même de la liberté politique. Certes, les islamistes tunisiens qui dominaient le parlement ne sont pas du genre à décapiter les gens sur la place publique, mais ils ne font pas moins planer sur la Tunisie le spectre turc. Car nulle part ailleurs qu’en Turquie, les islamistes n’ont autant battu en brèches la démocratie, leur fin ultime, en usant d’un mécanisme démocratique, les élections, leur moyen de choix. Ce faisant, ils ont non seulement porté des atteintes, dignes de l’autoritarisme le plus violent, aux droits humains les plus élémentaires, et se sont lancés dans des aventures guerrières meurtrières sans lendemain, ils ont surtout détruit ce qui s’annonçait il y a à peine quinze ans comme un véritable miracle économique. Si les citoyen-ness tunisien-nes ont dirigé leur colère contre les locaux d’Ennahda et les ont saccagés, c’est sans doute pour signifier aux leaders islamistes, Ghannouchi le premier, ce qu’ils avaient auparavant signifié au système Benali dans le passé, à savoir que l’état doit servir d’autres intérêts que les intérêts idéologiques étroits et les ambitions personnelles démesurées.
Le parti Ennahda est aujourd’hui pris dans le cercle infernal de sa propre crise. Le cloisonnement idéologique, nourri de décennie de socialisation dogmatique à travers la foi inébranlable dans un déterminisme selon lequel leur mission est d’imposer aux gens un mode de vie régimentaire et surtout que tout le reste, c’est-à-dire ce qui importe le plus aux citoyen-nes, sera réglé par la simple vertu de leur contrôle du pouvoir, ce cloisonnement a montré toutes ses limites. Non seulement cela s’est-il traduit par une incompétence flagrante, mais les pathologies mêmes contre lesquelles les Tunisien-nes s’étaient révolté-es, notamment et surtout la corruption, se sont développées de plus belle. Car lorsque le groupe idéologique se substitue à l’ensemble des citoyens pour être le seul digne d’attention, la corruption n’apparait plus comme une pathologie à combattre, mais comme moyen de renforcer le groupe idéologique dans sa lutte à tous ceux et toutes celles qui souhaiterait entraver le chemin menant à la réalisation de son projet idéologique. Seul l’aveuglement idéologique peut faire croire qu’une telle dérive ne soulèverait pas l’ire des citoyen-nes. Les idéologues rigides ne feront jamais que des politiciens moyens, jamais des hommes et des femmes d’état dignes d’un état moderne.
Mais même si elle est flagrante chez les islamistes, la négligence des préoccupations populaires caractérise aussi les autres forces politiques. Là non plus la raison ne tient pas à une volonté délibérée d’heurter la population, mais à la conséquence d’une conception de la pratique politique qui la réduit à la seule dimension d’un rapport de forces permanent qui devient par la force des choses une fin en soi. La conscience politique ainsi réduite est trop étroite pour saisir une caractéristique fondamentale de l’état moderne. Dans l’état moderne démocratique, les rapports de forces politiques et les luttes pour le pouvoir sont inévitables. Certes. Sauf que le pouvoir n’est pas une fin en soi. Accéder au pouvoir est absolument nécessaire, mais pas, du moins pas uniquement, pour s’y maintenir. Mais plutôt pour mettre en œuvre une vision et une stratégie et répondre aux préoccupations de la population. Or, c’est l’exact contraire qu’on trouve dans les partis non-islamistes ou anti-islamistes tunisiens. De surcroit, avec une tendance à la fragmentation et un esprit factieux, deux traits facilement reconnaissables de la réduction de la pratique politique à sa plus simple expression, la lutte pour le pouvoir.
On peut donc comprendre pourquoi la classe politique tunisienne a échoué sur le front économique et social, sur celui de la gouvernance aussi, et pourquoi elle a continué à générer de la corruption. Le problème est profond et la Tunisie – il faut le répéter – n’est pas la seule à en souffrir : une conscience politique encore incapable, malgré toutes les professions de foi, de se tourner vers les exigences de l’état moderne. Car seule la conscience politique propre aux hommes et femmes d’état authentique aurait pu convaincre à la fois le président de la république, le chef du gouvernement et le président du parlement, que l’urgence était de faire face à la détérioration des conditions socio-économiques et aux ravages de la pandémie. Bloquer toutes les institutions de l’état pendant des mois à cause de divergences sur la nomination de ministres témoigne du potentiel particulièrement destructeur d’une conscience politique qui ne tolère aucune limite aux luttes de pouvoir. La matrice qui a généré les obstacles qui ont empêché la création de la cour constitutionnelle est exactement la même qui a généré la crise de cette année.
Le président Saied a remarquablement remporté une belle victoire politique. Son succès s’explique par une erreur de jugement que ses adversaires ont commise. Et ils l’ont commise parce que la conscience politique dominante les a aveuglés sur une part importante de l’équation politique tunisienne. Le président est un indépendant, ne disposant pas d’un parti politique sur lequel s’appuyer pour mener des batailles politiques. C’est un fait incontestable mais qui n’aurait pas dû pousser ses adversaires à conclure qu’il était trop faible pour leur faire tête. Pas seulement parce qu’ils devaient garder présent à l’esprit qu’il avait été élu président avec 73% des voix contre leurs propres candidats, mais aussi parce qu’il n’y avait aucune raison de croire que son isolement supposé allait l’empêcher de mieux lire les signaux en provenance de la rue. Ces signaux auxquels ses adversaires étaient totalement aveugles. Il ne pouvait pas en être autrement car lorsque la pratique politique est réduite aux luttes d’appareils, le champ politique rétrécit au point d’exclure totalement les citoyen-nes. C’est le péril qui guette toute démocratie encore peu mature.
Le président a donc compris que la colère de la population n’était pas dirigée contre lui mais contre ses adversaires. Il a aussi compris qu’il pouvait apparaitre comme le sauveur aux yeux d’une population épuisée par les difficultés économiques et plus encore par une pandémie qui ont mis à nu l’incurie des gouvernants. Les organisations de la société civile comme la centrale syndicale, le mouvement des femmes, et autres activistes, qui sont les véritables porteurs du projet démocratique en Tunisie, auraient pu s’opposer à ses mesures. Elles ont, en majorité, préféré la neutralité et le rôle de force de proposition. Tout simplement parce qu’elles partageaient le point de vue populaire selon lequel hormis les élections et les luttes de pouvoir, la classe politique tunisienne ne s’est pas montrée à la hauteur des défis.
Le président dispose d’un atout. La population croit en la sincérité de ses sentiments et de ses actions contre la corruption. Mais pour combien de temps encore? La greffe démocratique semble avoir bien pris en Tunisie. Les pleins pouvoirs et les mesures d’exception n’ont pas beaucoup de chances de perdurer éternellement. À juste titre, des voix s’élèvent déjà dans une société civile autrement plus crédible que la classe politique pour revendiquer plus de clarté sur le retour nécessaire au fonctionnement normale des institutions. Le président ne peut pas les ignorer. Même si cela a toutes les chances de reproduire les mêmes pratiques qui ont conduit à la crise. Les mesures d’exceptions ont permis de mettre à l’avant plan toutes les limites de la classe politique tunisienne et de la conscience politique défaillante qui l’anime. Mais à elles seules ces mesures ne sont pas susceptibles de régler le fond du problème. Le président peut participer partiellement à faire émerger une culture politique d’hommes et de femmes en créant un parti politique avec une vision et une stratégie selon lesquelles le pouvoir n’est qu’un moyen pour affronter les questions de fond qui préoccupent les citoyen-nes. Advenant une telle évolution (ce n’est pas du tout certain), la Tunisie aura franchi un pas décisif dans la bonne direction, mais néanmoins insuffisant. Car la culture d’hommes et de femmes d’état a besoin de dominer les esprits de tous les acteurs politiques tunisiens. Nous en sommes encore loin car les esprits sont encore dominés par la réduction de la pratique politique à la recherche du pouvoir pour le pouvoir ou pour faire de l’état le vecteur rigide d’un projet idéologique dogmatique.
On se souvient qu’en 2016, la société civile tunisienne recevait avec beaucoup de mérite le prix Nobel de la paix pour avoir dénoué, deux ans auparavant, une crise causée par les politiciens de l’assemblée constituante dont les luttes de pouvoir et les ambitions idéologiques ont failli noyer la Tunisie dans le chaos et la violence. On sait aujourd’hui que sans une pression provenant de l’extérieur du champ politique, les politiciens ne parviendront pas à agir en hommes et en femmes d’état responsables. Leur instinct premier les pousse systématiquement vers l’intrigue et son lot de superficialité et d’incompétence. En 2021 c’est en définitive la rue qui a mis un terme momentané aux dérives politiques. Il est impératif maintenant que la rue s’organise et se structure, et avec les organisations de la société civile imposer une culture d’état, un sens de la responsabilité et de la nécessité de développer les compétences nécessaires pour gérer l’état et le faire fonctionner au service de la population. Une conscience politique qui réduit le pouvoir au seul statu qui doit être le sien, celui de moyen et rien de plus. Ce n’est que de la sorte que, par exemple, la création de la cour constitutionnelle cessera d’être une mission impossible, et que les exigences d’un état moderne, démocratique et efficace seront enfin réunies.