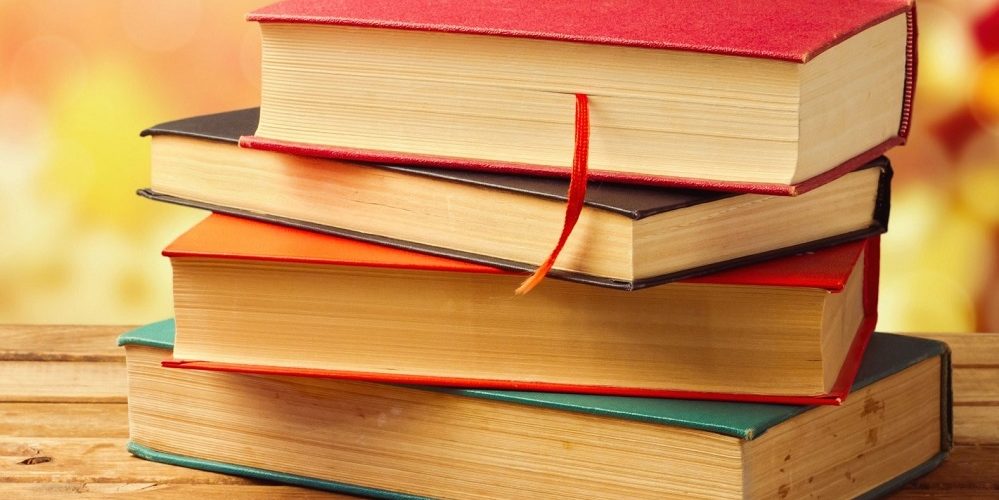Par Abdellali Merdaci
Lorsqu’on s’empare du débat intellectuel, même le plus farouche, il convient d’en maîtriser les codes, notamment le respect des adversaires. Ou passer outre, dans un immense carnage. Le professeur Ahmed Latrèche, qui a retenu depuis bien longtemps la seconde option, n’en mesure pas les effets pervers, nuisible à court et long termes. Il commence son pamphlet contre une critique et des critiques qui l’indisposent par l’expression d’une autosatisfaction, qui n’a aucun lien avec l’humilité universitaire : « Je crois que j’ai suivi le parcours de presque tous les écrivains et intellectuels de ce pays vivant en Algérie ou à l’étranger. Comme journaliste et professeur d’université. Certes, je parle trop rarement de leurs déclarations, sauf quand je les interviewe, il m’arrive parfois de leur poser de très rares questions sur leur itinéraire personnel. Le reste, le plus important, c’est leur production littéraire, artistique et intellectuelle » (1). Le sieur « Ahmed Latrèche », révélé ailleurs sous un autre patronyme, a tout vu, tout su. Il a, ainsi, fait le tour de la question littéraire algérienne en ses qualités successives de journaliste et d’enseignant-chercheur universitaire. C’est au nom de cette imparable autorité de témoin de la scène culturelle algérienne, dont il n’ignore rien, qu’il flagelle de supposées plumes et pensées « déviantes » auxquelles il intime l’ordre de cesser de « diaboliser les écrivains et les intellectuels ».
Les propos des écrivains au crible de l’analyse : un gage de scientificité ?
Depuis les travaux de Gustave Lanson, au début du XXe siècle, il est admis que la littérature est un « fait social », justifiable de lectures sur différents registres de la théorie littéraire, de l’histoire, de la sociologie, de la politique, de l’idéologie – et cela se sait, aussi, depuis l’analyse de la « Gradiva » (1903) de Wilhelm Jensen par Freud, à la même époque, de la psychologie et de la psychanalyse. Or, la littérature comme les arts, réalité sociale et sociétale, a son entière place dans le débat public, dans un langage partagé par tous. Ce dont disconvient Ahmed Latrèche, qui entreprend relativement à certaines déclarations d’écrivains, affleurant dans l’actualité et dans les marges de leurs œuvres, de « démonter les mécanismes de fonctionnement de leurs discours en utilisant les outils nécessaires d’analyse ». Ne s’agit-il pas, en l’espèce, de pédantisme malencontreux ?
Quelle grille interprétative ou descriptive solliciterait l’universitaire annabi pour répondre à une billevesée de Boualem Sansal devant les convives d’un diner du CRIF, à Paris, sur « l’inexistence de la Palestine » ? Ou à une sornette de Kamel Daoud proclamant, en 2014, son « indifférence » envers les Palestiniens au moment où ils mouraient à Ghaza ? La même, nécessairement, que celle qu’il appliquerait rigoureusement à l’une de leurs œuvres, par exemple « Le Village de l’Allemand. Journal des frères Schiller » (2008) ou « Meursault, contre-enquête » (2013-2014) ? Cuistrerie ! Est-ce bien là que réside l’urgence et l’intelligence du débat sur la littérature ? Pourquoi ce débat serait-il l’apanage de la seule Université algérienne et de ses maîtres qui, sur le plan de l’analyse invoquée toutes voiles dehors par le professeur annabi, ont montré leur absolue inanité. Je ne me souviens pas que dans cette toute première Université de l’Est algérien, dans laquelle j’ai longtemps enseigné, d’une seule discussion sur les œuvres et sur les parcours d’écrivains algériens. Et, je ne pense pas, que la situation de l’Université d’Annaba, d’où parle Ahmed Latrèche, fut meilleure et optimale. Rien n’a jamais été plus commun à nos Universités que leur médiocrité. Si leurs maitres de chaires savaient déconstruire des œuvres littéraires, les rayons des librairies en témoigneraient. Des singularités, peut-être ? Mais il faut les rechercher à la lampe-torche dans le tunnel de l’ignorance qu’est devenue l’institution académique algérienne.
Il faut faire le constat de la « méthode Latrèche » et de la vacuité de ses « outils d’analyse ». J’ai écrit des centaines d’articles, contributions et opinions sur la vie littéraire algérienne et, parfois, des comptes rendus d’ouvrages sans aucune surenchère de jargon inutile et vaniteux : il faut toujours éclairer plus qu’enluminer les œuvres. Ce n’est pas le rôle du critique et de l’historien de la littérature. Si des générations de professeurs et d’étudiants d’universités algériennes n’ont ni connu ni éprouvé le carré magique dans leur lecture d’œuvres littéraires, comment en faire la démonstration dans un article de presse ? C’est une pure hypocrisie de renvoyer le débat littéraire public, qui concerne tous les Algériens sans exception, à un fastidieux arsenal de théories littéraires au moment où l’Université algérienne n’en a pas l’usage. Ahmed Latrèche disqualifie toute profération publique sur l’espace littéraire, ses auteurs, ses œuvres, qui n’ait reçue la sanction de l’Université, de ses vagues méthodes et de ses tortueux « outils d’analyse ». Afféterie, certainement. En d’autres vocables, sans doute cruels : Tmachtiq ma’arifa !
Un discours biaisé sur l’histoire littéraire algérienne
Je suis le seul universitaire algérien à avoir mis en cause, ces derniers mois, les parcours des écrivains Mohammed Dib (1920-2003), qui a fait, depuis 1959, le choix de la France en tournant le dos à l’Algérie, et d’Assia Djebar (1936-2015), rompant définitivement avec l’Algérie en 1985, et de bien d’autres écrivains à l’étroit dans leur pays et dans leur nationalité, car, semble-t-il, ailleurs l’herbe est toujours plus verte. Voici ce que rétorque Latrèche : « Jamais, les uns et les autres ne posent la bonne question : pourquoi ont-ils décidé de quitter le pays et de travailler à l’étranger, notamment en France ? » Si Ahmed Latrèche pouvait expliquer, documents historiques à l’appui, le départ définitif d’Algérie de Mohammed Dib, en 1959, ce serait une signalée avancée de l’histoire littéraire algérienne – spécialement des années 1950. J’ai, en mes pratiques d’historien, de critique littéraire et de lecteur professionnel, envisagé la question, la « bonne question, de l’appartenance des écrivains à leur pays de naissance, à leur nation née de la guerre anticoloniale (1954-1962). Si l’écrivain, en particulier, et les hommes et femmes de culture, en général, ont un statut qui les exonère de leur présence dans l’histoire collective de la société algérienne, aucune règle de science n’en a convenu.
Autant, il est possible, en Allemagne avec le cas Günter Grass, Prix Nobel de Littérature 1999, rattrapé par son passé nazi, et en France, de débattre, parfois de la manière la plus extrême des engagements des écrivains, de l’antisémitisme de Louis-Ferdinand Céline, revisité par Philippe Muray, en 2012, et Annick Duraffour et Pierre-André Taguieff, en 2017, de Lucien Rebatet et Jacques Chardonne, du fascisme de Pierre Drieu la Rochelle, du pétainisme de Paul Morand, par exemple, cette licence n’est donc pas acceptable en Algérie où les inflexions politico-idéologiques et les déblatérations des écrivains ne sont pas discutables parce qu’ils seraient une « ligne rouge ». Ainsi, c’est pure jalousie de clouer au pilori les joyeuses fumisteries de Boualem Sansal, Kamel Daoud et Yasmina Khadra, qui se sont plus exprimé en dehors de leurs œuvres dans de fulgurants discours d’escorte, aussi rageurs que pouvaient l’être en leur temps les discours collaborationnistes et nazis en France.
Il y a dans les marges des œuvres de certains auteurs algériens (ou prétendument algériens) des assertions sur lesquelles il faut simplement se taire à défaut de dégainer son précis d’analyse textuelle refondu et augmenté ? Lorsque l’écrivain français Salim Bachi exhale sa haine envers l’Algérie, en martelant que son « avenir n’est pas là-bas », il faudrait, selon la vulgate de Latrèche, sortit la grosse artillerie critique et théorique pour lui répondre, parce que c’est un « putain d’écrivain » et qu’il faut respecter tout ce qu’il vomit dans ses œuvres et en dehors d’elles comme des sommets de la création littéraire. Mais Bachi et ses semblables ne sont que de piètres écrivaillons, bâtards de la France doublés de saligauds. Et c’est le cas pour tous ces pseudo-intellectuels qui ont fui l’Algérie, la grande « harba » au cœur des meurtres islamistes et des souffrances de la « décennie rouge ». Slimane Benaissa (une relation d’Ahmed Latrèche, féru de théâtre), exfiltré d’Algérie par les « services » de l’ambassade de France à Alger et aussitôt naturalisé français, aurait donc raison contre tous ses contradicteurs qui ont exposé leur corps aux balles et aux couteaux des tueurs intégristes dans ces funestes années 1990, y compris l’auteur de ces lignes ? Continuons : lorsque le romancier Anouar Benmalek, qui affiche sa nationalité française en 4e page de couverture de ses ouvrages, déclare que lorsqu’il se rend en Algérie à l’invitation du gouvernement algérien et de ses ministres de la Culture pour parader dans les stands du SILA, il présente à l’aéroport d’Alger son passeport français (2), il faudrait applaudir et, mieux encore, extraire de la naphtaline quelques vieux outils d’analyse stylistique. Ce n’est pas très honorable.
Mais de qui parle-t-on ici ? D’écrivains français d’origine algérienne ou algériens assimilés français. Je défie le professeur Ahmed Latrèche, devant ses amis de Facebook et devant tous les Algériens ayant un intérêt pour la littérature, de nommer un seul auteur algérien, une seule œuvre algérienne éditée en Algérie, qui soient reconnus et primés en France, de 1962 à aujourd’hui. J’exclus, bien entendu, les rares auteurs, comme Kamel Daoud, qui ont débuté une carrière algérienne – sans retentissement – rachetés et consacrés par la France littéraire. Il est incontestablement établi que les écrivains nés français d’origine algérienne, parfois lointaines, les écrivains naturalisés français et les écrivains algériens assimilés français, qui ont badigeonné leur face de pissat de chien enragé, poussés par la France, prennent la place des écrivains algériens dans les rencontres littéraires internationales, partout dans le monde. L’Algérie littéraire, c’est eux. Les vérités d’Ahmed Latrèche sur la littérature algérienne ne sont pas les miennes dans mon combat pour un espace littéraire national algérien autonome, définitivement dégagé de l’emprise néocoloniale française et de ses harkis. Noter que Bachi, Benaïssa, Benmalek et beaucoup d’autres sont français, est-ce les déchoir d’une nationalité algérienne originelle qu’ils ont volontairement délaissée par conviction personnelle dont ils se réclament sans honte aux seules fins de manger l’Algérie par tous les bouts ? Horreur !
Les écrivains algériens ou français d’origine algérienne d’aujourd’hui, qui ont fait le choix de la France ou d’une assimilation littéraire française (c’est le cas de Boualem Sansal, Yasmina Khadra), savent mordre l’Algérie jusqu’à l’os. Ils ne méritent pas la moindre indulgence lorsqu’ils lui assènent des coups à l’estomac. Leurs intempérances ouvrent-elles un cercle vertueux ? Comment répondre à leurs violences répétées envers l’Algérie et les Algériens en requérant les pincettes aseptisées de la sémiologie et de l’herméneutique ? Face à de tels flibustiers des lettres, le critique ne devrait, comme autrefois Michel Leiris, s’en remettre qu’à l’art de la tauromachie, qui n’est jamais vain.
Écrivains algériens ou français d’origine algérienne en France : il n’y a plus d’exil
Le professeur Latrèche recense à tort dans ce débat des écrivains et des intellectuels qui auraient été malmenés et chassés d’Algérie par les pouvoirs qui s’y sont succédé, indiquant : « tout ce beau monde s’était retrouvé en France malgré lui ». Gros et honteux mensonge. Ainsi, cite-t-il Rachid Boudjedra, qui aurait été dans les années 1960-1970 un « contrebandier de l’Histoire », lui retournant sa propre formule, qu’il décochait contre les mêmes crapules littéraires que nous combattons. Je ne me souviens pas que Rachid Boudjedra ait été appelé au ban de l’infamie dans son pays. Il a quitté l’Algérie vers la fin des années 1960 pour pouvoir écrire des livres qui n’auraient pas été publiés en Algérie à cette époque. Quoique cette vérité est toute relative : dans le recueil de poèmes « Pour ne plus rêver », publié par les Éditions nationales algériennes, en 1965, réédité par la SNED, en 1980, Boudjedra pouvait écrire : « Mère arme moi d’acier / Apprends-moi l’horreur / Barde-moi de feu / De haine / Pour que je puisse gifler la justice / Jusqu’à ce qu’elle se mette debout » (« Hymne à l’horreur »). Ses mots « fripés » n’ont-ils pas traversé les âges de nos fureurs et de nos déconvenues ? A-t-il été censuré ? Non. « La Répudiation » (1969) est un roman vrai, d’une grande puissance narrative et je regrette qu’il ne soit pas lu dans l’École algérienne, mais je garde toujours la souvenance émue des vers du poète.
Le poète communiste a, certes, été emprisonné, comme beaucoup de militants de gauche du FLN, au lendemain du « redressement révolutionnaire » du 19 juin 1965, qui n’était pas un coup d’État militaire, puisque la structure du pouvoir n’avait pas changé – encore moins ses polices parallèles. Pendant une dizaine d’années, Boudjedra a séjourné en France et au Maroc, avant de retourner à Alger où il a pu exercer, dans les années 1980, au ministère de la Culture et, même, en qualité de lecteur dans l’édition nationale de l’époque, qui était réputée être un « bunker soviétique », qui lui vaut d’être traité par un marmiton français de la critique littéraire, Tristan Leperlier (3), de « censeur ». L’intégrité morale de l’écrivain et de l’intellectuel Rachid Boudjedra n’a jamais été entachée, ni dans les années 1960-1970, ni après.
Mais, il n’y a (presque) rien à dire sur Kateb Yacine, Mourad Bourboune, Ahmed Azzegagh. Si Bourboune, membre de la Commission culturelle du FLN, membre du comité de rédaction de sa revue culturelle « Novembre », sous le règne d’Ahmed Ben Bella, a eu maille à partir avec le pouvoir au lendemain du 19 juin 1965, il est aussi vrai qu’il a fait depuis cette période des choix de vie en dehors de l’Algérie. Bourboune est resté relativement à son pays dans une immuable éthique : il ne s’en est jamais pris à son pays pour construire en France une œuvre et une présence dans le champ littéraire français. Ni Kateb ni Azzegagh n’ont été brimés par le pouvoir ni connu la paille des prisons. Il serait inconsidéré, comme le fera Mohammed Dib, de leur reprocher d’avoir couru les sinécures de la pos-indépendance. Il ne faudrait jamais faire dire à l’Histoire ce qu’elle ne peut véridiquement attester.
Quant à « Ahmed Mahiou, Bencheikh, Harbi, Kadri, El Kenz, Chebel, Marouf, Guemriche », réunis dans une photo de famille par Ahmed Latrèche, ils ont décidé de leur propre chef d’aller en France pour y rechercher des horizons professionnels et familiaux. Radicalement, loin de l’Algérie. Certains d’entre eux ont été naturalisés français et il aurait été d’une signalée probité intellectuelle pour eux de ne pas se faire passer pour un écrivain ou un penseur algérien lorsqu’ils gardent dans leur poche la carte d’identité nationale française. Un exemple ? Le sociologue Aïssa Kadri a quitté l’Algérie à dix-sept (ou dix-huit) ans, bien avant l’indépendance, protégé par un ancien haut fonctionnaire de la colonie algérienne, du rang de préfet, il n’y est jamais revenu pour avoir concrètement un vécu algérien. Est-ce bien le maléfique pouvoir d’Alger qui l’a bouté hors du pays ? A-t-il été depuis son départ volontaire d’Algérie à ce jour acculé à un infini exil en France ? Non ! Il a décidé de son avenir et de son pays d’élection en toute liberté. Il en a le droit. Comme les autres personnalités de cette pittoresque gravure aux tons sépia du professeur Latrèche, mais, de grâce, n’en faisons pas des victimes de pouvoirs félons. Dans ce groupe d’écrivains et d’intellectuels, seul Salah Guemriche s’est prononcé sur la nationalité algérienne à laquelle il dit n’avoir jamais renoncé, tout en menant une carrière d’écrivain pleinement assimilé dans la littérature française, bien intégré dans la vire littéraire, trainant aux bois de justice et faisant condamner l’émérite lexicologue Alain Rey, un jour ou l’autre, visiteur sans encombre de l’État d’Israël – avec quel passeport ?
J’ai déjà traité dans de précédentes contributions les itinéraires de Mohamed Harbi, Mohammed Dib, Ali Merad, Mohammed Arkoun et Assia Djebar, pour ne pas y insister ici. Mohamed Harbi, cacique du FLN, a été visé par les purges du 19 juin 1965 et emprisonné : il a tourné, assez tôt, la page de cette histoire douloureuse pour se reconstruire depuis maintenant près de cinquante années en France. Si l’Algérie a été pour lui le lieu du témoignage et de l’écriture historienne, elle n’est plus son destin. Il n’y retournera plus et ce n’est pas « malgré lui ». Beaucoup d’intellectuels, entre autres Harbi, qui sont présentés comme d’extraordinaires modèles, ont écrit sur l’Algérie par procuration, garantissant des carrières françaises sans être directement confrontés au réel algérien. Pour interpréter et juger un pays, il faut y vivre.
Je n’ai aucune compétence pour déchoir quiconque d’une nationalité algérienne, même s’il l’a abandonnée et déshonorée. Quant aux harkis, ne sont-ils pas une création de l’Algérie coloniale française et c’est la France qui n’en finit pas d’assurer la survie et le recrutement ? Je ne crois pas à une histoire de la littérature nationale hybride, plus marquée du côté de la France et de sa périphérie littéraire algérienne. Pourquoi l’espace littéraire national algérien serait-il définitivement annexé à la France parce que des écrivains et des penseurs, en France et en Algérie, le veulent ? Est-il tabou de poser la question du lien des écrivains et des intellectuels au pays qu’ils définitivement quittés – ou trahi ; et à sa littérature ? De quelle légitimité strictement nationale peuvent-ils se réclamer ?
Jamel Eddine Bencheikh (1930-2005), né à Casablanca, au Maroc, a été un universitaire éminent et un poète rare, mais il a choisi en toute volonté la France et son œuvre entre nécessairement dans le bilan de la France littéraire, quoiqu’il ait ressenti d’une algérianité problématique envers laquelle il n’a pas été respectueux. Personne ne s’aventurerait à dire de Madame de Staël et de Jean-Jacques Rousseau qu’ils sont suisses, d’Eugène Ionesco qu’il est roumain, de Romain Gary, qu’il est lituanien. Et Atiq Rahimi, afghan. Comment dire de Bencheikh et de tous les naturalisés français des champs culturels et universitaires qu’ils sont algériens ? Ils ont tous été naturalisés par des décrets de l’État français signés par le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur des gouvernements en exercice et insérés dans le Journal officiel de la République française. Il n’y a rien qui soit plus solennel que ce passage de frontière, de nationalité, qui appelle la loyauté envers le pays d’accueil et le pays d’origine. Dans son enquête sur « les nouveaux bi-nationaux franco-algériens », en fait les nouveaux Français d’origine algérienne, l’historienne Séverine Labat a montré que le désir de la France a été le motif le plus décisif dans leur conversion.
Mais tranchons aussi un argument éculé. Si le seul lieu de naissance devrait valider l’algérianité des écrivains, il s’imposera d’intégrer à la littérature nationale algérienne les Français Jean Pelegri (qui avait décliné l’offre de Jean Sénac de s’affilier à la première Union des écrivains algériens [UEA], en 1963), Marie Cardinal, Jean Daniel, Marcel Moussy, Jules Roy, Jean-Pierre Millecam, Christian Murciaux, Gabriel Audisio, Rose Celli, Edmond Brua, Roger Curel et beaucoup d’autres concevant les œuvres littéraires de la France coloniale. Et pourquoi ne pas concéder des droits dans la littérature algérienne du pays indépendant à Charles Courtin, propagateur du racisme littéraire ? Et, sans ciller, inscrire dans son panthéon Louis Bertrand (littérature de l’Algérie latine), Robert Randau (mouvement littéraire algérianiste) et Albert Camus (École d’Alger), de triste mémoire, les chefs de file de la littérature coloniale française d’Algérie.
Mais, il n’y a que les actes authentiques, vérifiables, qui valent lorsqu’il s’agit de se compter dans la littérature nationale algérienne et dans la proximité du peuple et de la nation d’Algérie et de son État, indépendant et souverain. Rappelons pour mémoire des faits et leur vérité nue, en citant, ici, les seuls écrivains dans les trajectoires et les stratégies d’entrée dans le champ littéraire français ont été étudiés : les archives de l’écrivain Dib légués à la France, l’infaillible levée de bouclier et le refus de la littérature nationale algérienne par Assia Djebar, la participation de Boualem Sansal et de Kamel Daoud (avant qu’il n’opte pour la naturalisation française) à Lillehammer (Norvège) et de Yasmina Khadra, à Djeddah (Arabie saoudite) à la diplomatie culturelle française, sous les plis du drapeau français ? Mais les forfaitures d’écrivains fallacieusement attachés à l’espace littéraire national algérien sont nombreuses. Comment Ahmed Latrèche, avec son bagage critique revendiqué, expliquerait-il ces situations ? Évidemment, il n’y répond pas.
Dans toutes les patries du monde, les honneurs et les récompenses sont décernées pour marquer l’ampleur d’un engagement de personne ou de groupe dans un aspect de la vie de la société. Pourquoi l’Algérie indépendante devrait-elle encore honorer et célébrer ceux qui ne lui ont rien donné ? Ainsi Dib, fut-il le plus sublime écrivain mondial, qui n’a même pas fait l’effort d’y vivre, et Assia Djebar, à laquelle elle a attribué le nom à un grand prix littéraire national sans aucune justification crédible. Ont-ils été, de leur vivant, dans la pleine mesure de leur pensée et de leurs actes, de ce pays, de ses écorchures, de ses douleurs ? Et la liste de vilenies de nombreux candidats à une gloire algérienne, algériens, français d’origine algérienne ou entre deux eaux est si longue, pour s’y prêter.
Critique littéraire, goulags de la pensée et hôpitaux psychiatriques
Lorsque j’ai été agressé, l’été 2012, par le critique français Antoine Perraud, prenant la défense de Boualem Sansal, de retour de Jérusalem, sur les ondes de France Culture et dans les pages du site d’information Mediapart, le professeur annabi a été le seul universitaire algérien à réagir à un mépris fortement daté, celui du colon envers l’Indigène d’antan, même si c’était tardif, quatre années après l’attaque du commis aux basses œuvres de la presse littéraire parisienne. Il écrivait ainsi : « L’interviewer [Antoine Perraud] ajoute une couche en évoquant la persécution et en insistant sur une illusoire vie de ‘‘paria’’ [de Sansal], alors qu’il est souvent célébré dans la presse en Algérie. L’un des très rares articles critiques est celui de l’universitaire, Abdellali Merdaci, qui, d’ailleurs, avait été traité de tous les noms par un journaliste de Mediapart qui considère qu’il [Sansal] était ‘‘menacé de prison pour avoir accepté l’invitation du Festival international de littérature de Jérusalem – où il rencontra David Grossman, comme lui lauréat du Prix pour la paix des libraires allemands –, Boualem Sansal est traîné dans la boue par une presse algérienne haineuse, aux ordres, cadenassée politiquement et mentalement’’ » (4).
Il est navrant que Latrèche utilise, aujourd’hui, dix ans après, envers moi, les semblables et horribles abjections du folliculaire de Mediapart, même s’il prend le soin de ne jamais citer mon nom, et aussi envers les critiques qui ont écorné la sainte trinité Sansal-Daoud-Khadra dans sa marche irrésistible vers la gloire des caniveaux germanopratins. Nommons-les, puisqu’ils ont ajouté leur subtile partition au sacrilège : Ahmed Bensaada, remarquable essayiste de « Kamel Daoud. Cologne, contre-enquête » (2016), les écrivains Youssef Benzetat et Mohamed Abdoun, le philosophe Mohamed Bouhamidi, la journaliste Lila Kenniche, ont contribué à une réflexion éminente sur l’histoire immédiate de la littérature algérienne de langue française. Je voudrais aussi ajouter le compagnonnage intellectuel d’Amar Djerrad, Boualem Snaoui, Mehdi Messaoudi et de l’exceptionnel publiciste Rafaa Abboud, sur le front de l’histoire politique et culturelle de l’Algérie actuelle. La littérature, même après Marx, ne saurait s’exclure de la société qui se transforme – et, Roland Barthes en désignait les changements de nature et même d’identité lorsqu’elle se mue en écriture, miroir de la société, portant les séismes de l’Histoire et ses fêlures (5). Des mutations de la littérature algérienne, des lâchetés ordinaires de ses auteurs, nous en avons témoigné en toute humilité, aux moments où l’Université se taisait et se tait toujours : nous ne sommes ni des assassins de l’espoir qu’apporteraient la littérature, ses auteurs et ses œuvres, ni des incendiaires de bibliothèques, ni des juges d’un tribunal de la foi médiéval. Peut-être d’incorrigibles rêveurs, sans « complexes », qui croient à l’espérance des mots, pour savoir en dénoncer les impostures.
Je reprends les fuligineuses incriminations de Perraud et de Latrèche, fulminant contre cette critique qui le dérange tant, qui n’en finit pas de « diaboliser » écrivains et intellectuels, pour mettre en évidence leur similitude : l’un et l’autre, en psychologues empruntés, ravivent des « complexes » destructeurs. Il est vrai que défendre son pays contre les compromissions et sermons acrimonieux d’écrivains algériens français et assimilés français expose aux pires diagnostics psychiatriques.
– Perraud.
« Il ne faut lire qu’un article tâchant de délégitimer Sansal. Jetez un œil sur celui d’Abdellali Merdaci. On y trouve la technique des plumes mercenaires pratiquant la chasse aux opposants de toute dictature. Merdaci (linguiste de l’Université de Constantine) fait feu de tout bois en plaquant du sous-Bourdieu surinterprété, avec une approche symptomatique : ôter toute racine algérienne à Sansal pour l’opposer aux écrivains israéliens, enracinés. Sa diatribe ressasse un complexe de décolonisé – requis par son tête-à-tête étouffant, rageur, vain et mystifié à l’ancien maître –, dont à su s’affranchir, pour sa part, Boualem Sansal » (6).
– Latrèche.
« C’est une honte d’oublier le travail de l’écrivain pour oser, et de quel droit, chercher à le déchoir de sa nationalité ou à en faire un harki, alors que celui qui parle ainsi vit tragiquement un délicat complexe d’infériorité, une pathologie psychologique très particulière ». « Il faudrait que les uns et les autres se libèrent du complexe du colonisé ».
Voilà des griefs clairement énoncés. Après Perraud, utilisant la semblable nosographie clinique, Latrèche se fait le défenseur de Sansal et de ses acolytes Daoud et Khadra, Dib, Djebar et d’intellectuels « diabolisés ». Il pèche par manque d’originalité, passant du « complexe de décolonisé » que m’oppose Perraud, au « complexe d’infériorité » et au « complexe de colonisé » dont il accable une critique mal léchée. Ce sont-là des notions fossiles de la psychanalyse, aujourd’hui oubliées, totem primaire des présomptueux et des demi-lettrés (7). Outre, le fait qu’il se range derrière les âneries de Parraud et son argumentaire étriqué, Latrèche se projette en spécialiste de psychologie clinique et pathologique.
Cette manière de discréditer l’adversaire – au moyen d’un savoir clinique sauvage – n’est pas neuve ; elle a été éprouvée par l’historiographie coloniale, refoulant à la fois de leur terre, de leur culture, de leur être profond les Indigènes algériens. Cette réduction de l’Autre sur le registre clinique est aussi évocatrice d’un désinvestissement colonial de l’Indigène algérien dont faisait état Frantz Fanon à propos des travaux cliniques du professeur de psychiatrie Antoine Porot, de l’Université d’Alger, théoricien raciste du « primitivisme ». Car au décours de notre histoire coloniale, il fut un temps où il était acquis que l’Indigène ne pense pas en raison d’une déficience congénitale du cerveau.
Je subodorais très naïvement que les hôpitaux psychiatriques et leurs infaillibles tableaux cliniques pour bâillonner les mauvais coucheurs s’inscrivaient dans les mécomptes de la défunte Union soviétique ; il n’en est rien, ils sont prestement agis par Ahmed Latrèche, inférant contre ceux qui ne pensent pas comme lui des troubles encore innommables de l’étiologie clinique, cette « pathologie psychologique très particulière », ce typique « complexe d’infériorité » infligé à toute expression libre. Un spécimen de la psychiatrie pénitentiaire de l’ex-URSS !
Où résident le « complexe d’infériorité » et la trame psychopathologique qu’impute Latrèche aux critiques – malveillants ? – envers sa sacro-sainte trinité de rabouilleurs, qui ne prennent pas de gants et rejettent ces fastidieuses recettes d’explication des textes que les tartufes de l’Université s’acharnent à diffuser dans une institution en hibernation ? L’imprudent professeur, qui affirme bruyamment tout savoir, fait une lecture paresseuse de Frantz Fanon (« Les Damnés de la terre, 1961). Mais a-t-il parcouru Albert Memmi (« Portait du colonisé », 1957 ; « Portrait du décolonisé », 2000) ? Cependant, qu’importe pour Ahmed Latrèche : tous les défenseurs de l’Algérie indépendante et souveraine, qui refusent le néocolonialisme français, sa mainmise sur l’espace littéraire national algérien, la harka littéraire soumise à la France littéraire et à l’État français, la relation – précisément décomplexée – avec le sionisme international, seraient d’incurables complexés. Ce verbiage « clinique » n’a qu’un défaut : il n’est qu’une épouvantable échappatoire lorsqu’on est, comme Perraud et à sa suite Latrèche, démuni scientifiquement et intellectuellement. Les sociologues Philippe Lucas et Jean-Claude Vatin pointaient dans « L’Algérie des anthropologues » (1975) une « Algérie des chimères et des idées historiquement condamnées ». Ainsi la « négation-éviction de l’Autre », dépoussiérée dans son fonds colonial, persiste. Simplement, consternant.
Harkis, résolument harkis.
La réalité de l’Histoire est lourde de sens. Pourquoi la France, deux cents trente- trois ans après la Révolution de 1789, n’a toujours pas exorcisé les démons de son histoire, alors que la jeune nation algérienne, de soixante ans d’âge, devrait se montrer plus résiliente envers les drames de la colonisation française, ses épopées sanglantes, ses exterminations orchestrées et, surtout, ses génocides ? Rappeler la résistance algérienne à l’occupation coloniale française, sa guerre contre une colonisation française sanglante, est le socle d’une histoire algérienne, qui si elle pressent l’avenir, ne peut se fermer au passé, si proche. Et, c’est cette Algérie martyre qui a enfanté dans les ruines fumantes de la colonisation le nouveau peuple algérien, qui lui a donné une identité et une dignité.
Est-il légitime qu’un Kamel Daoud, qui sans l’Algérie indépendante, son école, son université, sa presse (de « Détective » au « Quotidien d’Oran »), son édition (de Dar El Gharb à Barzakh), serait au mieux, à l’ancienneté, le gardien d’une porcherie à Mesra-Mostaganem, comme le suggère malicieusement Ahmed Bensaada (8), crache encore et encore son venin sur l’Algérie, qui n’est plus son pays, symbole du « décolonial » qu’il abhorre. Oui, mais Daoud n’est pas le seul à avoir trahi les sacrifices de son pays, sali son histoire nationale indépendantiste, piétiné ses chouhada dans leurs hypogées, injurié ses moudjahidine. Pourquoi, lui et ses comparses, ne justifieraient-ils pas l’ignominieuse tache sur leur front de harki ?
Kamel Daoud et beaucoup d’autres écrivains auraient pu se battre pour faire émerger un espace littéraire national algérien autonome, indépendant de la France littéraire et de l’État français, ils ont préféré plutôt les rejoindre pour en hâter la mort. Si chaque Algérien, dans tous les domaines d’activités, se déclare non concerné par l’avenir de l’Algérie, que lui restera-t-il ? J’évoque toujours l’histoire de la littérature nationale de l’Irlande (Eire) sous la botte du colonialisme anglais, semblable à celle de l’Algérie sous la tutelle coloniale française. Cette littérature irlandaise, contrairement à notre littérature des années 1950, a sanctifié le combat politique anticolonial, l’accompagnant jusqu’à son terme, la proclamation de la République d’Irlande, en 1921. Les écrivains irlandais ont décidé de couper toute attache avec l’édition anglaise, retournant aux fondamentaux culturels de leur pays. La voie, c’était Dublin contre Londres ; si cet objectif des écrivains irlandais, à leur tête William Butler Yeats, Prix Nobel de Littérature 1923, préfigurait une littérature nationale autonome, ce ne sera pas le cas en Algérie.
Les écrivains algériens des années 1950 édités en France, à l’exception de Malek Haddad, quittant le PCA pour le FLN, ont refusé de s’engager dans le combat libérateur de leur pays. Des combattants mouraient en Algérie, mais aussi en France, nos écrivains n’avaient le souci que de leurs œuvres et de leurs carrières, adoubés par le champ littéraire germanopratin. Mais, le pays, libéré territorialement et politiquement, avait renoncé à affranchir un pan essentiel de sa culture nationale, notamment sa littérature de langue française, restée sous l’emprise de la France. Depuis le 3 juillet 1962 jusqu’à nos jours, il y a un pays et deux littératures : une littérature dite « algérienne » dont les auteurs sont Français ou Algériens assimilés, qui se fait à Paris depuis 1952, la seule reconnue au plan international, et une littérature encagée, écrite et publiée en Algérie depuis 1963, éternellement mineure tant qu’elle est barrée dans la monde par la littérature « algérienne » de Paris, excroissance de la littérature française.
C’est compliqué à comprendre ? Voici un ultime exemple : le romancier strictement algérien Hamid Grine ne passera jamais, au grand jamais, les frontières de l’Algérie, pour aller voguer vers le vaste monde. Grine, répétons-le, possède une langue française et une langue littéraire sans commune mesure avec celles du romancier assimilé français Yasmina Khadra, qui ne peut l’égaler en termes de créativité littéraire. Mais, il souffre d’un obstacle irrémédiable : il n’est lu que chez lui en Algérie dans l’exclusive langue française et il n’est même pas traduit en arabe et en tamazight, langues officielles de l’État algérien, quand à penser qu’un jour il serait lu dans la pampa d’Argentine ou dans les Rocheuses, aux États-Unis d’Amérique, c’est une vue de l’esprit. Il lui faudra chercher, au prix de l’indignité son sésame auprès de l’édition française, qui est en mesure de porter le petit Khadra et ses œuvres hardiment colligées jusqu’au désert de Mongolie et bientôt sur Mars. Voilà, en 2022, la vérité de l’espace littéraire national algérien, irrémédiablement dominé par la France littéraire, qui n’a même pas la capacité de placer ses auteurs et leurs œuvres chez ses voisins frontaliers. Quant au désert de Mongolie et Mars, il viendra le temps d’en reparler. Ni la France littéraire ni l’État français, qui la soutient, ne sont prêts à sortir de cette donne néocoloniale. Cette situation de littérature nationale algérienne dominée, l’Université algérienne, ressassant les oukases de ses maîtres de l’Université française, en détourne le regard.
En Irlande, le romancier James Joyce (« Ulysse », 1918-1920 ; 1922) a traité ses compatriotes écrivains qui, comme Georges Bernard Shaw, Prix Nobel de Littérature 1925, ont rejoint Londres et sa littérature, de « bouffons ». Beaucoup d’écrivains algériens et français d’origine algérienne ont participé volontairement à l’effacement de la littérature nationale de leur pays et à son émergence dans l’universalité. Le terme qui les désigne le plus fidèlement en regard de notre histoire nationale est « harki ». Y en a-t-il d’autres plus exécrables ?
L’exclusive urgence : pour un espace littéraire national algérien autonome
Entouré par sa tribu de flagorneurs sur Facebook, le professeur Ahmed Latrèche peut, en s’extirpant de ses hauteurs célestes, désigner les « bons » et les « mauvais » dans le champ culturel national et s’aviser de l’urgence d’un « véritable projet culturel » et d’un indispensable « état des lieux ». Pourquoi cet objectif ne serait-il pas accordé à la seule littérature, précisément de langue française, pour la sortir de l’ornière néocolonialiste française ? Ni le théâtre, ni la musique, ni les arts d’Algérie, ne sont structurellement dépendants de la France et ils ont pu assurer, au gré du temps, leur autonomie.
La France devra tôt ou tard lever sa pesante semelle de fer sur la littérature algérienne de langue française. Et renoncer à en faire une périphérie de la littérature française. Le Français Salim Bachi est un haut fonctionnaire de la Culture française, successivement directeur de l’Institut français de York (Irlande), puis membre du cabinet du président de l’Institut du Monde arabe, à Paris. Pourquoi la France littéraire n’assigne-t-elle pas leur juste place dans la littérature française à tous ses écrivains français d’origine algérienne, à l’instar de Bachi, au lieu de les embrigader dans une trompeuse « littérature algérienne », qui bloque l’émergence mondiale d’une vraie littérature algérienne, de ses auteurs, de ses œuvres.
Ni Akli Tadjer ni Farida Belghoul, Abdelkader Djemaï, Nina Bouraoui, Karim Amellal, ambassadeur de France, Leïla Sebbar, Faiza Guène, Sofia Aouine, Fatima Daas, et je mettrais à leur suite plus de cent noms, ne sont algériens. Français, sûrement, comme Lilia Hassaine, née en France de parents et de grands parents français, présentée à Paris, affreuse plaisanterie, comme un « espoir » de la littérature algérienne, alors qu’elle n’a jamais mis les pieds en Algérie, un pays étranger pour elle. Que la France littéraire arrête ce jeu malsain, qu’elle intègre dans sa famille ses propres enfants qui ne font et ne feront que la littérature de leur pays, la France. Les écrivains français des banlieues françaises ne peuvent incarner la littérature d’un pays et d’une nation qui ne sont pas les leurs. Après soixante-dix années de domination et d’accaparement de la littérature des Algériens, depuis 1952, la France littéraire et l’État français devraient être dans la clarté relativement à l’Algérie et à sa littérature.
Mais, c’est vrai que la reconnaissance de la littérature algérienne de langue française ne viendra en Algérie et partout dans le monde que de ses écrivains, de ses éditeurs, des médias et de l’Université qui doivent les accompagner. Et, principalement, de ses lecteurs. Malheureusement, il y a, aujourd’hui encore, une commune lâcheté, une démission sans honneur : tous se taisent lorsqu’ils ne dressent pas les bûchers de l’inquisition et n’ouvrent pas les portes des hôpitaux psychiatriques pour ceux qui « osent », c’est le vocable d’Ahmed Latrèche, nommer les choses et défendre la possibilité d’un espace littéraire national algérien autonome. Le combat continue. Qassaman !
Notes
- « Il serait temps d’arrêter de diaboliser les écrivains et les intellectuels », post sur FB (https://www.facebook.com/acheniki/posts/pfbid024zJdgiayTqfMDgHna38eVNhPumhpqo5Lnyx4cW1ahHeLJ1BbEwSdpEDgJgbe3j7Sl). On observera le ton comminatoire de l’adresse : « Il serait temps… » Les citations de Latrèche sont référées à ce texte.
- Voir : Séverine Labat, « La France réinventée. Les nouveaux bi-nationaux franco-algériens, Paris, Publisud, 2010, p. 188.
- « Algérie, les écrivains dans la décennie noire », Paris, CNRS, 2017.
- « Qu’est-ce qui fait courir Sansal ? », « Le Matin » [en ligne], 21 mars 2016.
- Roland Barthes, Maurice Nadeau, « Sur la littérature », Presses universitaires de Grenoble, 1980.
- Sur ce dossier, voir Abdellali Merdaci, « Engagements. Une critique au quotidien », Constantine, Médersa, 2014, pp. 115-139.
- Il s’agit dans ces termes d’une métapsychologie freudienne, désormais obsolète, dépolarisé par les classifications actuelles des troubles de la personnalité et des nouvelles voies de la psychanalyse.
- Ahmed Bensaada, « Kamel Daoud. Cologne, contre-enquête », Préface de Jacques-Marie Bourget, Boumerdès, Éditions Frantz Fanon, 2016, p. 124.
POST-SCRIPTUM
Emmanuel Macron, voyageur de l’Algérie coloniale .
Le président français Emmanuel Macron continuera à rouler les Algériens dans la farine. Après ses propos inconsidérés sur « la nation algérienne qui n’a jamais existé avant la colonisation française » et sur le « pouvoir politico-militaire » qui gère la « rente mémorielle », il s’invite pour une visite d’État en Algérie, du 25 au 27 août 2022. Le programme en est connu : il ignorera la vieille classe politique, préférant dialoguer avec de jeunes algériens, probablement repérés et filtrés dans les programmes « Campus » de l’Institut français ; ce qui s’appelle miser sur l’avenir, sur un investissement français.
Au programme également une escapade à Oran, précisons une escapade mémorielle. Macron visitera ainsi la maison rénovée du couturier Yves Saint-Laurent (1936-2008), symbole d’une colonisation française que les Algériens ont combattue par les armes. Cette maison, restaurée par un marchand de sommeil milliardaire de la baie d’Oran, enfant perdu de la France d’antan, figure aussi ce qu’attend la France de l’Algérie et des Algériens, un retour à une soumission néocoloniale. Il y aura toujours des Algériens pour entretenir les reliques de la colonie française et en faire de providentiels lieux de mémoire. La prochaine restauration annoncée est celle de la maison familiale de l’écrivain pied-noir Albert Camus (1913-1960), Prix Nobel de Littérature 1957, dans le quartier de Belouizdad, à Alger. Tout est ficelé, paraît-il, il reste seulement à savoir quel entrepreneur milliardaire de la baie d’Alger en garantira le financement. À cette marche, au rythme effréné des projets de sauvetage de la France d’Algérie, parlera-t-on bientôt de la rénovation du palais des gouverneurs de l’Algérie coloniale française.
C’est pour quand, M. Macron, les escadrilles de la France, de l’OTAN et d’Israël dans la darse d’Alger, pour refaire un juillet 1830 à nouveaux frais ? Il y aura une phalange de milliardaires de toutes les baies d’Algérie et de nostalgiques endurcis de « l’Algérie de papa » pour y souscrire. Quant aux amis de la France qui peuplent les hauteurs d’Alger, ils n’attendent que de monter sur les chars de l’OTAN pour en finir avec le « pouvoir politico-militaire » après avoir échoué à renverser la République algérienne démocratique et populaire par le néo-hirak. Cette propension du président français à éveiller, en Algérie même, la mémoire de l’Algérie française est une injure aux Algériens et à l’Algérie martyre.