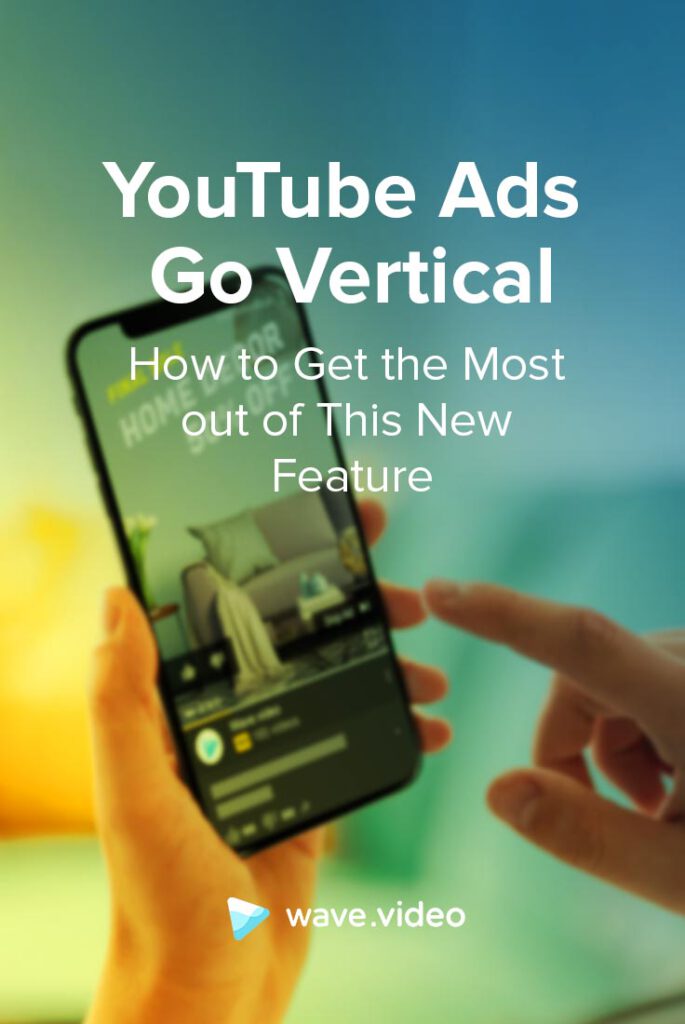Par Djamel Labidi
Suite à la contribution du professeur Abdellali Merdaci sur les réformes en cours dans l’université algérienne (« Jusqu’où veut aller M. Kamel Baddari ? », « Algérie 54 », 11-13 janvier 2023), voici un point de vue sur deux aspects abordés dans son texte.
1°) L’assiduité des étudiants
En gros, dans le monde, deux systèmes existent qui déterminent l’assiduité :
– l’université payante, privée ou en partie privée. Le problème de l’assiduité ne s’y pose pas pour des raisons évidentes : l’intérêt même de l’étudiant (et de ses parents) est de rentabiliser son investissement et donc d’être assidu.
– L’université gratuite où il faut faire appel à d’autres mécanismes de motivations, ou de contraintes voire de répression (exclusion momentanée, interdiction d’examen après plusieurs absences etc.)
Avec Adam Smith, le père de l’économie politique, le système universitaire anglo-saxon s’est révélé peu à peu supérieur en intégrant la notion de concurrence. C’est d’ailleurs ce qui a fait à un moment de l’Histoire la supériorité de l’Occident, la généralisation de la concurrence, dans tous les domaines de la vie sociale et culturelle, avec sa conséquence la promotion individuelle et le progrès. Ce n’est évidemment pas par hasard que ce sont les économistes classiques anglais qui ont introduit le principe de concurrence à l’Université puisqu’ils en vantaient les vertus dans tous les domaines.
Adam Smith avait un jugement très dur à l’égard de l’Université de son temps et beaucoup de mépris pour ce qu’il appelait les professeurs « véreux ». Il disait des professeurs d’Oxford que « depuis longtemps, ils ne font même plus semblant d’enseigner ». Ils reliaient la médiocrité de l’Université anglaise d’alors à l’existence d’une majorité de professeurs incompétents. Il propose dans son ouvrage « La Théorie des sentiments moraux et la richesse des Nations » (1776) une organisation de l’enseignement qui consiste à s’efforcer de satisfaire les étudiants, en récompensant par des prix les plus méritants et en leur donnant la liberté de choisir leurs enseignants, ce qui instaure une concurrence entre les enseignants. Les professeurs touchent ainsi un salaire qui dépend de leur « notoriété », du nombre d’étudiants qu’ils forment, de travaux qu’ils dirigent, bref de leur travail réel. Ce système de concurrence est encore, aujourd’hui, celui pour l’essentiel, des universités anglo-saxonnes et de la plupart des universités compétitives dans le monde organisées encore suivant ces principes, notamment en Asie.
– Nous vivons encore pour l’essentiel sur l’héritage du système français malgré la réforme de 1971.
Le système français a été organisé suivant deux grandes structures : le système des universités d’une part, le système des grandes écoles supérieures d’autre part. Le premier est ouvert à tout le monde, le deuxième forme les élites et est sélectif.
Dans les universités, le principe qui domine c’est le laissez faire, voire le laissez aller, tandis que dans les grandes Écoles, dont l’État français se soucie avant tout, les étudiants sont bien encadrés et suivis.
Dans les Universités, les étudiants à la sortie du lycée où ils avaient été encadrés, sont en général livrés à eux-mêmes, désemparés, dans une liberté trompeuse. La déperdition est grande, et c’est d’ailleurs le but recherché, une sorte de sélection naturelle. Dans les universités, c’est la pagaille. En France, le spectacle souvent de bâtiments universitaires mal entretenus, tagués, parfois sales est à lui seul éloquent.
Comme le métier de professeur est libéral, sans aucun contrôle, il n’y a que leur conscience professionnelle qui les contrôle. Métier libéral, ils ont peu de charges horaires, donc beaucoup de temps, car ils sont supposés faire de la recherche ce qui n’est souvent pas le cas. Mais dans ce libéralisme, qui est en principe nécessaire à la créativité intellectuelle, c’est l’esprit du fonctionnaire qui domine, rien ne vient stimuler la production scientifique. Les enseignants sont tous payés de la même façon, en fonction de leur grade administratif, quelles que soient la qualité ou la quantité de leur travail. « Pourquoi me fatiguer si je suis payé comme ce collègue paresseux et absentéiste ? » Il n’y a aucune concurrence à part morale. Mais la créativité scientifique, le nombre de publication a peu de relations avec l’amélioration de la situation matérielle, hors les grades obtenus. Le métier d’universitaire peut devenir alors un métier de paresseux.
– La réforme de 1971 n’est pas venue corriger cela. Elle a été essentiellement productiviste, sur le modèle des sociétés nationales d’alors qui dominait: le slogan principal de la réforme était la « formation du maximum de cadres au moindre coût », d’où une vision de l’Université chargée de former « à des postes de travail précis » alors que l’organisation de l’Université obéit à la division du travail scientifique et non à celle du secteur économique. Un des aspects pervers de la Réforme a été la dévaluation de la conférence, du cours magistral supposée être donnée par les professeurs les plus élevés en grade. Cette dévaluation est venue de la survalorisation des travaux dirigés puisqu’ils étaient les seuls moments où se contrôlait l’assiduité, ce qui a fini par sous-entendre dans les faits que le cours magistral était facultatif, etc.
L’enseignement a été organisé en modules. L’idée était de gagner du temps, d’éviter les redoublements, de coller mieux aux débouchés (poste de travail) dans le monde économique. Mais finalement, au fil du temps, du fait des contraintes de la réalité trop longues à développer ici, c’est l’ancien système qui est revenu avec notamment l’organisation en facultés, ou plus exactement une sorte de patchwork des deux systèmes, l’ancien et celui de la Réforme.
Mais en réalité peu importe, mon avis est que tous les systèmes d’organisation se valent. L’illusion bureaucratique consiste à croire que c’est l’organisation administrative de l’Université qui détermine son efficacité, alors que c’est l’enseignant qui en est l’élément déterminant s’il vit dans des conditions de compétition scientifique et de reconnaissance de ses efforts. Mais ceci a été en permanence sous-estimé. Les salaires des universitaires pendant longtemps ont été misérables.
La question de l’assiduité est à voir aussi à l’aune des énormes transformations technologiques. On continue de la poser de façon moralisante, comme dans la vieille école, et à culpabiliser les étudiants, avec des réflexes d’une autre époque, où tout le savoir était à l’Université et chez les professeurs. Ce qui n’est plus le cas. Le professeur n’est plus la source du savoir. Aujourd’hui, on parle d’un « système de production et de diffusion des connaissances », système scientifique et technique, médias, technologies de la communication, dont l’Université est seulement un des éléments.
Quel intérêt y a-t-il pour un étudiant d’être présent dans l’amphi alors qu’il peut avoir le polycop du cours ou même la photocopie des notes de son camarade ? Le professeur ne fait pas plus, dans la majorité des cas, que répéter mot pour mot son cours des années précédentes. Ne serait-il pas mieux, par exemple, d’envoyer par email aux étudiants le cours pour consacrer la séance magistrale à des questions sur ce cours, à la façon avec laquelle il a été produit , bref à une discussion qui porte sur l’essentiel, c’est-à-dire la méthode, la recherche et la production de la connaissance. Il est vrai que cela demande beaucoup de confiance du professeur en ses capacités.
À quoi cela sert même de faire apprendre un cours, lorsqu’on trouve tout sur Internet, les grands sociologues, les techniques d’enquête sociologiques, les économistes et leurs œuvres, les écoles de littératures , la physique, les mathématiques, etc. Ne serait-il pas mieux tout simplement de donner une bibliographie et de simplement contrôler qu’elle a été utile. J’ai eu l’idée un jour de comparer les notes d’examen avec l’assiduité. J’ai eu la surprise de constater qu’il n’y avait aucun rapport entre elles, et que souvent les meilleures notes étaient celles des étudiants absentéistes.
Bref, il faut partir de la réalité. Au lieu de condamner les étudiants pour leur absentéisme, il faut se poser la question des raisons de celle-ci, et notamment l’existence d’une façon d’enseigner qui ne correspond plus à notre temps. Il y a toute une révolution à faire dans les méthodes d’enseignement. Le plus souvent une vidéo, un documentaire font apprendre plus qu’un cours universitaire et de façon plus agréable.
Il y a aussi évidemment des causes sociales à la question de l’absentéisme : beaucoup d’étudiants travaillent parallèlement par nécessité. Peut-être faudrait-il là aussi établir un système de concurrence, par exemple un concours pour des bourses spéciales, consistantes.
2°) La question linguistique
Sur cette question, le professeur Abdellali Merdaci met en garde contre le discours politique et idéologique. Mais toute question dans la société, qu’elle soit économique, sociale, culturelle, fait fatalement l’objet d’une approche politique et idéologique, pour la raison bien simple qu’elle implique des conflits d’intérêts. . Le rôle du discours politique et idéologique est de masquer ces conflits en présentant une position partisane comme celle de la défense de l’intérêt général. La langue est un instrument de pouvoir économique, social, culturel. Elle fait donc inévitablement l’objet de conflits d’intérêts. Puisqu’intérêts il y a, la vraie question est de savoir si ces intérêts correspondent à ceux d’une minorité ou de la majorité. Cela reste cependant toujours la défense d’intérêts, et il faut donc éviter toute approche moralisante. En Algérie, le conflit oppose essentiellement le groupe social francophone minoritaire et le groupe social de culture arabo-musulmane majoritaire.
. Je suis donc pour son apprentissage intense aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. Cela au moins pour deux raisons :
– La première est que l’anglais est la langue des relations internationales, qu’elles soient économiques, commerciales, scientifiques et techniques, culturelles. C’est un fait qui s’impose. Le spectacle de nos élites francophones, notamment les plus âgées, qui, dans les réunions internationales de tout ordre cherchent désespérément un francophone avec qui communiquer est pathétique. Il en est de même des difficultés de nos élites dans les relations économiques et commerciales.
La langue a une fonction économique. Elle est le principal instrument des échanges commerciaux : on achète au pays dont on connait la langue. Le quasi-monopole du français contribue grandement à bloquer nos échanges en les polarisant vers la France, et donc à bloquer notre évolution. L’anglais, est lui, au contraire, une langue mondiale qui permet de s’ouvrir sur tous les marchés. Plus tard, qui sait, c’est le chinois qui prendra cette place. Il faut être concret, pragmatique et ne rien essentialiser.
En Afrique, les seuls pays qui ont commencé à émerger sont anglophones ou ralliés à l’anglais comme le Rwanda. Dans le domaine scientifique, c’est la même chose, nos échanges en langue française en limitent énormément la surface et en bornant nos horizons, ou ils nous obligent à une sous-traitance avec la France. Les Français eux-mêmes sont passés à l’anglais. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il nous faut donc sortir du ghetto de la francophonie, du monolinguisme français et de ses conséquences désastreuses pour nos échanges avec le monde, avec l’isolement de nos élites, notamment universitaires, qui en a découlé.
– La deuxième raison est que l’anglais sera utilisé et fonctionnera vraiment comme une langue étrangère. Il ne remplira pas les fonctions d’une langue nationale comme le fait le français dans la vie du pays, dans l’administration, dans la vie politique, dans l’activité économique où il continue de dominer, dans les relations sociales, etc., avec toutes les tensions civiles qui en découlent. L’anglais n’a pas de racines sociales en Algérie, dans un groupe historique précis, et il remplira donc vraiment les fonctions d’une langue étrangère, celle de la langue utile et nécessaire aux échanges extérieurs.Il y aura donc beaucoup moins les conséquences que signale justement Abdellali Merdaci concernant la « dimension impérialiste des langues ».En dehors des pays anglophones, l’anglais ne s’est substitué à aucune langue nationale.