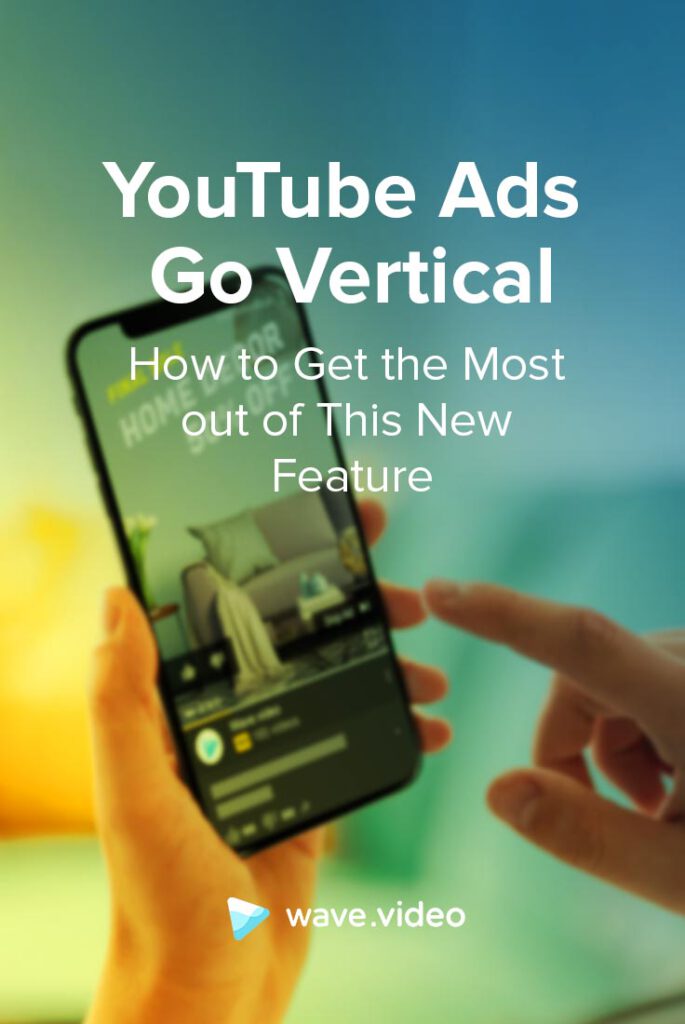Par Abdellali Merdaci
J’ai dénoncé dans une contribution donnée à Algérie 54, le 16 janvier 2022, la consécration par un Prix littéraire de l’Université Constantine 1-Mentouri du roman colonial « La Kafrado. Un nouveau départ » (2021) de Malika Chitour Daoudi. Au-delà de la liberté de création des auteurs, la littérature algérienne de langue française, produite en Algérie par des auteurs algériens pour des lecteurs algériens, doit aller vers d’impérieuses ruptures pour envisager un avenir sans legs coloniaux ou néocoloniaux.
Que ce soit à Constantine, Tlemcen et Alger, les Prix littéraires actuels, notamment ceux consacrant les noms de Mohammed Dib et d’Assia Djebar, marquent l’inaptitude de l’espace littéraire national à s’autonomiser et à rompre avec les fantômes du passé. Quelle peut être la vertu des prix littéraires, des principaux prix littéraires algériens, s’ils sont mal nommés ? Ceux qui honorent les écrivains disparus Mohammed Dib (1920-2003) et Assia Djebar (1936-2015) n’ont jamais considéré leur parcours d’écrivains décentrés dans leur rapport à l’Algérie et à sa littérature. Ni Dib ni Djebar n’ont apporté leur contribution au développement d’un espace littéraire national libéré de tutelles étrangères. Leurs choix d’écrivains, promouvant des carrières fortement égocentriques, loin de l’Algérie, appellent-ils la reconnaissance et la gratitude de la nation qu’ils n’ont pas aidée lorsqu’ils l’ont de leur propre volonté rejetée ?
Malika Chitour Daoudi : l’inconfortable silence des responsables
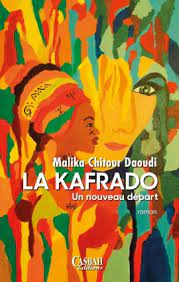
« La Kafrado » de Chitour Daoudi, qui fait l’apologie de la politique du peuplement colonial, se situe à contre-courant de l’Algérie résistant au XIXe siècle à la conquête coloniale française (1). Comment imaginer, en 2021 et en 2022, un roman algérien valorisant une héroïne typique du peuplement colonial de l’Algérie ? Le prix qui lui a été décerné par un jury littéraire d’une institution officielle de l’État – l’Université Constantine 1-Mentouri – n’a fait l’objet d’aucune réaction des hauts responsables du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C’est une évidente situation de mépris qui ne peut couvrir un scandale politico-littéraire. Il est tout autant surprenant que le gouvernement, notamment ses ministres des Moudjahidine et de la Culture, ainsi que l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), qui s’est montrée dans un passé récent soucieuse des atteintes à l’histoire nationale, n’aient pas réagi à une odieuse célébration d’une œuvre littéraire, redorant le blason de l’occupation coloniale française de l’Algérie.
Sans doute, ils n’en ont pas été informés. Même s’il n’y a que dix Algériens qui lisent le journal en ligne Algérie 54 qui a publié ma contribution indignée, ils se trouvent parmi eux des journalistes, et spécialement des journalistes attachés à l’actualité littéraire et culturelle, qui ont choisi face à cet événement singulier de faire le dos rond, de se taire. Le lendemain de la publication de mon article, qui signalait cette scandaleuse injure à l’histoire et aux souffrances des Algériens pendant la période coloniale française, la romancière Chitour Daoudi était accueillie par la librairie L’Arbre à dires, à Alger, qui lui a offert une tribune, et ce n’est pas la première, pour faire connaître son ouvrage et son héroïne sicilienne, enseignant une colonisation apaisée de l’Algérie. Les responsables de cette librairie lisent-ils les auteurs qu’ils reçoivent ? Bien entendu, il ne s’agit pas de censurer la parole et l’action de quiconque, ni des écrivains ni de leurs éditeurs ni des libraires, mais d’attirer l’attention sur une sourde banalisation de la colonisation et un pernicieux processus de reconnaissance et de valorisation de la conquête coloniale française de l’Algérie. Le roman « La Kafrado » y contribue pleinement. Lecteurs et critiques, lui ont-ils apporté la nécessaire contradiction de l’histoire éprouvante de notre pays sous le joug colonial ? Lorsqu’on a appuyé « La Kafrado », on n’a pas aimé l’Algérie et on a piétiné ses martyrs dans leurs mausolées.
Dans « Le Quotidien indépendant », la journaliste Nacima Chabani, commentant le passage de la romancière de « La Kafrado » à la librairie L’Arbre à dires, livrant une sommaire recension de l’œuvre, évoque l’Algérie française comme un « Eldorado » (2), utilisant dans le titre de son article la notion guerrière de « conquête », encourageant la politique de peuplement colonial issu de toutes les cités de la Méditerranée. Elle décrit positivement l’entreprise coloniale objet du roman à travers ses personnages féminins emblématiques : « Armées de pugnacité, les deux femmes [la Sicilienne Francesca et l’esclave dogon Dorado] arrivent à fonder un domaine agricole portant le nom ‘‘La Kafrado’’ ». Nacima Chabani, spécialiste des événements culturels, ne peut être soupçonnée de ne pas savoir lire un roman. Elle s’aligne nettement sur la vulgate colonialiste de l’autrice et de son récit. Sans soumettre à la critique la position fondamentale du melting pot colonial qui y est développée. Cet « eldorado », c’est la terre d’Algérie – convient-il d’y insister ? – enlevée aux tribus, à ses propriétaires, par la violence des armes et du droit colonial pour être transférée à des colons.
C’est inacceptable dans notre pays martyr de la colonisation française. Mme Chitour Daoudi n’a reçu dans la presse algérienne que des recensions laudatrices (3). Inconscience ou approbation d’une lecture de l’histoire coloniale diffractée ? Qui défendra ce pays contre les paris d’incendiaires de la mémoire nationale ?
Le premier choix du jury du Prix littéraire de l’Université Constantine 1-Mentouri, odieux et scélérat, est plus qu’un ratage, qui donne son approbation à une œuvre apologétique de la colonisation française en Algérie. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ses plus hautes autorités, et au-delà d’eux le Premier ministère, réagissent-ils aux errements d’une institution sous leur responsabilité directe ? Mme Chitour Daoudi – convient-il d’y revenir ? – a la liberté de dire ce qu’est pour elle une bonne colonisation de l’Algérie, une institution de l’État qui la cautionne par une prix littéraire n’est pas excusable.
Mohammed Dib et le déni de la terre sacrée de l’Algérie

Il y a quelques mois, je mettais en cause le parcours d’écrivain de Mohammed Dib, plus précisément à ce qui se rapporte à l’Algérie, et aussi le Prix littéraire qui porte son nom, qui prolonge sa présence en Algérie et dans son histoire littéraire (4). Mohammed Dib a quitté l’Algérie en 1959, dans les derniers mois de la guerre anticoloniale pour s’installer définitivement en France. Son lien avec l’Algérie s’est progressivement effacé et son dernier roman à thème spécifiquement algérien, « Le Maître de chasse » a été publié en 1973 par le Seuil, à Paris. Le fait est que Dib n’a épousé aucune des causes nationalistes de l’Algérie pendant la guerre et depuis l’indépendance – même celles du Parti communiste algérien dont il était réputé proche. Il est vrai que beaucoup de ses pairs n’ont pas rejoint le combat libérateur des Algériens pour sortir de l’ornière coloniale française et n’ont pas honoré les devoirs nouveaux envers le pays libéré et la nation algérienne ressourcée. Ce sont des choix qui engagent. Dib, quel que soit son talent d’écrivain qui n’est pas en cause, s’est projeté comme un étranger à la terre de ses aïeux, aux joies et aux malheurs d’une nation et d’un peuple, qui inventent et réinventent son nom, l’Algérie.
Aussi grand fut-il, Mohammed Dib ne sera jamais plus grand que l’Algérie et les Algériens qui ont aimé l’auteur de « La Grande maison » (1952) et de « L’Incendie » (1984), que la plupart d’entre eux n’avaient pas lus, qu’ils connaissaient par les images émouvantes du cinéaste Mustapha Badie dans leur adaptation pour la télévision nationale sous le titre « El Harik » (1982-1984). Mohammed Dib a tourné le dos à ce témoignage de fraternité des Algériens, lorsqu’il ne les a pas déçus. Il s’est tu devant leurs espérances enchaînées, devant leurs rêves contrariés.
Que valent un homme et une femme hors de leurs engagements à l’aune d’une éthique sans accrocs ? Dib, personnalité publique de renom, a fait le choix de la France, le pays de son épouse et de ses enfants. Il ne s’agit pas de le lui discuter. Mais, simplement, d’en prendre acte. Quand je me suis inquiété de la nationalité de Mohammed Dib, une de ses filles me répond par l’entremise du chroniqueur tlemcénien Amine Bouali du « Quotidien d’Oran » et du site d’information en ligne Algérie 1, notant son enregistrement régulier auprès de services consulaires algériens en France et des services des préfectures de police français chargés des migrants algériens (5). Il aurait fallu en publier la preuve. Ainsi Dib aurait vécu en France, de 1959 à sa disparition, le 3 mai 2003, pendant quarante-cinq ans, avec une carte de résident étranger. J’ai interpellé M. Mohamed-Antar Daoud, ambassadeur d’Algérie en France, temporairement en retrait à Alger, afin de clarifier cette situation d’une figure tutélaire de la littérature, qui ne relève pas du secret d’État, à son retour à sa charge. M. l’ambassadeur à repris son service à Paris, alors attendons (6).
Marié à une Française, père d’enfants français, résident permanent en France, Mohammed Dib est automatiquement naturalisé français selon la législation française, sans passer par les ressorts prévus par les Accords d’Évian signés par le GPRA et le gouvernement français le 18 mars 1962. C’est ce vécu, exclusivement français, qui l’a conduit à transmettre par clause testamentaire ses archives d’écrivain non pas à une institution algérienne mais à la Bibliothèque nationale française. Cela ne l’éloigne-t-il pas de l’Algérie ? Tout Algérien, digne de cette nationalité, n’aurait-il pas privilégié son propre pays ? Pourquoi un fonds d’archives Mohammed Dib, qui aurait pu encourager la création d’un centre d’études dédié à l’auteur et à la littérature algérienne, n’aurait-il pas été possible en Algérie – voire même dans la cité natale de l’écrivain ? L’Algérie n’est donc pas éligible à conserver la mémoire des écrits de l’écrivain. Je souhaite que les animateurs de l’association « La Grande maison » et du prix littéraire Mohammed Dib aient l’honnêteté de répondre à cette dommageable situation, qui ressortit plus des engagements et des responsabilités sociétales de l’écrivain que de son œuvre.
Dans cette triste circonstance de désaveu de son pays natal, Mohammed Dib justifie-t-il un prix littéraire portant son nom dans une Algérie qu’il a abandonnée en toute volonté, à laquelle il n’a rien apporté de son vivant, de sa gloire passée et présente. Combien aurait été salutaire la parole de Dib défendant la cause du FLN et de l’ALN et de leur gouvernement provisoire pour laquelle des Algériens mouraient, combien aurait été salutaire la parole de Mohammed Dib, en témoin de l’Algérie indépendante, de ses rendez-vous aboutis où trompés. Dib a été absent, pour l’Algérie et pour les Algériens.
Je comprends que des enfants de Tlemcen, mus par l’émotion, rejetant toute évaluation critique, réinterprètent le passé de leur aîné et idéalisent son parcours contre l’épreuve douloureuse des faits, en cherchant à inscrire son nom dans le marbre de la postérité. Mais ils le font contre l’idée de la nation algérienne et des solidarités qui en sont le ciment. Mohammed Dib a brisé cette alliance avec son pays natal et la chaîne de solidarité qui auraient contribué à son élévation dans le souvenir et dans le panthéon de l’Algérie et des Algériens.
Assia Djebar, la « littérature migrante » et l’« écrivain sans frontières »

Il y a bien longtemps, c’était dans les derniers mois du règne des frères Bouteflika, j’interrogeais, face aux dirigeants de l’ANEP et de l’ENAG, deux institutions de l’État algérien, la légitimité d’un prix littéraire Assia Djebar qu’elles ont institué. Comme Mohammed Dib, cette écrivaine n’a pas été traitée par l’Algérie à l’aune de ses engagements publics, relativement à son pays natal. Romancière des années 1950-1960, Assia Djebar, résidant en Algérie à l’indépendance, a publié un quatrième roman « Les Alouettes naïves » (Paris, Julliard, 1967) et un recueil de « Poèmes pour l’Algérie heureuse » (Alger, SNED, 1969). Elle cosigne avec Walid Carn – un pseudonyme ? – « Rouge l’aube » (1969), une adaptation en en langue française d’une pièce de théâtre de l’Irlandais Sean O’Casey avant de s’arrêter d’écrire pendant plus d’une dizaine d’années.
Titulaire d’une maîtrise d’histoire, Assia Djebar a été jusqu’au milieu des années 1970 enseignante et cheffe du département de Lettres françaises de l’Université d’Alger. Elle quitte le pays pour un poste d’aide-bibliothécaire au Centre culturel algérien de Paris, dépendant du ministère des Affaires étrangères, et ne reviendra plus en Algérie pour une résidence fixe. Elle renoue avec l’écriture littéraire en 1980 en publiant « Femmes d’Alger dans leur appartement » (Paris, Des Femmes éditions) et vit de traductions (elle traduit entre autres l’Égyptienne Nawal Saadaoui). Depuis, elle a signé en France, chez des éditeurs parisiens, une œuvre – nombreuse – et il importe peu qu’elle fut parfois à thème algérien.
Après le CCA de Paris, Djebar retourne à l’enseignement à Baton rouge et New York aux États-Unis. Son avenir littéraire n’est plus en Algérie. Elke Richter, une spécialiste allemande de son œuvre la projette dans l’« écriture migrante » à laquelle elle attribue des spécificités esthétiques. Elle précise ce concept : « Réduire le terme ‘‘écriture migrante’’ à la biographie de l’auteur, à ses origines et ses mouvements migratoires, veut aussi dire exclure, c’est-à-dire enfermer des auteurs et leurs textes dans une cage de la littérature mineure ; ‘‘écriture migrante’’ est souvent entendue de façon péjorative par rapport au canon d’une littérature nationale » (7). En vérité, la démarche d’écrivaine d’Assia Djebar, n’a jamais intégré une littérature nationale algérienne, écrite et publiée en Algérie, bloquée au niveau international par la littérature française qui lui a toujours imposé sa domination. Djebar est dans la littérature française et le mouvement de son écriture, comme métaphore, ne s’apprécie qu’à l’intérieur de la littérature française, de la culture française qu’elle revendique (8) vers un au-delà scriptural andalou, arabo-berbère – et, même musulman, « sans la prégnance du religieux ».
L’analyste allemande peut alors établir dans l’expérience de Djebar une dissymétrie topographique et historique : « Or, c’est justement le terme de littérature nationale qui est de plus en plus mis en question. L’appartenance nationale des auteurs ainsi que leur classement dans des littératures nationales devient de plus en plus difficile dans un monde qui se globalise et qui produit des identités transnationales, des auteurs et des textes ‘‘sans résidence fixe’’ » (9). Le lien infime de Djebar avec la littérature nationale est coupé. La faiblesse de la construction socio-historique de la trajectoire de l’écrivaine par la critique allemande réside dans deux indicateurs dont elle n’a pas mesuré la pertinence :
1°) Djebar ne s’est jamais positionnée stricto sensu dont une littérature nationale algérienne, si ce n’est provisoirement dans une période de rupture avec son éditeur historique Julliard, qui l’a fait connaître. L’éditeur national – la SNED – publie l’unique recueil poétique de sa longue carrière littéraire, « Poèmes pour l’Algérie heureuse », mais il n’y aura pas de suite. Comme Dib et d’autres écrivains de sa génération et des générations futures éditées en France, elle a appartenu à la littérature dite « algérienne » dans la périphérie de la littérature française – ou, depuis le Manifeste de 2007, à la « littérature-monde en français ».
2°) Il n’y a pas du vivant de l’écrivaine et jusqu’à nos jours une littérature nationale algérienne forte, suffisamment enracinée et libre de domination étrangère, comme, à titre d’exemple, la littérature nationale égyptienne qui a produit un Prix Nobel de Littérature, Naguib Mahfouz, en 1988. La littérature nationale algérienne, barrée par la France littéraire, reste une littérature mineure dans le concert des nations.
Assia Djebar, séparée de l’Algérie réelle, pouvait admettre doublement un décentrement de sa personne et de son œuvre, de la mobilité de son corps et de ses langues, par rapport à son pays plus que par rapport à la littérature nationale algérienne qui n’existait pas pour elle comme pour les historiens occidentaux des littératures dominées. Son élection à l’Académie française, un démembrement de l’Institut de France, un pilier de l’État français, recouvre tout autant une trame existentielle qu’un horizon d’écrivaine. Elle est allée vers la France littéraire, elle a recherché la France. La candidature à l’Académie française a un caractère individuel et volontaire : il n’y a pas de nomination directe à cette institution. Il n’y a pas aussi d’académicien à titre étranger, tous les membres élus sous la coupole du Quai-Conti sont Français ou naturalisés français ou assimilés Français. C’était, hier, le cas de l’Argentin Hector Biancotti (1930-2012), c’est le cas, aujourd’hui de l’Haïtien Dany Laferrière et, récemment, de l’Hispano-péruvien naturalisé Français Alfredo Varga Losa. Est-ce que Assia Djebar a bénéficié d’un statut d’exceptionnalité pour son admission dans la prestigieuse maison de l’Institut de France ?
Ce mouvement de l’écrivaine, de l’écriture « migrante » vers un positionnement d’académicienne « française », se situe hors de l’Algérie, de sa littérature et de son espace littéraire national. Il faudrait, sans doute être plus explicite. Imaginons que des membres de l’Académie française aient poussé et défendu la candidature à un siège de cette de cette institution du grand écrivain et symbole de la littérature algérienne de langue française Kaddour M’hamsadji, incarnant par son œuvre de création polyphonique et critique la littérature nationale algérienne, expression d’un pays libre et souverain. La France, l’Institut de France et l’Académie française ne sont pas, et n’ont jamais été, dans cette perspective d’ouverture à une égale reconnaissance des littératures de langue française dans le monde. Il leur faut les assimiler (et dénationaliser) et naturaliser leurs auteurs dans un entrain néocolonial.
Assia Djebar, écrivaine et académicienne française assimilée ou naturalisée, a été envers son pays originel et sa littérature dans le malentendu, un malentendu entretenu. Son parcours d’écrivaine « migrante » est déjà un parti-pris doctrinal et sa « littérature migrante » une chaloupe cinglant vers les côtes françaises, une vraie « harga littéraire ». Une démarche appuyée par les coteries littéraire et politique françaises, saluée en France par des écrivains originaires d’Algérie, qui souhaitaient couper définitivement le lien avec le pays originel, même s’il restait souvent leur fond de commerce. Ne faut-il pas souligner la perversion d’une telle théorisation du statut de l’écrivain hors de tout lien national au moment ou Djebar devait préserver solidement son algérianité ? L’universalité d’un écrivain est dans la singularité de son ancrage.
C’est quoi « un écrivain sans résidence fixe » (10), « SRF » sur le modèle de « SDF », concept proposé par l’Allemand Ottmar Ette dont pouvait témoigner le vécu littéraire et social d’Assia Djebar, réinsérée dans la littérature et l’identité françaises ? Retient-on de ce concept une vision très caricaturale, celle de plusieurs écrivains d’origine algérienne devenus Français, le dernier d’entre eux Kamel Daoud, qui ont cassé les frontières de leur pays pour rechercher celles – supposées plus hospitalières – de la France et de l’Europe. Ces écrivains « sans frontières » n’en finissent pas d’être confrontés à leur reniement.
Conséquence horrible et déplorable de l’expérience d’écrivaine de Djebar et de ses effets mortifères en Algérie : dorénavant, le moindre des jeunes romanciers d’Algérie, hurlant et bavassant, épigone de Kamel Daoud et de Boualem Sansal, répugnerait à se proclamer fièrement Algérien. Il préférerait plutôt ne pas trop s’engager en espérant que s’ouvrent à lui les portes de la France, lorsqu’il ne précipiterait pas le mouvement en s’y installant avec l’objectif précis de « casser les frontières » de ses origines en se naturalisant. Et de soutenir à l’instar du Français Abdelkader Djemaï qu’un écrivain n’a pas de frontières. C’est cette écrivaine que l’Algérie, dont l’espace littéraire national n’a jamais été aussi fragile et compromis, a honoré par un prix littéraire à son nom. Le mérite-t-elle ?
De l’intégrité morale et politique des écrivains et de leur immunité sociopolitique
Je ne crois pas que les écrivains se prêtent à des actes qui soient au-delà de leurs intentions : célébrer la colonisation française et un modèle de peuplement colonial dans un roman (Chitour Daoudi), faire le choix d’un pays (Dib), défendre la déterritorialisation du statut de l’écrivain (Djebar), renvoient à une responsabilité dont il est difficile de les exonérer. L’écrivain ne peut avoir quels que soient son talent et son œuvre une position éminente dans la société qui le déresponsabiliserait.
Malheureusement, l’Algérie est oublieuse. Ou elle n’est pas informée – ou mal informée, ce qui suppose l’inanité de ses élites universitaires. Mohammed Dib comme Assia Djebar, mais aussi bien d’autres, ont pu grandir loin d’elle et contre elle. Répétons-le : personne ne peut leur reprocher l’élection d’un pays et d’une littérature lorsqu’elle est faite dans la clarté. En d’autres termes, on ne peut prendre, en même temps, le meilleur de l’Algérie et de la France. Mais, l’Algérie s’est accoutumée depuis bien longtemps à distinguer des personnalités littéraires françaises d’origine algérienne ou algériennes, même lorsqu’il est avéré qu’elles l’ont trompée et trahie – ou suprême affront, ignorée. Ni Dib ni Djebar n’ont levé, de leur vivant, l’ambigüité sur leur parcours exclusifs dans la littérature française. Appellent-ils vraiment la reconnaissance éternelle de l’Algérie et des Algériens ?
Les Prix littéraires, en Algérie, ne se résoudraient-ils qu’à incarner par leurs noms des choix antinationaux ? Et à récompenser présentement une œuvre antinationale. À son niveau de romancière débutante, Chitour Daoudi, sans douter de l’incongruité de son message atypique, promeut publiquement dans les librairies et dans les journaux d’Algérie un récit réhabilitant le peuplement et la politique de peuplement de l’Algérie coloniale française et avance le projet d’en écrire une suite tout autant tortueuse, face au silence – ou à la complicité – des Algériens.
C’est ma responsabilité de critique et d’historien de la littérature de poser ces questions sur l’intégrité politique et morale des écrivains et sur des positions qu’ils ont assumées, qui entachent la sérénité d’une nation et de son histoire littéraire et culturelle. Il est urgent que des édiles politiques apprennent à prendre leur responsabilité devant des faits attestés, je pense, relativement au scandale politico-littéraire de « La Kafrado », aux membres du gouvernement, à MM. les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au premier plan, des Moudjahidine, à Mme la ministre de la Culture et aux dirigeants de l’ONM ; et, s’agissant des Prix littéraires Mohammed Dib et Assia Djebar, aux gouvernants de l’État, aux dirigeants des entreprises ANEP et ENAG, à Mme la ministre de la Culture. Ils se taisent, car il est vrai dans notre société qu’un livre et un engagement d’écrivain (pour ou contre son pays) valent moins qu’un bidon d’huile ou un sachet de lait, même s’ils agissent plus profondément, en Algérie même et à l’étranger, sur la culture perçue de la nation algérienne.
Ce silence pesant, lorsque le pays est offensé dans sa littérature et par sa littérature, est imputable aux responsables algériens à quelque niveau de l’échelle de direction où ils exercent. Honorer par des prix littéraires nationaux à leurs noms des écrivains qui ont été dans l’ambigüité relativement à l’Algérie, couronner une œuvre littéraire de propagande colonialiste française, sont des flétrissures de la mémoire algérienne. De ce strict point de vue, mon interpellation de M. l’ambassadeur d’Algérie en France et des hautes autorités du gouvernement et de l’ONM dans ce débat politico-littéraire reste anecdotique. Partout dans la communauté littéraire mondiale, rêvée autrefois par l’Allemand Goethe, seuls les actes des écrivains dans leur pays, face à leurs lecteurs, c’est valable précisément pour Mohammed Dib et Assia Djebar, comptent pour solder une carrière ou une vie. Comment, là-dessus, ne pas s’en remettre à l’opinion publique algérienne lorsque l’État et ses représentants les plus qualifiés ont abdiqué leurs responsabilités morales ?
Notes:
- Cf. mon compte-rendu : « La Kafrado », de Malika Chitour Daoudi. Une apologie de la ‘‘colonisation heureuse’’ primée par l’Université », Algérie 54, 16 janvier 2022.
- Nacima Chabani, « Malika Chitour Daoudi présente son premier roman à la librairie L’Arbre à dires. La conquête de l’eldorado de deux femmes », « Le Quotidien indépendant », 18 janvier 2022.
- Le seul « Quotidien indépendant » a consacré, au printemps 2021, une dizaine d’articles (comptes-rendus et entretiens) an marge de la sortie du roman colonial de Malika Chitour Daoudi édité à Alger par Casbah Éditions.
- Abdellali Merdaci, « Mohammed Dib et l’Algérie (I). Dérobades, abandons et désertions à l’aube », Algérie 54, 16 octobre 2021.
- Abdellali Merdaci, « Mohammed Dib et l’Algérie (II). De l’algérianité à la francité de l’écrivain, un point d’histoire irrésolu », Algérie 54, 22 octobre 2021.
- Id.
- Cf. Elke Richter, « ‘‘L’écriture s’envolera par le patio’’ – Écriture et femmes maghrébines en mouvement », dans Anna Proto et Paola Ranzini, « Paroles d’écrivains : écritures de la migration », Paris, L’Harmattan, 2014.
- Assia Djebar, « Ces voix qui m’assiègent. En marge de ma francophonie », Paris, Albin Michel, 1999.
- Elke Richter, art. cité.
- Cf. « Zwischen Welten Schreiben. Litteraturen ohne festen Wohnsitz », Berlin, Kulturverlag Kadmos, 2005. Cité par Elke Richter.
PS | L’ouverture des archives judiciaires de la Guerre d’Algérie et l’interdiction de séjour prononcée contre Mohammed Dib. À une date indéterminée de l’année 1959, probablement après la publication par Seuil de son quatrième roman « Un Été africain », Mohammed Dib est interdit de séjour en Algérie à la demande du gouvernement général. Outre le fait qu’il s’est fait connaître, principalement en France, comme écrivain, Dib exerçait la fonction de comptable dans une société privée, menant une vie petite-bourgeoise sans attache politique pour constituer un danger pour l’ordre colonial. Les raisons de son exclusion d’Algérie ne sont pas connues et n’ont été commentées ni par ses proches ni par les historiens de la littérature algérienne, français et algériens.
Il sera, désormais, possible de retrouver l’ordonnance judiciaire qui a interdit Dib de séjour en Algérie, si elle existe, si elle est accessible, et de connaître le motif de cette inexpliquée sortie d’Algérie de l’écrivain. Annoncée, le 10 décembre 2021, par Mme Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, l’ouverture des archives judiciaires de la Guerre d’Algérie décidée par le président Macron devrait apporter des éclaircissements sur l’interdiction de séjour en Algérie de Mohammed Dib, un aspect important dans l’histoire de la littérature algérienne de langue française dans l’Algérie coloniale. Cette promesse sera-t-elle tenue ?