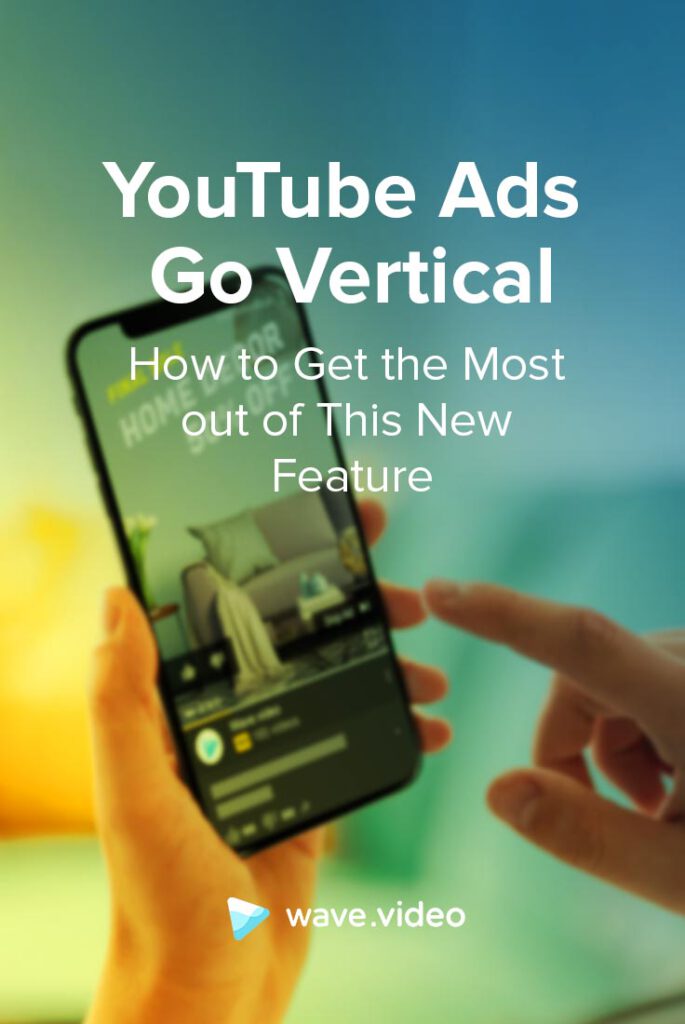Par Abdellali Merdaci
Mouloud Feraoun va être honoré lors du XXVe SILA comme un « martyr de la Révolution algérienne ». Cette sentencieuse qualification lui est prêtée, depuis bien longtemps, et nettement agie par les instances de tous les gouvernements de l’Algérie indépendante pour être inscrite durablement dans le marbre. Et devenir une indéracinable « idée reçue ». Qui en a décidé et à quel moment de l’histoire tempétueuse de la jeune nation algérienne ?
Il faut revenir clairement sur les circonstances dans lesquelles était assassiné l’écrivain kabyle par le commando Delta du lieutenant Roger Degueldre, une unité de l’Organisation de l’Armée secrète (OAS), milice d’Européens combattant sur deux fronts : contre les Algériens, le FLN-ALN et le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), d’une part (1), et contre la République française du général de Gaulle, au nom de l’Algérie française.
Si l’OAS s’est le plus souvent attaquée à des Algériens isolés, rarement à des personnes ciblées, ou aux réseaux urbains de l’ALN-FLN, elle entre, assez vite, dans ce que l’historien Rémi Kaufer nomme « la guerre franco-française d’Algérie » (2), visant explicitement la République française, son armée et ses institutions.
Les faits
Le 15 mars 1962, à 10 heures du matin, un commando de l’OAS fait irruption dans les bureaux des Centres sociaux éducatifs à Château-Royal (El Biar, Alger). Parmi les inspecteurs des CSE, en réunion de travail, ils appellent sept noms (dont un était absent) et les exécutent immédiatement : Max Marchand, Robert Eymard, Salah Henri Ould Aoudia, Mouloud Feraoun, Marcel Basset, Ali Hammoutene, tombaient sous les balles du commando Delta de l’OAS, qui a revendiqué publiquement cette tuerie. Le lieutenant Degueldre, ancien volontaire de la légion SS Wallonie, chef du commando, auteur de plusieurs crimes de sang, reconnu par un témoin des faits, a été arrêté à Alger, le 7 avril 1962, déféré devant un tribunal militaire au Fort de Vincennes, au mois de juin 1962, condamné à mort et exécuté le 6 juillet 1962.
Le 15 mars 1962, ce n’était pas l’écrivain qui était assassiné par l’OAS, mais l’inspecteur des Centres sociaux éducatifs Mouloud Feraoun.
– Les Centres sociaux éducatifs
Depuis l’Appel du 1er-Novembre 1954, l’Algérie entre en guerre contre l’État français et ses démembrements coloniaux en Algérie avec l’objectif d’obtenir la libération totale de son territoire et la fin de l’occupation coloniale française. La France et son gouvernement colonial en Algérie ont mobilisé d’énormes moyens humains – jusqu’à deux millions de soldats mobilisés, au plus fort de la guerre – et matériels, utilisant contre les combattants algériens et contre le peuple algérien la torture et des armes chimiques, comme le napalm, proscrits par les conventions internationales sur la guerre. Mais l’État français a également recouru à des initiatives « douces », moins marquées militairement, comme celle des SAS, prodiguant des premiers secours aux populations démunies, le plus souvent transplantées dans des périmètres de non-droit. Sur proposition de l’ethnologue Germaine Tillon (3), le gouverneur général de l’Algérie Jacques Soustelle (1955-1962) crée, dans cet état d’esprit, les Centres sociaux par un décret du 27 octobre 1955. Voici le texte dudit décret, qui précise les missions des Centres sociaux, développés plus tard, en Centre sociaux éducatifs :
« Article 1 – Il est créé, au sein de la direction générale de l’Éducation Nationale en Algérie, un ‘‘service des Centres Sociaux’’. Ce service a pour mission de créer et d’animer des Centres sociaux, urbains et ruraux.
« Le Centre social a pour but :
– de donner une éducation de base aux éléments masculins et féminins de la population qui n’ont pas bénéficié ou ne bénéficient pas de la scolarisation et de mettre à la disposition de ces populations des cadres spécialisés dans les différentes techniques de l’éducation et spécialement de l’éducation agricole ;
– de mettre à la disposition de ces populations un service d’assistance médico-social polyvalent […] ;
– et, d’une manière générale, de susciter, de coordonner et de soutenir toutes initiatives susceptibles d’assurer le progrès économique, social et culturel de son ressort » (4)
Les CSE étaient dans leur principe un outil technico-administratif de prise en charge de populations indigènes isolées et déshéritées et dans leur philosophie un adjuvant de l’action de l’État colonial français dans sa guerre au FLN-ALN. Il ne devrait y avoir aucun doute : les CSE faisaient partie des services de l’État colonial français et devaient contribuer à garder l’Algérie à la France. Leur rôle essentiel était de soustraire des catégories de la population algérienne, les plus fragiles, à l’emprise du FLN dans les zones urbaines et de l’ALN dans les zones rurales. Sur le plan de la gestion de leurs ressources financières et humaines, de leurs personnels d’encadrement et d’exécution, les Centres sociaux éducatifs étaient placés sous l’autorité du gouvernement général de l’Algérie et à un niveau supérieur de la République française.
– À quelle autorité s’adressaient les inspecteurs des CSE ?
Il convient de préciser par un exemple sans fioriture le caractère purement français et colonial des CSE. Dans l’ouvrage de Jean-Philippe Ould Aoudia, fils de Salah Henri Ould Aoudia, président de l’Association « Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et leurs compagnons », sur « L’Assassinat de Château-Royal » (5), je retire cette information :
« En février 1962, lors d’un stage à Marly-le-Roi, Mouloud Feraoun, Ali Hammoutene, Salah Ould Aoudia rencontrèrent, avec d’autres stagiaires des CSE, le conseiller du général de Gaulle pour les Affaires algériennes. Ils lui firent part de leurs inquiétudes sur la situation en Algérie, surtout dans les grandes villes. Bernard Tricot, qui n’ignorait pas le danger auquel ces fonctionnaires étaient exposés, leur demanda de regagner leur poste afin ‘‘de travailler coûte que coûte pour empêcher l’OAS d’établir le chaos’’ » (6).
En ce mois de février 1962, la présidence de la République française n’ignorait pas les menaces que subissaient les inspecteurs des CSE, notamment de miliciens de l’OAS, et le gouvernement général de l’Algérie savait leur lassitude et leur découragement. Ainsi, l’inspecteur des CSE Mouloud Feraoun avait présenté sa démission, qui a été refusée (7). Avec ses collègues, les inspecteurs des CSE Hammoutene et Ould Aoudia, ils auraient pu, face à l’intransigeance de Bernard Tricot, conseiller aux « affaires algériennes » du général de Gaulle, prendre la clé des champs : rejoindre à Tunis le GPRA… En fonctionnaires disciplinés, ils ont préféré répondre à l’injonction du conseiller élyséen pour « regagner leur poste » et exposer leur corps aux balles de l’OAS. En matière de « chaos » de l’OAS, c’est eux et leurs collègues européens qui en faisaient les frais.
Il est ainsi acté le lien direct entre les animateurs des CSE et le plus haut niveau de l’État français, le cabinet du général de Gaulle, président de la République, en la personne de son conseiller pour les Affaires algériennes, Bernard Tricot. Il est aussi indiscutable que les CSE et leurs cadres français, européens et indigènes, étaient dans une situation d’adversité tendue avec l’OAS dont il fallait combattre les nuisances, « empêcher l’OAS d’établir le chaos ». Les inspecteurs des CSE se savaient menacés et Max Marchand avait déclaré à un proche qu’il n’allait pas parvenir au mois de juin pour espérer une mutation en France. Paroles prémonitoires. C’est donc bien dans une institution de l’État colonial français que tombait l’inspecteur des CSE Feraoun, comme ses collègues, en « service commandé », pour la France.
Pour qu’il n’y ait pas d’équivoque en matière de tutelle, il faut bien mettre en évidence que les inspecteurs des CSE Feraoun, Hammoutene et Ould Aoudia ont été chercher, au mois de février 1962, des instructions auprès de l’Élysée, sommet du pouvoir en France, mais à aucun moment auprès de le la direction de la Zone autonome d’Alger (ZAA), représentante du FLN-ALN et du GPRA. Ils n’avaient aucun lien organique avec la Révolution algérienne et son combat libérateur pour en attendre des contre-instructions.
Feraoun, Hammoutene et Ould Aoudia, comme Max Marchand, Robert Eymard, Marcel Basset, ont accepté d’être les soldats loyaux de la République française et de son gouvernement colonial afin « de travailler coûte que coûte pour empêcher l’OAS d’établir le chaos ». Les inspecteurs des CSE ont accepté de continuer leur mission, qu’ils savaient risquée, sans aucune protection armée. Ils ont été proprement envoyés au casse-pipe par le conseiller Bernard Tricot et, derrière lui, le général de Gaulle.
Max Marchand, Robert Eymard, Salah Henri Ould Aoudia, Mouloud Feraoun, Marcel Basset, Ali Hammoutene, sont morts pour la France. LEUR MARTYR APPARTIENT À LA FRANCE ET AU GOUVERNEMENT DE LA FRANCE AUXQUELS ILS SONT RESTÉS FIDÈLES ET LOYAUX JUSQU’À LEUR MORT.
Le 26 janvier 2022, le président Macron déclarait officiellement au nom de l’État français que la fusillade du 26 mars 1962, rue d’Isly à Alger, déclenchée par des militaires français, faisant cinquante morts et plusieurs dizaines de blessés parmi la population européenne, impliquait la seule responsabilité de la République française. Relativement au tragique événement de Château-Royal, le 15 mars 1962, M. Macron s’est contenté de faire déposer par M. François Gouyette, ambassadeur de France, une gerbe de fleurs rappelant la mémoire des inspecteurs des Centres sociaux-éducatifs d’Alger Max Marchand, Robert Eymard, Salah Henri Ould Aoudia, Mouloud Feraoun, Marcel Basset, Ali Hammoutene. Il est vrai que, s’agissant de la fusillade du 26 mars 1962, le président-candidat a cédé aux pressions des « cercles algérianistes », des nostalgiques de l’Algérie française, qui n’allaient pas dénoncer le crime de l’OAS du 15 mars 1962, qui guerroyaient, à cette période, à ses côtés contre la « Grande Zohra » – sobriquet donné au général de Gaulle par les ultras – et la République française négociant l’avenir de la présence française en Algérie avec les émissaires du GPRA.
Feraoun, une reconnaissance officielle, après tant d’autres, de l’Algérie nouvelle ?
Les Algériens ont-ils été conditionnés de longues décennies pour dissocier l’inspecteur des CSE, assassiné par l’OAS, dans l’exercice de ses fonctions auprès de cette institution de l’État colonial français, et l’écrivain. Si l’OAS avait spécialement ciblé l’écrivain Mouloud Feraoun, publié par une grande maison d’édition germanopratine, elle aurait pu le faire en d’autres circonstances. Elle avait à son actif le meurtre de plusieurs Français connus pour leur proximité avec le combat des Algériens pour leur libération du joug colonial, comme l’avocat Maître Pierre Popie, mitraillé dans une rue d’Alger, le 25 janvier 1961 – ou encore des soutiens du général de Gaulle, civils ou militaires légitimistes. Dans le compte-rendu d’Algérie presse service (APS) de la cérémonie du 15 mars 2022, à Château-Royal, en présence du ministre des Moudjahidine et des ayants droit Laïd Rebiga et de l’ambassadeur de France François Gouyette, il est utilement indiqué : « À cette occasion, Rebiga a souligné que ce recueillement est ‘‘une reconnaissance envers l’un des célèbres auteurs algériens, Mouloud Feraoun, tombé, en compagnie de cinq autres enseignants, sous les balles assassines de la sinistre OAS’’ » (8).
Le ministre Laïd Rebiga désigne les compagnons de Feraoun dans une formulation vague : « cinq autres enseignants », sans spécifier leur caractéristique d’inspecteurs des Centres socuayx éducatifs, alors que sur cet aspect les propos de l’ambassadeur François Gouyette, rapportés par l’APS, sont tout autant équivoques : « C’était la volonté du président Macron que je puisse déposer, en son nom, une gerbe de fleurs à la mémoire de ces six enseignants assassinés, le 15 mars 1962, à quelques jours du cessez-le feu et de la signature des accords d’Évian » (9) ». Est-ce que le ministre, représentant du gouvernement algérien, et l’ambassadeur de France, mandaté par le président de la République française, se sont entendus pour ne pas citer dans cette commémoration, qui réunit pour la première fois officiels algériens et français, les Centres sociaux éducatifs, institution du gouvernement général de la colonie ?
L’Algérie officielle occulte volontairement le fait que le crime de l’OAS a visé les Centres sociaux éducatifs et leurs inspecteurs – dont Feraoun. Les Algériens pensent et admettent que le nom Mouloud Feraoun au fronton de leurs écoles, dans plusieurs villes du pays, dès le lendemain de l’Indépendance, est celui de l’écrivain du Seuil, Grand Prix de la Littérature de la Ville d’Alger, en 1951, Prix populiste, en 1953. Ce qu’ils ignorent, c’est que dans le pays libéré, déserté par ses cadres français, ce sont les instituteurs de Bouzaréa qui ont pris les commandes du ministère de l’Éducation nationale. Ils ont honoré, sans délai, leur collègue, l’instituteur du bled et inspecteur des Centres sociaux éducatifs, Mouloud Feraoun, davantage que l’écrivain. Comme ils l’ont fait dans la semblable mesure pour leur collègue, l’instituteur et inspecteur des CSE Ali Hammoutene, principalement en Kabylie. Plus tard, beaucoup plus tard, les noms d’établissements scolaires, de rues et de quartiers ont été dévolus à des commissions de moudjahidine et, parfois, au plus haut niveau de l’État lorsqu’il s’est agi d’honorer un pays ami ou un militant étranger de la guerre anticoloniale algérienne.
Le ministre évite l’instituteur et inspecteur des CSE pour mettre en évidence l’écrivain, le célèbre écrivain Feraoun ? Est-ce que M. Rebiga connaît et a lu cet écrivain pour en proclamer la reconnaissance officielle par le gouvernement de l’Algérie nouvelle ? Ou, le cas échéant, a-t-il été missionné pour le faire ? Je ne doute pas que l’ambassadeur Gouyette connaisse, à défaut de l’œuvre intégrale de Mouloud Feraoun, son parcours dans l’Algérie coloniale. Mais le ministre Rebiga en charge des Moudjahidine et ayants droit ?
Voici à son intention, ce qu’écrivait Feraoun, non sans conviction, après la capture en rase campagne kabyle de son collègue l’instituteur Dupuy par des djounoud (pl. de « djoundi », soldat) de l’ALN :
« Les journaux parlent en gros titre de mon collègue Dupuy enlevé jeudi. Ses deux adjoints ont pour ainsi dire été relâchés, mais lui est emmené par les rebelles. Il a dit à l’un de ses adjoints : ‘‘C’est moi qu’ils veulent.’’ Qu’a-t-il fait le malheureux ? Jusqu’ici les patrouilles sont restées impuissantes. Arrêter des suspects (?). Évidemment » (« Journal, 1955-1962 », Paris, Seuil, 1962, p. 57).
Que fait la maréchaussée ! Feraoun s’inquiétait de la célérité des « patrouilles » françaises, « impuissantes » face à ceux qu’il nommait les « rebelles ». Faudrait-il aligner d’autres exemples de la même encre putride ? Voilà donc pour l’édification de l’honorable membre du gouvernement le « célèbre » Feraoun, à qui tout serait consenti sans examen. Ses « rebelles », ce sont nos glorieux chouhada et nos moudjahidine dont nous devons défendre la mémoire, parce qu’ils ont donné leur dignité aux Algériens et élevé leur pays dans le rang des nations libres, dont M. Rebiga a la charge – avant le signataire de ces lignes et tous les Algériens.
Je ne vais pas polémiquer avec un membre du gouvernement (qui n’est pas payé pour être un spécialiste de la littérature algérienne) sur un écrivain dont il n’a possiblement pas lu les notes, souvent troublantes, sur la Guerre d’Algérie, dont il méconnait certainement le parcours politique dans les années 1950. C’est Feraoun qui déclarait dans le feu de la guerre coloniale : « La communauté franco-arabe, nous l’avons formée, il y a un quart de siècle, nous autres, à Bouzaréa » (10). Cet horizon politique, il s’y est tenu jusqu’à sa mort dans une institution de la France coloniale. J’ai fait mon travail d’historien de la littérature algérienne et de critique littéraire en disant dans plusieurs contributions parues dans la presse nationale, depuis bien longtemps, qui était Mouloud Feraoun dans un « entre-deux » préjudiciable, qui n’a jamais pris une position sans ambigüité sur l’avenir de l’Algérie sous le joug colonial pour justifier l’hommage officiel de l’État algérien. Je rappelle, qu’après les déclarations d’Ali Feraoun revendiquant pour son père les titres de militant du FLN et de combattant de l’ALN, j’avais interpellé MM. le ministre des Moudjahidine et ayants droit et le secrétaire général de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), en poste au printemps 2021. Ni l’un ni l’autre n’avaient daigné répondre.
Or, le 15 mars 2022, le ministre des Moudjahidine et ayants droit Rebiga a prononcé officiellement la reconnaissance solennelle par son gouvernement de l’écrivain kabyle. Devrais-je considérer que c’est une réponse – même tardive – à ma requête du printemps 2021 ? Je lui demande en conséquence, en prenant à témoin l’opinion publique nationale, de dire sur quelle documentation historique vérifiable par tous les Algériens, il a déclaré la reconnaissance de Mouloud Feraoun. Il a l’obligation morale, s’il en a eu la connaissance et la possession, de publier les pièces de l’ALN confirmant l’affiliation de l’écrivain et élu colonial de Fort National (Larbaa Nath Irathen) dans les rangs de l’Algérie combattante.
Si les informations diffusées par Ali Feraoun, depuis maintenant dix années (2012-2022), sur l’appartenance de son père à l’ALN (11), dans la proximité de Saïd Mohammedi, adjoint du colonel Amirouche puis chef de la Wilaya III (Grande Kabylie), sont confirmées au plus haut niveau de l’État, par un ministre de la RADP, il faudra réécrire sur cette base toute l’histoire de la littérature algérienne de langue française des années 1950-1962. Mais jusqu’à preuve du contraire, Mouloud Feraoun, mort dans une institution de l’Algérie coloniale française, ne peut être considéré comme un martyr de la Guerre d’Indépendance. Parlez-donc, M. le ministre ! L’Algérie a besoin plus que jamais de clarté relativement à son histoire politique et littéraire (12).
Notes
- Un accord a été ébauché entre le FLN et l’OAS avant le référendum du 1er juillet 1962. L’historien Abdelmadjid Merdaci écrit à ce propos : « Le 17 juin 1962, le Dr Chawki Mostefaï, responsable du groupe FLN au sein de l’Exécutif provisoire, faisait état, dans une déclaration diffusée par la station locale France V, d’un accord intervenu entre le FLN et l’OAS. Prenant de court les observateurs et une partie des acteurs du conflit, cet accord, confirmé dans la soirée par Jean-Jacques Susini, dirigeant politique de l’OAS, dans une émission radio pirate, mettait formellement fin aux derniers soubresauts de la guerre. Les premiers contacts, facilités par des anciens élus proches de Abderrahmane Farès, président de l’Exécutif provisoire, ont lieu début mai dans une ferme de l’Alma, dans la banlieue d’Alger. C’est Susini qui sollicite la rencontre avec des dirigeants du FLN et il y est conduit par l’évolution des rapports sur le terrain marqué en particulier par les arrestations des principales figures de l’OAS. Farès et Susini conviennent de consulter et se revoir et l’opération, conduite dans le secret, prend une dimension plus importante avec sa prise en charge par Chawki Mostefaï au nom du FLN. Alors que Susini, qui ordonne une trêve en signe de bonne volonté, négocie le statut et les droits des Européens dans une République algérienne dont n’était plus contestée la légitimité, Farès et Mostefaï se déplacent à Tunis pour tenter d’obtenir l’aval du GPRA à leur démarche. Ils font le constat des tensions au sein de la direction du Front et doivent se contenter d’un ‘‘faites pour le mieux’’ du président Benyoussef Benkhedda » (Cf. « Cinquante clés pour le Cinquantenaire », Constantine, Les Éditions du Champ libre, 2013, p. 112). L’historien relève que « L’Accord FLN/OAS, toujours occulté dans le récit national, aura marqué la fin effective de la guerre d’indépendance et la reconnaissance formelle de la fin de l’Algérie française par ses plus virulents défenseurs » (Id., p. 113).
- Rémi Kaufer, « OAS : la guerre franco-française d’Algérie », dans Mohammed Harbi et Benjamin Stora [éd.], « La Guerre d’Algérie. 1954-1962. Vol. 2. La fin de l’amnésie, Alger, Chihab Éditions, pp. 113-138.
- Jacques Soustelle, anthropologue, et Germaine Tillon ont été pendant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation nazie de la France des résistants, membres du réseau du Musée de l’Homme, à Paris. Dans les derniers mois de la Guerre d’Algérie, Soustelle devient un farouche défenseur de l’Algérie française, opposant au général de Gaulle.
- Cf. Serge Jouin et alii, « L’École en Algérie : 1830-1962. De la Régence aux Centres sociaux éducatifs, Paris, Publisud, 2001, p. 78. Ouvrage publié sous les auspices de l’Association « Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons » et préfacé par Nourredine Saadi).
- Cf. « L’Assassinat de Château-Royal », Paris, Éditions Tirésias, 1992.
- Id. p. 84.
- Le 8 avril 1961, Feraoun fait part de sa désaffection envers les CSE dans une lettre à son ami et éditeur au Seuil Emmanuel Roblès : « Aux centres sociaux, je fais un travail assommant dont je me fiche éperdument et qui n’intéressera jamais personne ». Cf. « Lettres à ses amis », Paris, Seuil, p. 163.
- Dépêche de l’APS, datée du 15 mars 2022, reprise dans plusieurs quotidiens nationaux et régionaux.
- Id.
- Cf. « Images algériennes d’Emmanuel Roblès », « Simoun » (Alger), n° 30, décembre 1959, repris dans « L’Anniversaire », Paris, Seuil, 1968, p. 59. La France a récupéré l’écrivain Feraoun, « ami de la France ». En 2020, à l’initiative du président Macron, la présidence de la République française a constitué plusieurs listes de personnalités de différents domaines d’activités – « proches de la France » – proposées aux municipalités françaises pour rebaptiser des noms de rues et de places. À Villetaneuse, tout près de l’Université Paris-Nord, deux rues en angle portent les noms de Mohammed Dib et Kateb Yacine. Une affaire française.
- Cf. l’information donnée par Ali Feraoun à la journaliste du « Quotidien indépendant » Nassima Oulebsir : « On reprochait à mon père de ne pas s’être engagé dans la Révolution. Or, aujourd’hui, je détiens la preuve qu’il était membre de l’ALN » (« Le Quotidien indépendant », supplément du week end, 16 mars 2012). J’attends, depuis maintenant dix années, d’accéder à ces preuves. Pourquoi Ali Feraoun, s’il possède vraiment des preuves sur l’engagement militaire de son père dans l’Algérie combattante, le maintient-il volontairement dans l’ambigüité ?
- J’ai alerté ces dernières semaines (voir le fil culturel d’« Algérie 54 ») l’actuel ministre des Moudjahidine et ayants droit, le secrétaire général de l’ONM et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur un roman de propagande coloniale, « La Kafrado », écrit par une Algérienne, primé par une institution officielle de l’État, l’Université Constantine 1-Mentouri. Sans suite. Cette consécration officielle n’a pas été discutée par les défenseurs de la mémoire nationale et ce roman – primé – poursuit sa petite carrière dans les stands du SILA offerts par le président Tebboune aux éditeurs algériens.