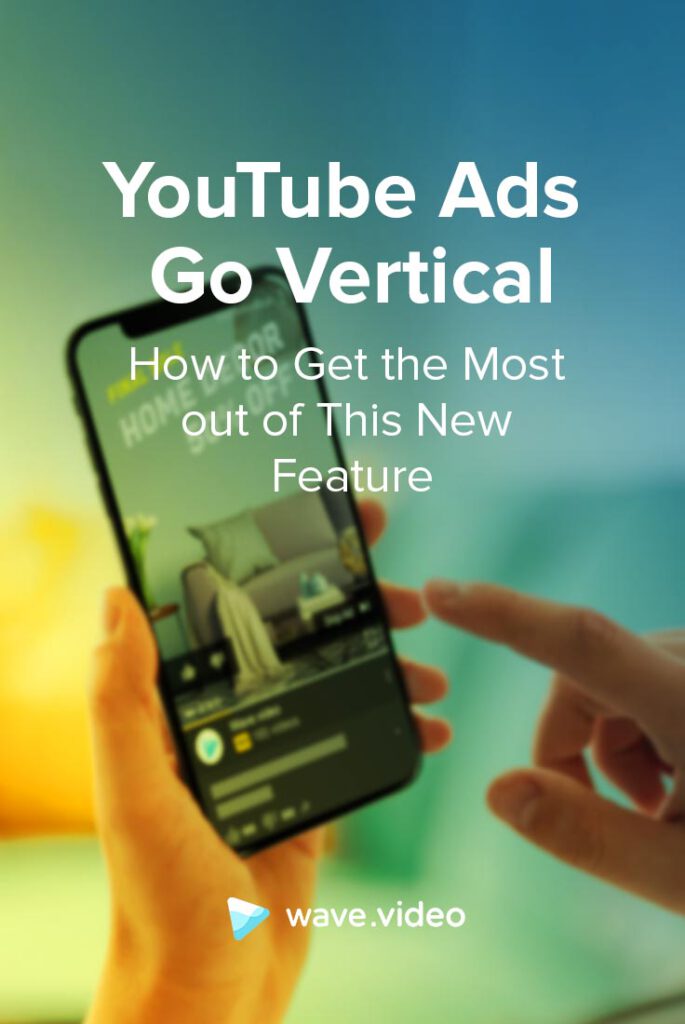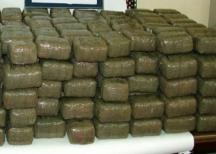Par Abdellali Merdaci.
Dans un entretien avec le quotidien de l’industriel Issad Rabrab (23 mai 2021), l’écrivain Boualem Sansal martèle ses vérités du moment, très circonscrites – on y reviendra. Dans son actualité, il y a une nouvelle consécration littéraire française pour son dernier roman dont il parle si peu, choisissant de se gargariser d’un succès annoncé. L’essentiel de l’entretien porte sur la lecture qu’il fait de sa présence en Algérie, de la réception contrariée de son parcours, de l’Islam et de l’islamisme, du hirak et de la ‘issaba. La probité intellectuelle aurait exigé plus de clarté et de sincérité sur ses engagements, principalement politiques, inséparables de la conduite de sa carrière d’écrivain, notamment son soutien à Israël et au sionisme international. Comment répondre à ce qui s’apparente ouvertement à de la mauvaise foi ? Je reviens, ici, sur quelques aspects de l’itinéraire d’écrivain de Boualem Sansal indiscutablement étayés.
Une carrière littéraire française


Hormis quelques rares incursions dans la presse algérienne bobo (où il est accueilli par Hassan Ouali, présentement directeur du quotidien de M. Rabrab, après un long passage au « Quotidien indépendant »), Sansal ne s’adresse pas aux Algériens. En vingt-deux années de carrière littéraire, au mieux une demi-douzaine d’entretiens dans une presse acquise – sinon dévote. Et, il n’écrit pas spécialement pour les Algériens. Dès son premier roman « Le Serment des barbares », en 1999, il fait le choix résolu d’une carrière française dans l’écurie Gallimard. Retenons qu’il a l’entière liberté d’être dans une perspective d’écrivain français, pur produit, au sens marchand du terme, de la maison Gallimard, pour autant qu’il soit sans ambigüité dans ses rapports avec son pays et sa littérature. Il n’y a pas d’écrivain français et algérien, en même temps, la littérature n’admet qu’une seule appartenance nationale. Le grand écrivain juif new-yorkais Philip Roth (1933-2018) n’a jamais agréé, malgré de pressantes pressions, d’être un écrivain israélien ; c’est aussi le cas d’Isaac Bashevis Singer (1904-1991, Prix Nobel de Littérature, 1978), foncièrement américains. Cette indispensable rigueur dans ses options d’écrivain, Sansal ne peut s’en prévaloir. Lorsqu’il évoque une affiliation à la littérature algérienne, il s’agit bien de cette pseudo-littérature algérienne périphérique de la littérature française conçue par des Français d’origine algérienne et des Algériens nationaux, perpétuant la geste malsaine des harkas d’antan, qui n’a absolument aucun lien avec la littérature des Algériens, spécialement écrite par des Algériens pour des Algériens et éditée en Algérie.
Sansal, existe-t-il concrètement en Algérie et pour les Algériens ? S’il lui est arrivé de signer des pétitions – strictement parisiennes – et de « taper » immanquablement et férocement sur les pouvoirs d’Alger lors de bruyantes campagnes de promotion de ses ouvrages en France, il n’a jamais participé, en tant qu’écrivain ou citoyen, à une action politique publique à Alger ou sur le territoire algérien. Hors de l’Université, des médias et de quelques libraires, il reste un parfait inconnu pour la grande masse des Algériens. Cependant, il a patiemment construit sa célébrité par le buzz, principalement en France où il s’affiche en bon client des gazettes, coutumier des bars et cantines de journalistes. Non seulement, il est peu introduit dans le lectorat algérien, il serait difficile de découvrir un seul éditeur national qui en ait publié une seule ligne.

Boualem Sansal ignore les manifestations littéraires en Algérie, et il a boudé le Salon international du Livre d’Alger où il était constamment invité, où ses ouvrages, accessibles dans toutes les librairies d’Algérie, étaient exposés. Mais, il ne dédaigne pas les plus petites foires de livres de bourgs français. Dans de nombreuses courses dans le monde, et récemment en compagnie de Kamel Daoud, à Lillehammer, en Norvège, il défend dans des rencontres littéraires la littérature française à laquelle il s’assimile volontiers. Sansal se félicite d’une récente tournée littéraire dans la lointaine Chine et j’aurais raison de m’en attrister. Dans le domaine de la littérature, et notamment de l’affirmation de la littérature nationale algérienne, la Chine n’est pas, comme en politique, un pays ami de l’Algérie. Lorsqu’elle invite Sansal pour parler spécialement de Camus, écrivain colonial, c’est un représentant de cette « littérature Taïwan », créée et soutenue par la France, contre les intérêts de l’Algérie et de la littérature nationale algérienne, qu’elle reçoit et qu’elle honore. La Chine, comme de nombreux pays amis de l’Algérie, ne sait pas ce qu’elle fait.
Après, il faudra bien poser la question du lien purement matériel de Sansal avec l’Algérie. Il résiderait, d’après ses propres indications, par nécessité (entre autres fiscale), dans un bunker cerné de barbelés à Boumerdès. Et de sa fragile identité nationale. Je me souviens d’un entretien qu’il a donné à l’écrivain Christophe Ono-dit-Bio, journaliste au magazine parisien « Le Point », dans lequel il déclarait qu’il était en attente d’une nationalité française octroyée. C’était, en 2015, en marge de l’édition de son affreux opus islamophobe, « 2084. La fin du monde ». À défaut d’avoir été naturalisé français (?), il se comporte dans ses écrits et dans ses sévères interpellations des autorités françaises, à propos de l’Islam et des migrants musulmans, comme un pur Français « souchien », dans une version extrême qui relègue le Rassemblement national lepéniste. Il aura, en maintes circonstances d’affrontement avec les Musulmans de France, entonné les couplets martiaux de « La Marseillaise ».
Sansal, à l’instar de beaucoup d’écrivains français d’origine algérienne, ne veut pas distinguer entre la carrière littéraire française qu’il accomplit en toute volonté et la carrière littéraire algérienne qui ne lui appartient pas. Cette ambigüité n’est pas sans intérêt. S’il est porteur d’un passeport algérien, il n’est pas stricto sensu un écrivain algérien et, surtout, il n’en réunit pas les conditions de dignité.
Tropisme juif et engagements sionistes
Dans cette conversation avec le quotidien à l’enseigne « le droit de savoir, le devoir d’informer », Sansal fait l’impasse sur ses engagements sionistes que j’ai rappelés récemment dans une tribune lisible sur le site d’information « Algérie 54 » (« Littérature et nuisance. Nationaux algériens et bi-nationaux franco-algériens contre l’État sous l’égide de la France », 25 avril 2021). Après quatre romans sans grand retentissement, Sansal a éprouvé le besoin de changer de trajectoire. Depuis « Le Village de l’Allemand ou le Journal des frères Schiller », en 2008, et « Rue Darwin », en 2011, deux romans à thème juif, il flirte distinctement avec le sionisme international. Médiocre écrivain, mais athlète tortueux des prix littéraires, semant savamment le buzz, pour les collectionner, Sansal qui a dans sa ligne de mire le Prix Goncourt, la plus importante récompense littéraire française, même si elle est aujourd’hui délégitimée, s’est rapproché du lobby sioniste du champ littéraire parisien et de son chef, l’écrivain et éditeur Pierre Assouline. Il lui rend un hommage appuyé dans les pages de « Rue Darwin », un signalé coup de brosse à reluire.
Sansal se projette, à dessein, dans un brumeux « être juif » et une « condition juive », autrefois analysés par Jean-Paul Sartre. S’il pressentait déjà depuis « Le Village de l’Allemand » cette judéité, il y faisait aussi connaître explicitement son intention réitérée de se rendre au Mémorial de la Shoah de Yad Vashem, à Jérusalem. Cette insistance ne pouvait échapper à l’attention du gouvernement sioniste qui lui organisait sous la protection de son ambassade à Paris et des « services » du Mossad un voyage en Israël. C’était au mois de juin 2012. Dans son périple israélien, Sansal pouvait répéter à l’envi cette affirmation : « Il n’y a pas eu et il n’y a pas d’entreprise coloniale en Palestine ». C’est plus qu’un gage donné au lobby sioniste du champ littéraire parisien, une profession de foi en faveur d’Israël et du sionisme. Ce déni d’une histoire immémoriale de la terre de Palestine lui valait les félicitations et l’appui du gouvernement Netanyahu et la colère des pays arabes. À Jérusalem, en ce mois de juin 2012, il apparaît coiffé de la kippa sur l’esplanade des Mosquées, en Juif asserté, pour tenir les pires propos sur les Palestiniens, qu’il considère comme un peuple fictif inventé par des pays arabes haineux pour envenimer la paisible existence d’Israël. Au Mur des Lamentations, au Mémorial de Yad Vashem, il conteste le droit à la vie des Palestiniens, les souillant de crachats. Dans colonnes du quotidien « Le Soir d’Algérie », j’expliquais les attentes sordides de ce voyage, réinsérées dans un plan de carrière littéraire parisienne. Sansal conçoit, en vérité, sa conversion à un judaïsme d’opérette et son activisme sioniste comme un marchepied dans une carrière littéraire relancée, pour de grandes récompenses littéraires escomptées.
À son retour à Paris, le « Voyageur d’Israël » était pris en charge par Antoine Gallimard, le directeur de la puissante maison d’édition parisienne, qui supputait contre son auteur des mesures de rétorsion, au premier plan du gouvernement algérien. En fait, à son grand étonnement, Sansal ne sera inquiété par aucune justice ou police à son retour à Boumerdès. Le président Bouteflika aurait instruit de le laisser « aboyer » à son gré. Entretemps, il était mis à l’abri dans un appartement d’hôte de l’éditeur qui faisait bouger sa soldatesque de plume. C’est Antoine Perraud, un journaliste de basse besogne du site en ligne « Mediapart » (Paris), qui est chargé de lui donner la parole et d’orchestrer une riposte rageuse à mes tribunes du « Soir d’Algérie », surjouant une problématique fin pour le protégé de l’éditeur Gallimard : « deux balles à la tête », comme cela a été le cas pour Tahar Djaout (1954-1993), assassiné par des tueurs islamistes. Perraud pouvait écrire dans une propension raciste et néocoloniale pour déconsidérer l’auteur de ces lignes et lui reprocher d’« ôter toute racine algérienne à Sansal pour l’opposer aux écrivains israéliens, enracinés ».
Neuf ans après les faits, je développerais la semblable herméneutique pour éclairer une algérianité incertaine de Boualem Sansal, petit-fils d’une tenancière de bordel de l’Ouarsenis où il a grandi. Dans son parcours d’écrivain, Sansal pouvait s’appliquer à brouiller les signes carnavalesques de ses origines vraies. Né dans un bordel, il doutera longtemps de son père biologique présumé, disparu très tôt dans un accident de voiture. Et dans sa fabrique du passé, dans la genèse d’un sang coupable, il est si peu Algérien. Recherchant dans « Rue Darwin » auprès du rabbin du quartier Belcourt (Belouizdad), à Alger, une origine juive fantasmée, il y campe un frère juif et homosexuel, mais il ne peut se réclamer dans le monde réel que d’une judéité d’emprunt, artificieuse. Vaguement Algérien, vaguement Marocain, vaguement Juif, il se cramponne à cette identité hybride, à la fois bâtarde et malheureuse, pour fonder un personnage typique des lettres. Autant dire que cette mise en scène d’auteur n’a pas convaincu grand monde à Paris où le ban et l’arrière-ban du milieu littéraire avaient les yeux de Chimène pour Frédéric Beigbeider et ses petits voyous de bonne famille du « Flore ».
En 2012, le jury du Prix du roman arabe, créé en 2008 par le Conseil des ambassadeurs arabes accrédités auprès de l’UNESCO, qui avait consacré, en 2010, Rachid Boudjedra pour « Les Figuiers de barbarie », a décerné son prix à « Rue Darwin ». Choqués par les odieuses déclarations de Sansal sur la Palestine en Israël, les ambassadeurs arabes ont décidé de ne pas l’attribuer, provoquant la démission du jury présidé par l’historienne Hélène Carrère d’Encausse et une polémique entre Elias Sanbar, écrivain et ambassadeur palestinien, membre du jury, et Pierre Assouline, défendant Sansal. Où les ambassadeurs arabes ne lisent pas ou ce sont de pâles crétins : comment ont-il pu valider la sélection d’un « roman arabe » où Golda Meir écrase Houari Boumediene ? C’est la pire des injures aux Algériens. Où était notre ambassadeur dans cette affreuse palinodie ?
En 2014, après avoir gratté les fonds d’assiette des diners du CRIF, garant à Paris du sionisme international, Sansal cultive la camaraderie du bourreau de Ghaza, le premier ministre Netanyahu, et rejoint un comité scientifique israélien d’organisation d’une manifestation célébrant « Jérusalem, ville millénaire juive », à l’UNESCO, cette fois-ci, très vite annulée à la demande des ambassadeurs arabes. S’il est établi que le lobby sioniste parisien peut faire et défaire l’édition française, voire même ordonner ses couronnes littéraires, il n’a pu, à ce jour, lui faire décerner le Goncourt. Dans son entretien avec le quotidien de l’industriel Rabrab, il escamote son tropisme israélien et son intégration dans les rangs du sionisme international. La question ne lui sera pas posée.
Une transcription fausse et polémique de l’histoire algérienne présente
Lorsqu’il parle de l’Algérie, Boualem Sansal se dresse en champion du hirak, auquel il reste totalement étranger, à Paris ou à Boumerdès. Dans sa perception des faits, qui est celle des journaux d’Alger qu’il lit et qui lui ouvrent leurs colonnes, ainsi le quotidien du « droit » et du « devoir » et « Le Quotidien indépendant », le hirak serait un mouvement démocratique, qui n’a d’autre objectif que de faire tomber un pouvoir d’État illégitime. Mais l’histoire présente échappe à ces journaux : il y a, aujourd’hui en Algérie, un président et un pouvoir légaux issus des élections du 12 décembre 2019. C’est quasiment un tabou pour cette presse des bobos algérois de reconnaître que l’État algérien fonctionne, qu’il assure ses responsabilités à l’intérieur et en dehors du pays, qu’il garantit la paix et la sécurité et les espérances pour tous les Algériens, en dépit de toutes sortes de crises financières et sanitaires mondiales qui grèvent, en partie, son exercice. Ce n’est pas dans cette presse, sans honneur et sans probité professionnelle, qui s’est mobilisée contre les chartes juridiques de neutralité qui l’ont créée comme le soutien d’un néo-hirak factieux, que Sansal pourrait discerner que ces escouades de marcheurs illuminés n’ont aucune parenté avec le mouvement originel et spontané du 22 février 2019, qui avait pour objectif d’empêcher le cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika à la présidence de l’État et la reconduction de sa ‘issaba.
Lorsque Sansal tambourine que « le peuple n’a pas réalisé son indépendance », qu’il l’attend du hirak, il s’agit simplement d’une contre-vérité historique et d’une offense au sacrifice de nos martyrs de la Guerre antocoloniale, qui ont donné avec la dignité et la liberté, un État, un drapeau, un hymne et une réalité nationale à un pays et à un peuple longtemps soumis aux agressions et aux invasions étrangères, dont celle de la France n’est pas la moindre. C’est cet État algérien indépendant qui l’a formé dans ses grandes écoles et qui lui a ouvert la voie d’une formation supérieure à l’étranger, en Tchéquie, précisément. Or le pouvoir d’État en Algérie n’a pas su, dès 1962, imaginer les aggiornamentos à une gouvernance politique erratique et Sansal qui le critique et lui assène la trique, désormais, y a pris des responsabilités, d’importantes responsabilités.
Lorsqu’il utilise, toute honte bue, le vocable ‘issaba, Sansal est dans une forclusion du sens. Il déclare, en effet, à la rédaction que dirige M. Ouali : « J’ai écrit ‘‘Le Serment des barbares’’ entre 1996 et 1998 en plein milieu de la décennie noire, l’une des plus grandes tragédies de notre temps. Nous étions pris entre deux feux, les islamistes d’un côté et de l’autre la îssaba au pouvoir ». Une « îssaba au pouvoir » ? Est-ce vraiment le cas à cette période ? Entre novembre 1995 et avril 1999, le régime algérien se reconstituait sous la direction du président Liamine Zeroual, un cadre supérieur de l’Armée nationale populaire, patriote, honnête et intègre, régulièrement élu, en 1995, par le peuple algérien. Incarnait-il, comme l’écrit Sansal, le feu d’une terrifiante ’issaba ? Ce n’est pas ce respectable président, politiquement irréprochable, qui a livré le pays aux puissances d’argent. Le terme ‘issaba, qui n’est plus employé actuellement dans son acception sémantique première, ne devrait être réservé que pour le long règne des frères Abdelaziz et Saïd Bouteflika.
Ce que Sansal se garde de dire, c’est qu’entre le début des années 1980 et jusqu’à 2003, soit une période de plus de vingt ans, il a été un haut fonctionnaire de l’État algérien, en qualité de directeur central au ministère de l’Industrie, voguant sous plusieurs dénominations, de « lourde » et « légère » à « restructuration industrielle » et « PME et PMI », sous la direction de neuf ministres, ainsi Said Aït-Messaoudène, Kasdi Merbah, Messaoudi Zitouni, Mohamed Ghrib, Abdenour Keramane, Mourad Benachenou, Mokhtar Meharzi, sous Chadli Bendjedid, Bouguerra Soltani et Abdelmadjid Menasra, affidés islamistes, sous Bouteflika. Un de ces ministres, particulièrement ignare selon ses dires, était rivé sur des écrans de dessins animés arabes. Si, effectivement, il y avait une ’issaba à cette période-là, il en faisait partie dans une position privilégiée. Il a été également, sans rechigner ni se faire le chantre de la démocratie, pendant quatre ans dans cette haute fonction lors du premier mandat présidentiel d’Abdelaziz Bouteflika, le servant sans état d’âme, en livrée. Il faut rappeler, ici, que c’est Boualem Sansal, promu directeur général de l’Industrie au ministère éponyme, avec un statut de secrétaire d’État, qui a conduit pas à pas la désindustrialisation de l’Algérie, sous la présidence de Chadli Bendjedid, dans les années 1980. Si le démantèlement de l’industrie algérienne, une fumeuse thèse d’économie politique que lui a vendue un économiste français bien introduit dans le pays, a été acté par le président Bendjedid sans discernement, l’agent de basse besogne, le fossoyeur de l’industrie algérienne a un nom : Boualem Sansal. Une mauvaise politique, certes.
Zélateur du libéralisme dans sa version algérienne outrée de l’« infitah », Sansal a taillé en pièces les géants industriels créés par Houari Boumediene, arrimant le pays à un socialisme d’État qu’il haïssait. Il a envoyé au chômage des dizaines de milliers de cadres, d’agents intermédiaires et d’ouvriers. La déstructuration de l’industrie algérienne est un drame humain aussi terrible que l’islamisme, jetant de milliers de familles dans le désespoir de la précarité : Sansal l’a conduite, en terrible cerbère. Dans les années 2000, dans un entretien avec un journal parisien, il exprimait un seul regret de cette épopée de destructeur, de n’avoir pas cédé au franc symbolique aux industriels français les entreprises algériennes démantelées.
Proche de la ‘issaba aux commandes du pays au début de ces années 2000, Sansal s’est arc-bouté dans son fauteuil de directeur général du ministère de l’Industrie. Il n’a quitté cette fonction, en 2003, que sous la contrainte, chassé par le président Bouteflika, qui avait estimé, à juste titre, que la situation de ce haut fonctionnaire ruinait les mœurs de l’État. Le romancier, qui venait de publier son troisième opus « Dis-moi le paradis », ne pouvait à la fois disqualifier dans la presse occidentale à Paris « le régime d’Alger », posant allègrement en opposant, et se maintenir coûte que coûte au sein du pouvoir, à Alger. Sansal était une sorte de Janus aux deux visages, accro aux costumes dits « trois-pièces » dans les couloirs et les salons du ministère de l’Industrie, à Alger, et à une vêture de trublion en peau de mouton sur les plateaux de radios et de télés et dans les tripots parisiens. La forte et persistante inimitié qu’il allait entretenir fielleusement contre les frères Bouteflika doit son origine à cette hypocrisie à laquelle le président a mis sèchement un terme. À Paris, se vengeant bassement de son liquidateur, Sansal, qui a cassé des dizaines de milliers d’emplois dans l’industrie, d’une rancune tenace lorsqu’il s’agit de sa personne, décrit dans les colonnes de « Jeune Afrique » Abdelaziz Bouteflika en Borgia dans un palais de la Mouradia, couvert de sang et de stupre. Non, le président Bouteflika ne se trompait pas sur la duplicité de Boualem Sansal.
Le néo-hirak d’aujourd’hui, derrière lequel se range l’écrivain, au seul motif de la haine qu’il ne cesse de nourrir contre l’État algérien, résume un esprit pervers. Sansal, se proclamant le héraut de la lutte contre l’islamisme en France et en Europe, devrait savoir que le néo-hirak est totalement passé sous l’emprise des organisations terroristes Rachad (Londres, Genève, Ankara) et MAK (Paris, Tel Aviv, Rabat), et que les agents des « services » américains qui prétendaient, en 2019, le diriger avec la bénédiction du sociologue français Lahouari Addi, n’en sont plus que la « branlante » roue de secours, secouée par les spasmes du bitume.
Ce néo-hirak et ses principaux animateurs islamistes et séparatistes qui ambitionnent une prise du pouvoir par la rue, à n’importe quelle condition, ainsi le chaos et le dépeçage de la nation algérienne, il serait temps que Sansal fasse connaître le soutien qu’il leur apporte à ses amis et protecteurs français et occidentaux. On ne peut faire la guerre à l’islamisme à Paris et le défendre à Alger. Courte vision, certainement.
D’impossibles déblatérations.
Sansal s’auto-glorifie comme un « spécialiste de l’islamisme dans le monde ». L’unique texte qu’il publie sur l’islamisme (« Gouverner au nom d’Allah. Islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe », 2013) est le résultat de son activité d’informateur rétribué (pour ne écrire « espion ») auprès des services de renseignement allemands. Dans tout autre pays que l’Algérie, ainsi la France ou les États-Unis d’Amérique, il aurait eu à en répondre pour collusion avec une puissance étrangère. Soit. Mais dans les faits vérifiables, dans ses nombreuses déclarations, Sansal n’a jamais combattu l’islamisme, mais l’Islam, ce qui est différent. En France, son islamophobie tourne à la caricature. N’y insistons pas.
Hors du buzz qu’il sait susciter, Sansal est un piètre écrivain, sans style et sans imaginaire, qui n’a à faire valoir que sa plume de bureaucrate. Il le dit lui-même : il a écrit « Le Serment des barbares » sur le papier pelure du ministère de l’Industrie passant de la rédaction d’une circulaire comminatoire à un paragraphe de ce roman. La caution intéressée que lui accorde Gallimard n’a pas d’autres motivations que financières. Si, aujourd’hui, André Gide (Prix Nobel de Littérature, 1947), Paul Valéry, Marcel Proust et Roger Martin du Gard (Prix Nobel de Littérature, 1937) revenaient présenter leurs manuscrits à cet éditeur, ils seraient recalés en raison des nouveaux impératifs qui guident l’édition française. En France, les gens ne lisent pas, ils achètent des livres pour se plier à la sempiternelle règle du marché : plus il y a du bruit autour d’un produit, plus il se vend, quelle qu’en soit la qualité. Sansal est clair à ce propos : « Les auteurs et les éditeurs ne vivent pas d’amour et d’eau fraîche seulement… ». D’où la fétide surenchère sur l’Algérie et les Algériens, les Arabes et l’Islam, l’idéalisation d’Israël et du sionisme et la « solution finale » pour la Palestine et les Palestiniens, pour s’imposer non pas par l’écriture littéraire, mais dans ses marges, dans la vie littéraire. Notons donc : lorsqu’il n’aura plus l’inspiration du buzz, Sansal sera vite oublié.
Ce qui est proprement pharamineux chez Sansal ? Cet art de se projeter comme « écrivain à succès », « écrivain en vue » et « écrivain maudit » relève de la construction d’un ethos fallacieux. Pour la première qualification, c’est acquis : toute la congrégation littéraire de France sait que l’éditeur Gallimard peut sous sa couverture publier un manuel d’ouvre-boîte de conserve et le vendre comme best-seller à un million d’exemplaires, en le faisant chroniquer dans les meilleures pages littéraires du pays. À plus forte raison, un roman fustigeant l’Algérie ou l’Islam. Pour la seconde, c’est incontestable, le buzz dans la presse et sur les réseaux sociaux y contribue. Mais la troisième n’est qu’une prétention farfelue. Dans l’histoire de la littérature européenne qui a forgé et mis en scène cette posture, l’écrivain maudit, de Thomas Chatterton à John Keats et Thomas de Quincey, de Sade à Aloysius Bertrand et Charles Baudelaire, est une figure du romantisme, empruntant les voies caverneuses d’une identité fragmentée. Charles Bukowski, John Fante, aux États-Unis d’Amérique, Yukio Mishima, au Japon, Jean Genet, Georges Bataille, Maurice-Édouard Nabe, Richard Millet, en France, en prolongent le mythe, parfois sur des terres abîmées. On ne peut voyager en première classe sous la protection de la France, de Lillehammer à Pékin et dans cent capitales du monde, pour vendre et défendre la littérature française et se proclamer « écrivain maudit ». Mensonge et mythomanie.

Relativement à la littérature des Algériens, Sansal est en retard d’un demi-siècle, qui oppose la littérature de langue arabe à une « littérature d’expression française », terme impropre, en faisant l’impasse sur les littératures dans les langues tamazight, qui constituent ensemble et uniment la littérature nationale algérienne. L’opposition linguistique, relativement aux usages de l’arabe et du français, appartient au passé. Aujourd’hui, les auteurs dans cette langue ont chevauché toutes les audaces et leur roman, en phase avec la société, est supérieur au roman de langue française qui traîne le boulet d’archaïsmes moraux et sexuels. La littérature pseudo-algérienne, qui se porte bien, selon Sansal, est fomentée par la France littéraire, une littérature de harkis dont il est l’adjudant-chef. La littérature algérienne de langue française des Algériens attendra encore longtemps de sortir de l’effacement que lui imposent dans le monde l’impérialisme littéraire français et l’activisme de l’État français. En d’autres temps, ce sont des auteurs algériens, reconnus dans leur pays, qui seraient traduits et lus au-delà de nos frontières, jusqu’en Chine, où Sansal se réjouit d’être enregistré dans les meilleures ventes, au nom de la France et de sa promotion d’une « littérature algérienne » Taïwan. Quand est-ce que la Chine s’éveillera à ces infâmes tripatouillages littéraires ?
Une éthique du débat culturel et de la justice.
Boualem Sansal, représentant de la pseudo-littérature algérienne sous l’égide de la France littéraire, comme Kamel Daoud, Anouar Benmalek, Mohamed Kacimi, Salim Bachi, Abdelkader Djemaï et bien d’autres, est protégé par une sorte de lâcheté collective de l’Université algérienne et par la complicité de la presse bobo d’Alger ; il le sait. Professeurs d’universités et critiques des médias se taisent, souvent par poltronnerie quand ce n’est pas par ignorance. Il y a aussi une sacralité de tout écrit qui vient de l’étranger, notamment de France. Comment, là-dessus, penser un intellectuel décolonisé ? Je me suis toujours retrouvé seul sur le front de ce combat pour l’autonomie politique et esthétique de l’espace littéraire national algérien – mais, ce n’est pas ici le lieu d’une telle discussion.
Sansal, qui n’est pas dans l’éthique du débat contradictoire pour répondre aux mises en cause publiques de ses déclarations et de ses écrits, trouve dans l’entretien sus-cité une échappatoire : « Certains polémistes dépassent le cadre de la critique de l’œuvre et s’attaquent à la personne de l’auteur, ils font une fixation morbide sur lui et prennent un plaisir sadique à l’abreuver d’injures, à le dévaloriser en faisant étalage de leur savoir pour convaincre les foules. La plupart des écrivains à succès ont un cinglé qui les poursuit de sa haine ». Une mise au point est indispensable : je ne me suis pas spécialement intéressé aux petites littératures des Français d’origine algérienne ou d’Algériens nationaux, sombres coursiers de la France littéraire, dont celle de Sansal. Je suis arrivé difficilement au bout de « 2084 », qui m’est plusieurs fois tombé des mains. Sansal ne sera jamais un grand écrivain parce qu’il ne sait pas écrire et, en tant que lecteur professionnel, je l’ai lu par devoir, comme j’ai lu des centaines d’auteurs du vaste monde. Et je n’ai jamais ressenti le besoin d’assurer la recension de ses œuvrettes parce qu’elles ne méritent ni ma patience ni mon intérêt de critique. Quand je réponds à Sansal sur l’injure à nos martyrs et à nos héros de la Guerre d’Indépendance traités de « terroristes islamistes », sur les imprécations qu’il assène à l’Algérie et aux Algériens, sur la Palestine qui n’existe pas, sur son adhésion aux thèses sionistes, sur son activisme pro-israélien, sur ces nombreuses proférations ignominieuses pour pousser en France, en Europe et dans le monde la vente et la traduction de ses ouvrages, s’agit-il de littérature ? Lorsqu’un écrivain s’exprime sur son œuvre, dans les marges de cette œuvre, il est toujours légitime, lorsqu’il le fait pour porter un quelconque message politique, il n’est plus expressément dans la littérature, mais dans un débat politique et culturel. Or, dans ses textes « littéraires » qui relèvent plus du reportage, du récit de témoignage ou du commentaire que d’une créativité littéraire, comme en dehors d’eux, Boualem Sansal reste dans l’outrage, sans en prendre la responsabilité publique. Chez Gallimard, cette littérature de gribouilleur, barbotant dans le mensonge et la haine, c’est rémunérateur. Sa survivance ne doit rien au talent, mais tout au cliquetis des tiroirs-caisses.
Il est certainement facile de rouler encore et encore sur l’Algérie, la Palestine, les Arabes et l’Islam, de les étouffer dans la gadoue pour complaire à des lectorats occidentaux, singulièrement ceux la France revancharde de la famille Le Pen. Il convient d’avoir aussi le courage et la loyauté d’aller vers un débat contradictoire. Boualem Sansal n’est ni courageux ni loyal. Interrogé par un journaliste parisien sur le fait qu’il n’a jamais répondu directement à ses contradicteurs, il devait reconnaître que son éditeur et maitre Antoine Gallimard le lui déconseillait. Et, c’est bien Antoine Gallimard, héritier d’une maison qui a collaboré avec l’occupant nazi de la France et qui prétendait même « aryaniser » l’éditeur parisien Calmann-Lévy, qui rameutait, en 2012, le sinistre Antoine Perraud contre mes écrits sur le délictueux insulteur en kippa des Palestiniens. Voilà un écrivain qui n’a jamais eu la droiture de défendre ses opinions hors du cercle d’amis, de protecteurs des médias français et des associations sionistes de France, invétéré dineur du CRIF, qui n’a jamais parlé et écrit que sur commande, sans assumer en toute moralité ses engagements. Il le faisait encore au mois de janvier passé dans les colonnes de « l’Obs » (Paris) pour rabaisser l’écriture de l’histoire et de la mémoire algériennes par les Algériens. Une sordide crapulerie.
J’observe cette folle agitation du romancier, dans la position de tireur couché, qui, tout compte fait, en vingt-deux années de productions mesquines et de gages tous azimuts, notamment au sionisme international, n’a pas obtenu le Goncourt, laissant derrière lui des magmas de haine qu’il a déversée sur son pays, sur les Arabes, principalement les Palestiniens qui meurent à Ghaza, sur l’Islam, religion universelle. Dans un entretien avec Renaud de Rochebrune (« Jeune Afrique », « La Revue »), en 2015, Sansal, harki des lettres et traitre à la patrie algérienne, raconte comment le président Bouteflika, lors d’une soirée festive, s’était approché de l’ambassadeur américain pour se plaindre de lui, lui conférant par cette démarche un statut d’« intouchable ». Il n’est jamais souhaitable que la fraternelle Algérie nouvelle de M. Tebboune se fasse dans les tribunaux et dans les prisons, mais dans une égale justice pour tous les Algériens. Et, spécialement, Boualem Sansal, s’il l’est encore, Algérien et « intouchable ».